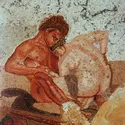RABELAIS FRANÇOIS (1483 env.-1553)
Article modifié le
L'homme de bonne volonté
Que reste-t-il alors ? À l'homme qui cherche sa voie, comme Pantagruel et ses compagnons, il reste des biens internes, la foi et la sagesse.
Croire ou ne pas croire, telle est la question. Non pas que Rabelais soit tenté par l'athéisme ou par l'hérésie. L'auteur du Gargantua ou du Quart Livre a d'abord été présenté comme un esprit fort, qui se moquerait des faits miraculeux. Mais, replacées dans le contexte contemporain, la plupart de ces facéties semblent aussi inoffensives que les plaisanteries en usage dans les milieux ecclésiastiques. Certains critiques avaient comparé ces allusions au miracle avec les idées des philosophes padouans, Pomponazzi et Cardan, en interprétant les unes et les autres dans une perspective rationaliste. Or il apparaît que Rabelais se moque surtout de la multiplication superstitieuse de ces croyances, sans prétendre expliquer le miracle par une cause naturelle. Quant à l'hérésie protestante, il partage certes l'indignation des réformés devant certains abus de l'Église. Les escales chez les Papimanes ou à l'île Sonnante ne déplairaient pas à un protestant. Comme eux, il s'indigne de tant et tant d'intermédiaires interposés par la superstition entre le croyant et son Dieu, et voit dans la cohorte des saints catholiques un reste de paganisme. Comme eux, il lit et cite la Bible. Mais ces analogies ne suffisent en aucune façon à en faire un réformé, même si l'âpreté de la satire dans le Cinquiesme Livre a parfois incité la critique à considérer ce roman comme l'œuvre d'un protestant. La thèse de l'influence protestante ne résiste pas à l'usage de critères plus précis, la notion de mérite et de bonnes œuvres, la doctrine du serf arbitre, le problème des sacrements, ou un emploi déterminé de certains passages de saint Paul.
À la lumière des travaux récents, Rabelais est maintenant considéré comme un de ces catholiques attristés par les abus de l'Église contemporaine, l'absence de vocation dans le clergé, l'ignorance des moines, et qui ont cherché à y remédier en revenant aux textes sacrés et à une foi moins superficielle. Ce courant de pensée, l'évangélisme, se caractérise notamment par la lecture de la Bible, source d'une foi vive, par opposition aux rites et à une pratique somnolente de la prière. On sait l'ardeur avec laquelle un Érasme ou un Lefèvre d'Étaples ont essayé de rendre les textes sacrés plus fiables et plus accessibles. Ce travail philologique est pour les évangéliques un des moyens de revenir aux origines du christianisme, avant toute tradition élaborée par les hommes. Ils ont la nostalgie d'une foi épurée, qui ne s'embarrasse pas de pratiques formelles, et qui soit dialogue de l'âme avec le Créateur. Or l'influence d'Érasme sur la pensée de Rabelais est accréditée non seulement par de nombreuses analogies, mais aussi par une lettre datée de novembre 1532. Rabelais s'adresse à son maître, et le reconnaît comme son père spirituel. Ainsi s'expliquent, d'une part, les railleries de Rabelais envers les abus de l'Église contemporaine et, d'autre part, dans le domaine de la foi, ses réticences envers les messes innombrables, les chapelets, les pèlerinages, toutes manifestations d'un formalisme desséché.
C'est dans cette perspective que la critique a pu retracer l'évolution religieuse de Rabelais. Lorsque paraît le Pantagruel, en 1532, il n'est pas dangereux d'adhérer aux thèses des évangéliques, ces catholiques réformistes, car François Ier leur est favorable. Comme Érasme, Rabelais ne se prive donc pas de critiquer l'Église contemporaine, ses moines fainéants ou ses papes trop épris du pouvoir temporel. Même vigueur dans le Gargantua, où Thélème, ce couvent à l'envers, est une critique sévère de la vie monastique. Le remède que l'auteur préconise dans ces deux premiers romans est la prière, signe d'une foi profonde. Pantagruel s'adresse à son Créateur avant son combat avec Loup Garou, et promet de faire prêcher l'Évangile dans le texte. C'est encore la prière qui rythme la journée du jeune Gargantua. Il est évident que ces personnages éprouvent le besoin d'une vie spirituelle, où ils puisent leur force. Or cette vie fait défaut à Panurge, et c'est pourquoi dans le Tiers Livre la pensée religieuse de Rabelais est centrée sur le thème de la peur superstitieuse, qui témoigne d'un rapport perverti avec le surnaturel. Panurge craint les diables et la damnation, tandis que le doux poète Raminagrobis n'est que sérénité à l'approche de la mort. La joie de l'âme purifiée est comme une manifestation de la bonté divine. Cette foi profonde est également incarnée par Pantagruel, être bon et joyeux. Ces rapports de la superstition et de la peur tiennent une place aussi importante dans le Quart Livre. Au plus fort de la tempête, Panurge pris de panique promet d'entreprendre un pèlerinage. L'humanité dépeinte dans ce roman révère craintivement ses dieux, comme les Andouilles agenouillées devant Mardi gras.
Ces quatre romans reflètent donc les convictions des évangéliques. Mais le Quart Livre diffère des livres précédents par une aversion beaucoup plus violente envers les Églises, ces créations humaines, artificielles, corrompues et dangereuses. Rabelais s'en prend à la fois à Calvin, qui venait de le traiter d'impie dans son livre Des scandales, et aux catholiques, les Papimanes. Ces derniers sont des partisans zélés des décrétales, un corpus de droit canonique, dont certains décrets renforçaient le pouvoir temporel du Saint-Siège, notamment en matière de bénéfices ecclésiastiques. C'est dire que ces décrétales étaient mal vues des évêques français, à commencer par Jean du Bellay. Par-delà ces allusions à l'histoire contemporaine, Rabelais soupçonne les Églises de mener à l'idolâtrie. Les Papimanes adorent le pape comme s'il était un dieu sur terre.
Croire ou ne pas croire ? Rabelais ne croit pas aux inventions humaines, théologies, rituels, institutions ecclésiastiques. À cet égard, son irrespect est sans limites, et son œuvre profondément subversive. Mais s'il les critique avec âpreté, c'est pour défendre ce bien essentiel qu'est le rapport confiant entre Dieu et sa créature.
Ouvert au surnaturel, l'homme de bonne volonté a aussi une vocation naturelle, la sagesse. La base de cette sagesse est le respect de ce corps qui est mis en valeur par le gigantisme. L'hygiène ou le sport ont une grande place dans l'éducation du jeune Gargantua ou dans la vie des Thélémites. Rabelais est à la fois un moine qui a souffert dans les couvents, un médecin qui n'ignore pas les mécanismes physiologiques, un père de famille dont on connaît au moins trois enfants naturels.
À ses yeux, l'être humain est essentiellement un organisme dominé par deux fonctions : se nourrir et se reproduire. Elles figurent non seulement dans le récit, mais aussi dans la trame métaphorique du texte, et contribuent à la valeur subversive de l'œuvre. En effet, si la critique récente fait de Rabelais un bon croyant et un chrétien sincère, il ne faut pas pour autant méconnaître cette rupture délibérée avec une certaine tradition du christianisme, c'est-à-dire le mépris du corps et le refus de prendre en compte ses exigences. Or Rabelais rappelle sans cesse la part d'animalité qu'il y a dans l'être humain. Les puissants, les savants et les saints sont renvoyés à leur chaise percée. Le vocabulaire du sexe ou de l'excrément a valeur de juron allègre : c'est appliquer à chacun les noms les plus brefs de notre langue... Le Quart Livre s'achève dans un déluge verbal et fécal, et le noble lecteur en sort tout embrené. Hardiesse souveraine d'un homme qui ne s'en laisse pas imposer. L'œuvre de Rabelais est avant celle de Montaigne une salutaire école d'irrespect, et Diogène le cynique est une des grandes figures de cette comédie humaine.
La tradition des fabliaux et de la littérature narrative française et italienne est pour beaucoup dans ces rappels obsessionnels, mais ils correspondent surtout à une certaine vision de l'être humain et de sa condition. La sexualité est le seul remède à la mort, comme le rappelle Gargantua à son fils. Panurge n'a pas tort de songer à se prémunir en perpétuant sa race. Cette transmission par l'hérédité, notion aristotélicienne, est une forme de l'échange, cette loi célébrée par Panurge dans l'éloge des dettes, au début du Tiers Livre. Les pulsions de l'instinct traduisent en effet l'élan de l'individu vers le monde qui l'entoure. L'appétit est une des forces de l'espèce, et il est magnifié dans les scènes de ripailles ou dans les variations grivoises. Le héros Pantagruel est une divinité de la soif.
Dans la philosophie éclectique de Rabelais, ces bienfaits de l'instinct sont un thème épicurien. Mais, de façon plus générale, cette notion repose sur une confiance en la nature, ensemble de mécanismes bien réglés. Nature est l'ordre universel, la physis aristotélicienne, que le Quart Livre oppose à la monstrueuse antinature. C'est aussi le plan divin. De là vient que Rabelais, à la suite d'Érasme, et contrairement à Luther, qui croit la nature profondément viciée, exprime dans le mythe de Thélème sa foi en une liberté guidée par un instinct naturel. “Fay ce que voudras”, conclut l'auteur du Gargantua, qui nous renvoie à nos désirs et à notre volonté. Toutefois, cette confiance en l'autorégulation du vivant n'empêche pas Rabelais de redouter les excès auxquels peut conduire l'abandon à l'instinct. Les Gastrolâtres, dont le ventre est le dieu, incarnent dans le Quart Livre les dangers d'un épicurisme mal compris.
La reconnaissance du corps, la pratique de l'échange, l'exercice de la liberté mènent à une sagesse allègre. En 1532, Rabelais définit cet idéal en ces termes : “vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grande chère”. La sérénité de Pantagruel n'est jamais troublée : c'est l'ataraxie des stoïciens et des épicuriens.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Françoise JOUKOVSKY : professeur émérite à la faculté des lettres de Rouen
Classification
Médias
Autres références
-
PANTAGRUEL, François Rabelais - Fiche de lecture
- Écrit par Guy BELZANE
- 1 483 mots
C’est probablement à l’occasion de la foire de Lyon, en novembre 1532, que paraît chez l’imprimeur Claude Nourry le premier roman de François Rabelais (1483 env.-1553), Pantagruel, avec pour sous-titre complet : Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel,...
-
CONSCIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 719 mots
Lequel d’entre nous, enfant, traversant la rue sans regarder ou sautant du haut d’un arbre, n’a jamais été accusé d’être « inconscient » ? Nos parents ou nos éducateurs voulaient nous faire comprendre par là que nous étions aveugles au danger, que nous manquions de lucidité et de la plus élémentaire...
-
ÉROTISME
- Écrit par Frédérique DEVAUX , René MILHAU , Jean-Jacques PAUVERT , Mario PRAZ et Jean SÉMOLUÉ
- 19 777 mots
- 6 médias
...comme un auteur scandaleux de sonnets licencieux (ou Raggionamenti, 1536). Il achèvera une vie fastueuse et libertine à Venise. Ou son contemporain, François Rabelais (1483 ?-1553), qui possède une dimension littéraire supérieure. Censuré en Sorbonne, en 1533, pour Pantagruel, contraint à la... -
FEBVRE LUCIEN (1878-1956)
- Écrit par Bertrand MÜLLER
- 2 118 mots
- 1 média
...concrète à partir d’un problème qu’il estime mal ou insuffisamment posé et qu’il s’efforce de reprendre de manière critique. C’est le cas notamment de « l’athéisme » présupposé de Rabelais, suggéré notamment par son biographe Abel Lefranc, que Febvre estime être une projection anachronique du présent... -
FOLENGO TEOFILO (1491-1544)
- Écrit par Angélique LEVI
- 474 mots
Connu sous les divers pseudonymes de Merlino Coccajo, Merlin Coccaie, par lequel le désigne Rabelais, ou Limerno Pitocco, c'est-à-dire « le Gueux », Folengo est une des figures les plus représentatives et l'un des écrivains les mieux doués de son époque. Né à Mantoue, bénédictin à vingt ans, Teofilo...
- Afficher les 8 références
Voir aussi