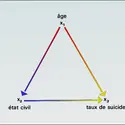TARDE GABRIEL (1843-1904)
Article modifié le
Si à certaines notions, fondamentales en sociologie – la conscience collective, l'idéal type, la communauté –, sont associés les noms de Durkheim, Weber et Tönnies, qu'elles suffisent à évoquer, c'est au thème de l' imitation que celui de Tarde demeure classiquement attaché. Le rôle essentiel que ce dernier a assigné à la répétition ainsi qu'aux phénomènes de contagion dans la formation et l'évolution des comportements l'a opposé à Durkheim. Aux yeux de l'auteur des Lois de l'imitation, « l'individuel écarté, le social n'est rien ». « Que serait l'homme sans la société ? », objecte le fondateur de l'École française de sociologie. Pour l'un, le rapport interpersonnel est caractérisé par l'immédiateté et l'asymétrie ; il est, chez l'autre, médiatisé par une règle : la réciprocité. Toujours ouvert, ce débat atteste la difficile naissance de la psychologie sociale en France et illustre les vicissitudes de l'idée d'interaction qui, méconnue par Comte mais généralisée par Cournot, occupe une place centrale dans l'œuvre de Tarde.
Psychologie et statistique
Lorsqu'en 1886 Tarde publie son premier ouvrage, Criminalité comparée, les fondements de ce qu'il devait appeler l'interpsychologie sont déjà mis en place. Les thèmes majeurs auxquels s'est appliquée sa pensée ont mûri tout au long de la décennie précédente dans ce Périgord noir où s'est déroulée, partagée entre Sarlat, sa ville natale, et le manoir familial de la Roque-Gageac, une enfance marquée par de graves troubles oculaires et de fréquentes crises de mysticisme. Ils témoignent, dans leurs reformulations successives, de l'influence décisive exercée par quelques œuvres longuement méditées après des lectures écourtées : celles de Leibniz, de Hegel, de Cournot surtout.
Aussi bien, ni la formation juridique de Tarde, ni sa carrière de magistrat – juge suppléant à Sarlat en 1869, il y exerça de 1875 à 1894 les fonctions de juge d'instruction –, ni les nombreuses études de criminologie notamment publiées dans les Archives d'anthropologie criminelle, dont Lacassagne lui confia en 1893 la co-direction, ne doivent masquer la nature et l'orientation de ses plus constants intérêts. Ils se laissent clairement voir dans les titres des articles de la Revue de philosophie, que Ribot lui ouvrit dès 1880 : « Les Traits communs de la nature et de l'histoire » (1882), « L'Archéologie et la statistique », « Qu'est-ce qu'une société ? » (1884) ; chacun de ces textes forme d'ailleurs la substance d'un chapitre des Lois de l'imitation (1890), « La Psychologie en économie politique » trouvant son point d'aboutissement dans l'ultime synthèse consacrée à la Psychologie économique (1902).
Qu'il s'agisse de formes normales ou de formes pathologiques de l'existence sociale, d'actes individuels ou de phénomènes collectifs, le souci d'introduire le nombre et la mesure dans leur analyse est d'emblée manifeste. Deux termes sont associés à cette exigence méthodologique. Ils jalonnent toute l'œuvre de Tarde et donnent son titre à sa première contribution à l'histoire des idées : La Croyance et le Désir (1880).
Elle s'ouvre sur une critique de l'arithmétique morale de Jeremy Bentham, de la théorie psychophysique de Gustav Fechner et du calcul des probabilités. L'impossibilité, d'une part, de généraliser le fameux algorithme des sensations, d'autre part, de dépasser le seuil de la crédibilité ou de la désirabilité au moyen de raisons mathématiques de croire et de désirer n'a pas détourné Tarde de chercher à établir une métrique des quantités subjectives. Elle l'a, au contraire, amené à souligner la portée logique et psychologique des termes en question : la croyance, pôle du religieux et du scientifique, et le désir, source de la morale et de l'économie, représentent, en effet, deux énergies mentales, qui, mesurables et comparables, permettent d'envisager la constitution d'une logique sociale. Il sera par la suite indiqué qu'à la différence de la statistique ordinaire la « statistique psychologique » n'a pas seulement à compter. Au-delà du simple dénombrement d'actions similaires, elle doit, par la construction de séries, la comparaison des variations concomitantes, la détermination de liaisons fonctionnelles entre le manifeste et l'inobservable, mesurer et aussi peser les croyances et les désirs qui sont au principe des choix et des décisions.
Les travaux de criminologie recueillis dans l'ouvrage de 1886, auxquels viendront s'ajouter en 1890 la Philosophie pénale et en 1892 les Études pénales et sociales, éclairent parfaitement les raisons de cette orientation méthodologique. La polémique que Tarde y poursuit avec Lombroso au sujet de l'uomo deliquente, avec Sighele à propos de l'antériorité de ses idées sur la psychologie des foules, avec les principaux théoriciens de la scuola positiva sur l'origine sociale du crime, la part des facteurs physiques, la thèse classique de la responsabilité personnelle n'est certes pas sans intérêt. Ainsi soutient-il, une dizaine d'années avant que Durkheim n'expose son point de vue sur le normal et le pathologique, « qu'il n'est pas vrai que le crime, même réduit à un minimum numérique soi-disant irréductible, ait été placé dès l'origine parmi les forces éternelles ». L'essentiel réside cependant ici dans l'affirmation qu'on ne peut mettre en évidence une cause sociale que si on l'observe effectivement à l'œuvre, ce qui a conduit Tarde à substituer à l'étude des corrélations ordinaires celle des processus.
La causalité intemporelle n'a, en effet, guère intéressé ce magistrat appliqué à améliorer le traitement de l'infraction par l'appareil judiciaire, peu satisfait de l'enregistrement, sans égard aux mobiles, des données de la criminalité et plus soucieux de mesurer des attitudes que de comptabiliser des actes. Aussi a-t-il prêté moins d'attention aux constantes, aux « plateaux statistiques » de Quetelet qu'aux séries temporelles. L'explication de la baisse du taux d'acquittement aux assises « par l'adaptation de la magistrature au jury » ou celle qui est avancée de la décroissance des appels interjetés par le ministère public par le seul fait que « les magistrats du parquet prennent exemple les uns sur les autres » montrent suffisamment que l'analyse des processus imitatifs s'est soutenue chez Tarde de toutes les ressources de la « statistique psychologique ». Les phénomènes individuels n'expliquent-ils pas les tendances temporelles ? Et les séries statistiques ne manifestent-elles pas le pouvoir de l'imitation ?
Si l'on additionne les actions du même genre que les individus accomplissent isolément, sans se copier, on aboutit toujours « à des chiffres qui ne varient pour ainsi dire pas d'une période à l'autre ». Mais la force sociale par excellence est l'imitation, comme la réalité sociale est l'apparence. Une note de La Statistique criminelle du dernier demi-siècle (où il est déjà posé que la civilisation est un rayonnement imitatif complexe) nous avertit que c'est là une vérité qui doit être tenue pour l'un des fondements de la science sociale. Cette dernière ne pouvait donc être ni conçue comme une « physique » ni envisagée du point de vue organiciste adopté par Worms et De Greef. Une légalité d'ordre psychologique remplaçait, en ce domaine, la légalité biologique ou mécanique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard VALADE
: professeur à l'université de Paris-V-Sorbonne, secrétaire général de
L'Année sociologique
Classification
Autres références
-
ACTION COLLECTIVE
- Écrit par Éric LETONTURIER
- 1 466 mots
...hypnotique sur des êtres qui, ayant perdu toute individualité, s'influencent mutuellement. Ramenant l'ensemble de la vie sociale à des processus d'imitation, Gabriel Tarde (L'Opinion et la foule, 1901) explique les comportements collectifs et la constitution homogène des publics par la réponse automatique... -
CAUSALITÉ
- Écrit par Raymond BOUDON , Marie GAUTIER et Bertrand SAINT-SERNIN
- 12 990 mots
- 3 médias
...un autre fait social, il prend simultanément position contre deux écoles, le positivisme italien de Lombroso et Ferri, d'une part, le psychologisme de Tarde, d'autre part. Au premier, il reproche de ramener les phénomènes sociaux à des phénomènes naturels et montre que la prétendue influence des causes... -
CRIMINOLOGIE
- Écrit par Jacques LÉAUTÉ
- 8 856 mots
- 1 média
...insistèrent à tel point sur l'action de l'environnement qu'on appelle encore « école du milieu social » leur école. L'un des plus connus d'entre eux, Gabriel de Tarde (1843-1904), était persuadé que l'imitation tenait une place très grande dans l'adoption des conduites humaines. Il insista sur l'importance... -
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes
- Écrit par Henri GUITTON
- 6 479 mots
...à ce niveau, elle dépend des goûts, des désirs, des préférences des sujets individuels, autant de relations qui impliquent une étude psychologique. G. Tarde s'est spécialisé dans ce genre d'étude (1904) : il a mis en valeur le thème de l'imitation, qui explique beaucoup de phénomènes économiques, notamment... - Afficher les 9 références
Voir aussi