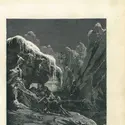GÉOLOGIE Géologie de l'ingénieur
Article modifié le
Méthodes
La géologie de l'ingénieur consiste d'abord en une série de reconnaissances exhaustives : on tient compte de toutes les particularités naturelles ou anthropiques du sol et du sous-sol, des multiples sujétions inhérentes à un projet donné, des répercussions des travaux sur les conditions préexistantes. Les observations naturalistes s'effectuent avec la rigueur scientifique nécessaire à une analyse qualitative poussée, mais leur échelle, leur densité, leur caractère quantitatif sont souvent fixés par le type d'ouvrage à réaliser.
Ce travail exige la création d'une équipe interdisciplinaire en relation avec les ingénieurs de projet et d'exécution, sans lesquels le choix des éléments à mettre en évidence risque d'être inexact ou incomplet. L'obligation de respecter les délais et les budgets, et de parler une langue commune, renforce encore cette tendance interdisciplinaire. On commence par dresser collégialement l'inventaire de la documentation disponible, des faits à relever, des paramètres à déterminer et des modalités de recherches utilisables ; puis, on décide du choix des essais à réaliser et on procède à l'échantillonnage aux endroits requis ; enfin on obtient les données exigées par des recherches croisées qui assurent un contrôle mutuel de ces données. L'interprétation en commun des résultats ne marque pas le terme d'une collaboration qui se maintient au cours de l'exécution et même à l'occasion de contrôles ultérieurs.
Les procédés mis en œuvre, qui ne cessent de se multiplier, sont de plus en plus élaborés et complémentaires. Par exemple, en région karstique, la prospection géophysique utilise concurremment les méthodes sismique, gravimétrique, électrique, magnéto-électrique, et l'on fait appel à toute une gamme de procédés depuis la photogéologie et ses perfectionnements (infrarouge, par exemple), les diagraphies variées (sondages : sonic, gamma-gamma, gamma-neutron, mesures de résistivités...), etc. jusqu'à l'auscultation acoustique ou l'enregistrement aéroporté de l'intensité du flux thermique à la surface du sol.
Les études de géologie de l'ingénieur ont pour objectif de réaliser l'adaptation optimale à la situation réelle d'un grand site ou d'une région d'une œuvre humaine telle que grands travaux de génie civil, aménagement du territoire, prévention de risques géologiques. L'expérience a montré que de la qualité de cette adaptation dépendent l'efficacité, l'économie et la sécurité, c'est-à-dire finalement la « faisabilité » d'une entreprise. On s'efforce, malgré l'intervention simultanée de nombreux paramètres interdépendants, d'atteindre, par des investigations pluridisciplinaires d'une précision accrue, un niveau correspondant aux progrès des essais et des méthodes du génie civil et aux impératifs techniques et socio-économiques de notre époque.
Dans cette voie, la géologie urbaine utilise toutes les méthodes de prospection du sous-sol, et la géologie de l'environnement s'intègre dans l'examen des systèmes naturels, complexes et solidaires, et s'attache à prévoir l'évolution des phénomènes et des œuvres humaines susceptibles d'en modifier le cours.
Outre les progrès répercutés par les disciplines sollicitées, la géologie de l'ingénieur doit répondre aux exigences vitales de la société industrielle : expansion démographique, urbanisation explosive, travaux d'infrastructure, consommation des ressources minérales et énergétiques non renouvelables ou vulnérables (eau) interfèrent de plus en plus avec la sécurité, la qualité de la vie... Populations et gouvernements sont, d'autre part, davantage préoccupés par les risques géologiques : les accidents survenant aux barrages sont en effet le plus souvent imputables à une connaissance insuffisante ou erronée des conditions géologiques et des modifications introduites par l'exécution des travaux ; l'implantation de centrales nucléaires impose de déterminer à l'échelle régionale l'existence de failles actives ou, mieux, de failles „capables“, c'est-à-dire ayant provoqué des mouvements superficiels une fois depuis 35 000 ans, ou plusieurs fois depuis 500 000 ans, et dès lors supposées capables d'en produire de nouveaux pendant la durée de vie de l'ouvrage. On pourrait multiplier les exemples : stockage aérien de stériles (terrils, crassiers, etc.) instables ou générateurs de pollution, stockage souterrain de matières utiles à maintenir intactes, mais aussi de produits résiduels encombrants, toxiques, etc.
À côté de la promotion du travail d'équipe et des échanges internationaux, de grandes enquêtes ont été entreprises à l'échelle mondiale : classification des matériaux minéraux, de construction et industriels ; problèmes de géologie de l'ingénieur en régions karstiques ; déplacements de terrains en masse ; comportement des argiles sensibles ; géotechnique et planification urbaines ; stockage des résidus urbains, industriels et radioactifs ;comparaison des méthodes d'enseignement de la géologie de l'ingénieur élaborées dans les universités des pays industrialisés et des pays en voie de développement. Les investigations couvrent l'éventail complet des actions anthropiques éclairant le rôle, souvent déterminant, de l'eau : exhaure dans les zones minières, rabattement des nappes aquifères par pompage et captage, dissolutions et subsidences provoquées, conséquences d'injections dans le sous-sol, imperméabilisation de la surface du sol, modifications des circulations d'eaux souterraines, détection d'exploitations et de cavités anciennes, etc.
Il en résulte une influence croissante de la géologie de l'ingénieur dans l'examen des problèmes, dont les conséquences socio-économiques doivent orienter les décisions officielles. Pour des ressources de faible valeur intrinsèque, l'exploitabilité est précaire et l'exploitation de ressources même de grande valeur ne peut se justifier que si la sécurité est garantie. Des intérêts contradictoires se trouvent ainsi confrontés : faut-il interdire l'extraction de graviers dans tel gisement qui constitue un réservoir aquifère ? Comment prévoir l'utilisation d'un site à divers usages débouchant sur une restauration valable ?
Les mêmes tendances apparaissent dans la plupart des pays. Dans la détermination des relations entre caractéristiques géologiques et propriétés à considérer en géologie de l'ingénieur, les investigations s'étendent de l'échelle du cristal ou du grain à celle de l'agrégat puis à celle des massifs hétérogènes et discontinus. Cette approche réduit considérablement la dispersion des résultats expérimentaux. Les analyses structurales s'attachent à la mésotectonique et à la microtectonique : on définit les étapes successives de la déformation interne et externe des roches, et les phénomènes à considérer dans les procédés de soutènement et de consolidation. Les nappes aquifères de fissures font l'objet d'études particulières : pour ces nappes, on a signalé des rabattements de grande extension provoqués par des ouvrages souterrains, l'assèchement du réseau hydrographique, des risques de pollution élevés et la nécessité de maintenir des zones de protection étendues.
La collecte et la diffusion des résultats nécessitent une collaboration étroite entre géologues, géotechniciens et informaticiens pour l'élaboration de banques de données, de cartes géotechniques et de cartes prévisionnelles. D'une manière générale, les recherches propres à la géologie de l'ingénieur lui permettent d'offrir une ample moisson de données aux diverses sciences géologiques dont elle est issue et dont elle demeure solidaire.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Léon CALEMBERT : professeur émérite de l'université de Liège, membre honoraire de l'Académie royale des sciences d'outre-mer
Classification
Autres références
-
TERRE - Planète Terre
- Écrit par Jean AUBOUIN et Jean KOVALEVSKY
- 9 232 mots
- 10 médias
La densité des roches superficielles, égale à 2,7, très différente de celle de la Terre dans son ensemble, égale à 5,52, a conduit à conjecturer une composition variant avec la profondeur. En combinant la nature surtout granitique des roches de surface, celle, surtout basaltique, des roches issues... -
ACTUALISME ET CATASTROPHISME
- Écrit par Florence DANIEL
- 2 440 mots
- 1 média
La géologie est une science qui a pour objet l'étude de la Terre et de son histoire. La reconstitution du passé de notre globe nécessite, à partir de l'étude de traces anciennes, l'élaboration d'hypothèses qui sont notamment fondées sur le principe des causes actuelles....
-
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
...coquillages ou poissons se pétrifiaient et d’énoncer qu’ils le faisaient au sein de sédiments déposés horizontalement au fond des lacs et des mers. Et l’empilement de leurs strates révélait l’ordre de leur dépôt, reconnut Sténon en marquant véritablement la naissance de la géologie : reconstituer le... -
ÂGE ET PÉRIODE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 1 958 mots
...terrasses alluviales de la Somme, de nombreux outils de silex prouvant la très grande ancienneté de l'homme (plusieurs centaines de milliers d'années). Ainsi, l'émergence de la préhistoire s'effectue de concert avec celle de la géologie, de ses strates, de ses fossiles, et donc de ses ères successives... - Afficher les 62 références
Voir aussi