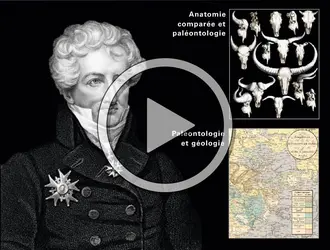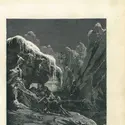GÉOLOGIE Histoire
Article modifié le
Le XVIIe siècle et les théories de la Terre jusqu'en 1729
La mentalité change complètement dès le début du xviie siècle. La doctrine mécaniste dévalorise la Nature. L'étude du contenu du sous-sol est au plus bas jusque vers 1660 (et en France jusqu'en 1710). Durant la première moitié du siècle, un seul auteur majeur est à signaler : il s'agit de Descartes, avec ses Principia philosophiae (1644). Il échafaude une cosmogonie d'une grande audace, dont le livre IV final est consacré à la genèse du globe terrestre : il voit les éléments s'assembler en sphères concentriques. Vers la fin, une croûte externe s'est formée, en situation instable puisque séparée des sphères internes par une zone d'eau et d'air ; elle s'effondre ; ses fragments, à l'étroit, reposent parfois à plat sur la croûte interne (mers et plaines), parfois en s'arc-boutant mutuellement (montagnes). Ainsi, la configuration actuelle de la Terre est née des hasards d'une catastrophe inscrite dans la logique du développement cosmogonique antérieur. La Terre, ancien astre éteint, enferme en son cœur central une matière de feu, sans action sur les zones plus externes.
Il n'en est pas de même dans le Mundus subterraneus, le monde souterrain tel que le voit le père jésuite Athanasius Kircher (1602-1680). Paru en 1665, cet énorme ouvrage à caractère d'encyclopédie postule un feu central relié par des canaux à des poches ignées plus superficielles, et de là aux volcans. De même, des réservoirs d'eau profonde sont reliés à la surface par des canaux, qui relient entre elles certaines mers et alimentent en eau marine dessalée les sources des montagnes (une très vieille et tenace théorie). Pierre Perrault (1611-1680) démontre en 1674 que les pluies suffisent à les expliquer (la controverse datait des Gréco-Romains).
Le Danois Niels Stensen (Nicolas Sténon, 1638-1686), anatomiste réputé, publie en 1669 le Prodromus d'une dissertation « Sur un solide contenu naturellement dans un solide ». Ce court ouvrage pose de façon géniale les bases définitives de la géologie moderne, fondée sur une rigoureuse axiomatique. Il introduit les termes et les concepts clés de « strates » dues à l'accumulation de « sédiments ». Posant en principe que tout solide est issu d'un fluide, il en déduit que les strates du sous-sol : se sont déposées en superposition l'une sur l'autre successivement ; lors de leur dépôt étaient subhorizontales ; étaient continues en extension latérale. Et donc, leur tranche mise à nu implique une rupture ou une ablation ; leur situation inclinée implique un dérangement, lequel est la cause des montagnes. Sténon écrit de plus des pages remarquables sur la croissance des cristaux. Il applique enfin, à l'échelle régionale, la règle par lui posée, à savoir que c'est dans l'objet, le corps lui-même, que l'on trouve les circonstances de sa genèse ; il reconstitue ainsi l'histoire passée d'une partie de la Toscane, en retrouvant l'acuité de Léonard de Vinci. Il y distingue, d'une part, les montagnes anciennes, faites de strates rocheuses sans fossiles, d'autre part, les « collines » récentes, terreuses, encaissées dans des vallées d'effondrement (pour nous, des grabens néogènes dans les nappes toscanes). L'analyse seule du terrain dévoile son histoire passée.
En 1660 en Angleterre, la fondation de la Royal Society, qui entend mettre en œuvre les préceptes de Francis Bacon, inaugure un très actif mouvement scientifique, notamment en géologie. Robert Hooke (1635-1702), savant polyvalent, émet en 1668 et ultérieurement, lui aussi, de remarquables idées sur la Terre. Les terres et les mers changent de place ; les fossiles sont comme des médailles qui pourraient dater le passé ; les êtres vivants ont pu évoluer. Mais l'œuvre géologique de ce grand pionnier n'a été publiée qu'en 1705, et peu remarquée. D'actives recherches sur le terrain sont menées à bien : Martin Lister (1638 ? – 1712) et Edward Lhwyd (1660-1709), notamment, collectionnent et figurent de nombreux fossiles, étudiés avec rigueur, avec pour conclusion étonnante que, vue leur dissemblance d'avec les formes modernes, ce ne sont pas d'anciens organismes marins.
À côté de ces naturalistes éminents, attachés à la description minutieuse du réel, à la fin du siècle fleurissent d'aventureuses théories de la Terre. Leur ambition est de construire, à l'instar de Descartes, mais calquée étroitement sur les textes bibliques pris à la lettre, une histoire de la formation du globe terrestre. Ces théories sont diluvianistes, en ce sens qu'elles font jouer au Déluge de Noé un rôle gigantesque, bouleversant complètement toute la partie externe de la Terre. Thomas Burnet (1635-1715) obtient un grand succès avec sa Theory of the Earth (1681 et 1689 en latin ; 1684 et 1690 en anglais), qui romance de façon pieuse le schéma de Descartes, en identifiant au Déluge l'effondrement de la croûte externe. William Whiston (1667-1752) publie en 1696 A New Theory of the Earth pour faire pièce à Burnet ; astronome, il met en œuvre de façon fort ingénieuse une comète pour expliquer le Déluge. À l'opposé des deux précédents, nullement géologues, John Woodward (1665-1728) est un observateur infatigable et de grand mérite. Mieux encore que Lister, il constate le fait d'une liaison régionale entre les fossiles et les types de roches du sol anglais ; il croit avoir découvert une corrélation entre leurs poids spécifiques respectifs. L'explication qu'il en donne est qu'au moment du Déluge les anciennes terres ont été liquéfiées en une boue confuse ; celle-ci s'est sédimentée en masse par ordre de densité en même temps que les dépouilles des organismes. L'influence de Woodward a été considérable : après lui, la croyance aux fossiles, jeux de la nature, est abandonnée.
Des protestants suisses prennent le relais au début du siècle suivant. Il s'agit, tout d'abord, des frères Scheuchzer. L'aîné, Johann Jacob (1672-1733), a publié de nombreux ouvrages où il s'attache à décrire la géographie physique de la Suisse, mais aussi ses fossiles, en naturaliste de grand mérite (nombreuses planches d'ammonites, etc.). Son frère cadet Johann (1684-1738) est le vrai pionnier de la tectonique des Alpes. Il observe, comprend et dessine admirablement les contorsions des couches, notamment celles des versants du lac des Quatre-Cantons (1708, publication en 1716-1718 par son frère). Il introduit en science le fait du plissement, en disciple intelligent de Sténon. Qu'il ait adopté les vues de Woodward est peu important (dislocation régionalement inégale des couches à la fin du Déluge, en fonction de leur solidité, la cause étant inexplicable). En 1729, Louis Bourguet (1678-1742) insère dans ses Lettres philosophiques un abrégé de sa théorie de la Terre, également fondée sur l'idée de Woodward, mais avec d'intéressantes corrections : la pile des nouvelles couches s'est formée de façon diversifiée par le remaniement des produits de l'ablation successive des constituants de l'ancienne Terre : vision pleine d'avenir, dès lors que l'on se libérait de la contrainte du temps court biblique. De plus, il cherche à rendre compte de façon rationnelle de la formation des chaînes de montagnes : à la fin du Déluge, elles sont nées de façon coordonnée par suite de l'accélération de la rotation de la Terre, leur matière formant comme des ondes et recevant une « direction d'élévation ». Les grandes synthèses des diluvianistes, derrière leur absurdité apparente si souvent tournée en ridicule, comportaient nombre d'acquis positifs concrets et d'intuitions trop méconnues. Le xviiie siècle, en les rejetant, a volontiers évacué du même coup le cycle sédimentaire et l'orogenèse. La leçon à en tirer est que notre premier devoir est d'adopter une attitude de respect envers nos devanciers. Comprendre, avant de juger. La dérision abaisse l'historien. Et c'est une historiographie mutilée que celle qui se polarise exagérément sur les théories et systèmes abstraits.
Le grand Leibniz élabore vers 1690 une théorie de la formation de la Terre, intitulée Protogaea, mais n'en publie qu'un court résumé (1693 ; le texte complet ne paraît qu'en 1749), néanmoins fort influent. La Terre est un ancien corps incandescent ; le lessivage de la masse initiale à base de verre engendre les mers, qui se peuplent d'organismes. Des cavités souterraines s'effondrent, d'où le basculement et l'émersion de couches sédimentaires riches en fossiles, organismes marins naturels. Leibniz semble accepter l'évolution des espèces. À l'origine ignée près, son système, avec ses cavités, prévaudra durant un bon siècle. La Protogée au complet influencera grandement le Buffon des Époques. Déjà, en 1715 et 1721, Antonio Vallisnieri (1661-1730) avait choisi, contre Woodward, l'idée d'un séjour naturel et d'un abaissement lent de la mer, en s'appuyant sur Leibniz.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François ELLENBERGER : professeur émérite à l'université de Paris-Sud
Classification
Médias
Autres références
-
TERRE - Planète Terre
- Écrit par Jean AUBOUIN et Jean KOVALEVSKY
- 9 232 mots
- 10 médias
La densité des roches superficielles, égale à 2,7, très différente de celle de la Terre dans son ensemble, égale à 5,52, a conduit à conjecturer une composition variant avec la profondeur. En combinant la nature surtout granitique des roches de surface, celle, surtout basaltique, des roches issues... -
ACTUALISME ET CATASTROPHISME
- Écrit par Florence DANIEL
- 2 440 mots
- 1 média
La géologie est une science qui a pour objet l'étude de la Terre et de son histoire. La reconstitution du passé de notre globe nécessite, à partir de l'étude de traces anciennes, l'élaboration d'hypothèses qui sont notamment fondées sur le principe des causes actuelles....
-
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
...coquillages ou poissons se pétrifiaient et d’énoncer qu’ils le faisaient au sein de sédiments déposés horizontalement au fond des lacs et des mers. Et l’empilement de leurs strates révélait l’ordre de leur dépôt, reconnut Sténon en marquant véritablement la naissance de la géologie : reconstituer le... -
ÂGE ET PÉRIODE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 1 958 mots
...terrasses alluviales de la Somme, de nombreux outils de silex prouvant la très grande ancienneté de l'homme (plusieurs centaines de milliers d'années). Ainsi, l'émergence de la préhistoire s'effectue de concert avec celle de la géologie, de ses strates, de ses fossiles, et donc de ses ères successives... - Afficher les 62 références
Voir aussi
- ARDUINO GIOVANNI (1714-1795)
- BOULANGER NICOLAS ANTOINE (1722-1759)
- BOURGUET LOUIS (1678-1742)
- BURNET THOMAS (1635-1715)
- DILUVIANISME
- FÜCHSEL GEORG CHRISTIAN (1722-1773)
- GAUTIER HENRI (1660-1737)
- GÉOGNOSIE
- MAILLET BENOÎT DE (1656-1738)
- NEPTUNISME
- SCHEUCHZER JOHANN (1684-1738)
- SCHEUCHZER JOHANN JACOB (1672-1733)
- WOODWARD JOHN (1667-1752)
- GUETTARD JEAN ÉTIENNE (1715-1786)
- GIRAUD-SOULAVIE abbé (1752-1813)
- ÉROSION CYCLE D'
- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES
- GLACIATIONS QUATERNAIRES
- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.
- JUSSIEU ANTOINE LAURENT DE (1748-1836)
- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- OROGENÈSE
- SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE (SGF)
- ISLAM SCIENCES DE L'
- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance
- PLUTONISME
- LITHOLOGIE
- PÉTROGRAPHIE
- COUCHES ou STRATES, géologie
- SMITH WILLIAM (1769-1839)
- GÉOLOGIQUES CARTES
- NAPPES DE CHARRIAGE
- LITHOSTRATIGRAPHIE
- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA
- SCIENCES HISTOIRE DES