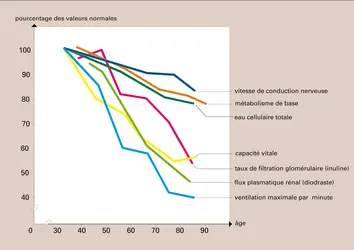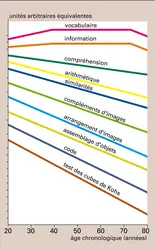GÉRONTOLOGIE
Article modifié le
Gérontologie sociale
La gérontologie sociale étudie les causes du vieillissement des populations et ses conséquences économiques, psychologiques et sociales, tant au niveau des groupes humains qu'au niveau des individus, pendant la seconde moitié de leur existence. La condition matérielle et morale, le statut social, le rôle, l'influence des individus vieillissants ou âgés, la transformation de ces aspects, l'adaptation des individus et de la société à cette transformation, sont les principaux sujets d'étude de cette branche des sciences humaines, dont les premiers travaux systématiques remontent, tant en Europe qu'aux États-Unis, à la décennie 1930-1940 ; l'expression de « gérontologie sociale » apparaît en 1954, sous la plume de C. Tibbits.
L'accroissement de la proportion des personnes âgées (vieillissement démographique), accompagné à un rythme différent par l'accroissement de leur nombre, soulève des problèmes dont l'ampleur et la complexité sont encore mal perçues du grand public, mais dont l'étude se développe rapidement depuis la guerre grâce à l'action d'universités, d'instituts, de fondations spécialisées, ainsi qu'à l'impulsion des organisations internationales et de l'Association internationale de gérontologie. Dans les pays à fort degré de vieillissement, les gouvernements se tournent de plus en plus vers les chercheurs de cette discipline afin de leur demander les éléments dont ils ont besoin pour asseoir leur politique de la vieillesse.
L'apparition puis l'extension d'une nouvelle catégorie sociale, les retraités, entraîne un nouvel examen de la place du travail et des loisirs dans la vie de l'homme, dans le système des valeurs et dans l'organisation économique.
Démographie et vieillissement
La proportion des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus dans les pays industrialisés, qui est de 14 p. 100 en 1990, est estimée à 22 p. 100 en 2040. L'I.N.S.E.E. prévoit qu'elle atteindra, en France, 26 p. 100 de la population à cette date. Ces modifications démographiques sont dues à l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance et, surtout, à l'âge adulte et à la diminution ou à la stagnation de la fécondité dans les pays industrialisés. La France apporte une caution historique : sa population a « vieilli » avant toute autre population européenne ; dans les années cinquante, la France enregistrait le plus fort degré de vieillissement avant d'être rejointe par des pays comme l'Angleterre où la limitation des naissances remonte seulement à la fin du xixe siècle. En revanche, les Pays-Bas, où pourtant l'espérance de vie à la naissance était sensiblement plus forte qu'en France, avaient une population beaucoup plus « jeune ».
Les progrès indéniables de la médecine, de l'hygiène et du niveau de vie ont évidemment augmenté les effectifs âgés et l'on note même une augmentation rapide des effectifs très âgés (au-delà de 80 ans) qui posent déjà des problèmes sociaux particuliers.
Les personnes âgées dans la société
Dans l'Antiquité, comme aujourd'hui encore dans de nombreuses sociétés agricoles ou pastorales du Tiers Monde, le groupe des anciens jouissait d'un respect qui tenait, en partie, au fait qu'il était peu nombreux (on pouvait attribuer la longévité exceptionnelle à la protection des dieux), ainsi qu'à son rôle de dépositaire et de transmetteur de la tradition et des connaissances techniques. L'évolution démographique de ce siècle mit fin à cette situation déjà secouée par les découvertes scientifiques et techniques, dont la succession accélérée jetait de plus en plus le discrédit sur le recours à l'expérience.
La transformation démographique et sociologique de la famille se répercute sur le statut des grands-parents comme sur les rapports entre générations. Elle a aussi comme conséquence directe de transférer à la société la majeure partie de la charge économique de la population âgée inactive. Ce transfert est d'autant plus nécessaire qu'une forte proportion de personnes âgées n'ont pas ou n'ont plus d'enfants ; le contraste entre les citadins qui sont dans ce cas et les ruraux indique bien que l'on a affaire à deux modes de vie assez différents. En outre, il se peut, comme en France, qu'un nombre restreint d'adultes aient à la fois des parents âgés et un peu plus d'enfants que la génération précédente, ce qui était le cas en France entre 1946 et 1966. Les systèmes de retraite assurent (ou devraient assurer) l'indépendance économique mais ils desserrent aussi les liens directs entre les générations : la qualité de ceux qui subsistent devrait s'en trouver améliorée, mais ce n'est pas une certitude.
La mobilité professionnelle (les adultes travaillent de moins en moins avec, ou pour, leurs parents) et la mobilité géographique limitent et parfois suppriment l'une des principales sources d'autorité de ces derniers qui, ainsi, ne peuvent même plus invoquer leur expérience professionnelle ou le partage des risques de l'entreprise.
Dans une société qui met l'accent sur le travail et la réussite matérielle, « le rôle de retraité, c'est de n'en plus avoir » (E. Burgess). On a même parlé d'un phénomène de « rejet » qui contribue à renforcer chez l'individu le sentiment, fondé ou non, de son inutilité sociale. Ce sentiment le pousse à fréquenter souvent des contemporains avec qui il a des points communs (l'ancien métier, la guerre, les souvenirs locaux...) et encourage une attitude de repli qui nuit à une bonne adaptation.
Ce passage de la situation d'actif à celle de retraité sera d'autant plus difficile que le travail antérieur aura été intéressant et intensif et que la transition aura été brutale. On a souvent parlé d'une surmortalité au cours de l'année ou des deux années qui suivent la mise à la retraite, mais, malgré l'intérêt du sujet, aucune étude scientifique n'a encore vérifié la réalité de ce phénomène ni la liaison de cause à effet ainsi avancée. Une réduction progressive de l'activité professionnelle paraît souhaitable, de même que son remplacement par une occupation conforme aux goûts et aux dispositions de l'intéressé. Dans nos sociétés complexes, les possibilités d'une participation utile sont nombreuses et méritent une exploration systématique. Pour être couronnée de succès, cette formule appelle une préparation à la retraite dont certains organismes se sont préoccupés, notamment en Angleterre.
En étudiant l'individu, membre du corps social, les gérontologues soulignent les modifications souvent insidieuses qu'entraîne le vieillissement. En effet, la transformation du rôle commence bien avant le cap des soixante-cinq ans. Comme parents, comme travailleurs, comme conjoints, comme amis même, les personnes qui dépassent quarante-cinq à cinquante ans voient diminuer leur rôle (ou l'idée qu'ils en ont), leurs revenus, leur mobilité, leurs espérances et le domaine de leurs relations : ce phénomène peut être précoce dans le cas des personnes de santé fragile ou souffrant de handicaps physiques.
Cette évolution du comportement est à l'origine de la théorie du « désengagement » (E. Cumming, W. Henry), selon laquelle l'homme vieillissant restreint progressivement, plus ou moins consciemment, ses rapports avec la société et réciproquement. De nombreux auteurs, mentionnés par M. Philibert (G. Cabanis, E. Parker, E. Erikson, R. Guardini), ont proposé des calendriers, des étapes. Certains situent à la cinquantaine la maturité mentale (changements dans les responsabilités, libération des rivalités), à la soixantaine une seconde maturité (difficultés d'intégration personnelle : les pertes commencent à l'emporter sur les gains) ; ils n'appellent vieillesse que le déclin généralisé. De telles recherches ont pour but d'offrir une trame qui permette de mesurer le degré d'adaptation, mais elles n'ont guère dépassé le stade de la réflexion. L'intégration ou la ségrégation sociales des personnes âgées est précisément l'une des questions cruciales que se posent les gérontologues. C'est aussi un élément déterminant pour guider l'action dans ce domaine et choisir ses modalités. Cependant, bien des affirmations répétées çà et là appelleraient des confirmations. Par exemple, H. Friis se demande si des rapports sociaux plus intenses entretenus avec un nombre restreint de gens ne remplacent pas – et avantageusement parfois – les relations extensives de la vie adulte.
La société et les personnes âgées
Comment la société s'adapte-t-elle à son propre vieillissement ? Le contraste est grand entre le petit nombre qui, détenant soit le pouvoir, soit la fortune, fait courir un risque de gérontocratie, et la grande masse de personnes âgées qui, inactives et dotées de moyens modestes, sont réduites à une condition passive. Leur nombre a pourtant des conséquences économiques, financières et sociales. L'importance des « transferts sociaux » entre actifs adultes et inactifs âgés a certes une base démographique, mais elle dépend aussi de l'histoire sociale : tel avantage accordé antérieurement pour résoudre une crise peut, de longues années après, peser d'un poids singulier sur l'ensemble de l'économie. Bien souvent, l'engagement pris aux dépens des générations suivantes n'a tenu compte ni des modifications de la technique, ni de l'évolution différentielle de la longévité.
Par ailleurs, les institutions créées en faveur des personnes âgées, telles les caisses de retraite, disposent de capitaux considérables et, n'était le contrôle de l'État, elles pourraient influencer de façon excessive le marché financier. Le niveau des pensions servies a une incidence directe sur le niveau de la consommation d'une fraction notable de la population et, par conséquent, sur le volume de la demande de certains produits et services. À ce titre, l'étude des budgets de consommation des ménages âgés présente un intérêt indiscutable.
Enfin, l'allongement de la vie modifie le calendrier de transmission des biens (capitaux et entreprises) ; c'est particulièrement vrai en agriculture où l'âge moyen des exploitants s'élève d'autant plus que, du fait de l'exode agricole, la proportion et le nombre des jeunes adultes diminuent. C'est aussi la raison pour laquelle un nombre relativement limité des veuves peuvent, dans certains pays, détenir une part exceptionnellement élevée des capitaux privés. Cette évolution peut être positive dans la mesure où elle encourage les générations plus jeunes à ne pas faire dépendre leur niveau de vie d'une succession hypothétique.
Conditions de vie des personnes âgées
Les conditions de vie des personnes âgées sont, en général, très inférieures à celles du reste de la population. Le niveau de vie baisse de 30 à 50 p. 100 lors du passage à la retraite : cette baisse est d'autant plus ressentie que les besoins, réels ou subjectifs, ne diminuent pas à la même cadence. La forte proportion d'anciens travailleurs à qui il faut verser une aide sociale montre l'insuffisante couverture du risque « vieillesse ». Le développement des régimes de retraites complémentaires permet d'espérer une amélioration et montre, en tout cas, que les salariés admettent la nécessité d'un prélèvement plus fort sur leurs revenus pour s'assurer une vieillesse moins médiocre. Le thème de la « protection du niveau de vie » revient constamment dans les congrès de gérontologie comme dans les colloques de politique sociale.
L'activité, encore sensible entre soixante et soixante-cinq ans, procure quelques ressources, mais on note une baisse rapide des taux et si, pour des raisons psychologiques et économiques, il paraît souhaitable de ne pas décourager cette activité, il est préférable de ne pas fonder trop d'espoirs sur cette solution.
La détérioration de l'état de santé, liée à une progression de l'isolement, soumet le vieillard à un risque particulier. La rapidité de l'intervention en cas d'accident, la fréquence et la qualité des soins pendant une maladie courante peuvent diminuer de beaucoup le recours à l'hospitalisation, solution qui déclenche souvent un traumatisme psychologique. L'accroissement du nombre des grands vieillards et des « séniles » pose des problèmes ardus aux pouvoirs publics, ainsi qu'aux familles qui abritent un invalide ou un impotent. Les recherches sociales aident à dégager les facteurs psychologiques et sociologiques qui aggravent ou qui, au contraire, allègent cette situation ; elles aident aussi à tester la valeur des formules proposées.
Le logement présente un aspect positif : le sous-peuplement est plus fréquent chez les personnes âgées que chez les ménages adultes, par suite du départ des enfants. En revanche, l'entretien est mal assuré et les revenus ne permettent pas d'apporter les éléments de confort dont jouissent précisément les générations plus jeunes, de sorte que, trop souvent, les vieux ménages vivent mal dans un logement trop vaste et incommode, situé dans un immeuble ancien (à Paris, il y a encore des personnes âgées qui habitent au quatrième étage ou plus sans ascenseur). De ce fait, les contacts avec le monde extérieur sont restreints. Il semble heureusement que, dans une proportion élevée de cas (75 p. 100), un membre de la famille habite à proximité ou à courte distance et que, même dans les villes, s'établit une « intimité à distance » (L. Rosenmayr). L'attachement des personnes âgées au logement, est, en tout cas, une constante et il s'exprime avec netteté dans les enquêtes.
Si le troisième âge évoque l'idée de loisir, la réalité témoigne trop souvent d'un vide ou d'une attitude passive qui, pour partie, reflète une inadaptation, mais qui traduit aussi l'insuffisance des moyens mis à la disposition des millions d'utilisateurs potentiels. Les générations qui ont disposé durant leur vie active de peu de temps réellement libre et de peu de ressources pour transformer ce temps en loisirs sont fréquemment désemparées devant la liberté que procure la cessation du travail, d'autant que cette cessation les coupe de tout un milieu auquel elles étaient attachées. Faut-il y voir une des raisons de la surmortalité masculine ? Dans ce domaine, ceux qui ont pu, depuis longtemps, cultiver un passe-temps ou avoir une activité manuelle ou culturelle qui réponde à leurs goûts et à leurs dispositions s'adaptent mieux à la vieillesse que ceux qui, ayant trop axé leur vie sur leur travail, arrivent à cet âge sans autre centre d'intérêt.
En définitive, le vieillissement de la population pourrait bien être, comme l'affirme A. Sauvy, le phénomène contemporain le plus lourd de conséquences.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Claude BALIER : psychiatre des Hôpitaux, médecin-chef du Centre médico-psychologique régional, Maison d'arrêt de Varces (Isère)
- François BOURLIÈRE : professeur à la faculté de médecine de Paris.
- Martine DRUENNE-FERRY : diplômée de l'Institut de psychologie de Paris, responsable d'un centre de traitement de jour pour personnes âgées.
- Paul PAILLAT : docteur en droit, maître de recherche chef du département de démographie sociale à l'institut national d'études démographiques, conseiller scien- tifique de la fondation national gérontologie.
- Henri PÉQUIGNOT : professeur honoraire à la faculté de médecine de Paris, médecin honoraire des hôpitaux de Paris
Classification
Médias
Autres références
-
BUTLER ROBERT N. (1927-2010)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 334 mots
Psychiatre et gérontologue américain, Robert N. Butler forgea le terme « âgisme » pour décrire la discrimination que subissent les personnes âgées et fut l'un des premiers à tenter de mieux comprendre et soigner cette catégorie de patients. Il obligea le public à s'interroger sur le ...
-
DÉMENCE
- Écrit par Raymond ESCOUROLLE , Encyclopædia Universalis et Joël GREGOGNA
- 5 190 mots
Ladémence sénile est une régression globale et définitive des fonctions psychiques apparaissant après soixante-cinq ou soixante-dix ans. L'imprécision de cette définition, basée sur l'âge, est l'un des éléments de discussion nosologique. Cela est d'autant plus vrai que les lésions microscopiques... -
DÉSHYDRATATION, médecine
- Écrit par François BOURNÉRIAS
- 398 mots
On distingue trois grands types de déshydratation. La déshydratation globale, où la perte en eau et en sodium est proportionnelle, provoquée souvent par des pertes d'origine digestive : diarrhées, vomissements, fistules. Dans ce type de déshydratation, la natrémie est souvent peu modifiée....
-
PSYCHOLOGIE DÉVELOPPEMENTALE DU LIFESPAN
- Écrit par Patrick LEMAIRE
- 1 533 mots
La psychologie développementale du lifespan est cette partie de la psychologie qui cherche à comprendre comment les processus mentaux, les comportements et les performances des individus évoluent au cours de l’enfance et de la vie adulte. Elle poursuit cet objectif général en déterminant comment...
Voir aussi
- APTITUDE
- NATALITÉ
- ADAPTATION PSYCHOLOGIQUE
- NIVEAU DE VIE
- PSYCHOPATHOLOGIE
- VIEILLESSE
- SÉNESCENCE
- DÉLIRE
- SENSORIELS ORGANES
- PHYSIOLOGIE
- ÉCHELLE D'APPRÉCIATION, psychologie
- WECHSLER-BELLEVUE ÉCHELLE D'INTELLIGENCE DE
- LONGÉVITÉ
- GÉRIATRIE
- DÉPRESSIFS ÉTATS ou DÉPRESSIONS NERVEUSES
- ASSISTANCE SYSTÈMES D'
- RÔLES ET STATUTS SOCIAUX
- ADAPTATION BIOLOGIQUE
- ESPÉRANCE DE VIE
- TROISIÈME ÂGE
- CLASSES D'ÂGE, démographie
- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE
- FAMILLE SOCIOLOGIE DE LA
- VIEILLISSEMENT, démographie
- TROUBLES MENTAUX ou TROUBLES PSYCHIQUES