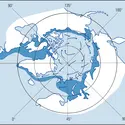GLACE
Article modifié le
Pétrographie des glaces de congélation
Congélation de l'eau douce
La congélation implique que les calories libérées soient évacuées, autrement dit que des frigories parviennent à l'interface eau-glace depuis un lieu plus froid. Si de l'eau douce est contenue dans un récipient refroidi, il se forme au départ de la glace contre les parois, avec des axes optiques perpendiculaires à la paroi. Si le froid vient du haut, la glace se forme à la surface libre, avec les axes optiques verticaux.
Mais en général la température de l'eau commence par s'abaisser en dessous du point de fusion. Lorsque cette surfusion cesse, ce qui se produit brusquement de façon irréversible, l'eau renferme un stock de frigories utilisable pour la congélation, et cela peut modifier la texture et la fabrique de la première glace formée. Ainsi de la pluie surfondue tombant sur une roche à température légèrement positive donne un verglas avec des axes optiques parallèles à la paroi. À la surface libre, l'eau surfondue congèle en formant de longues aiguilles, avec une orientation des axes optiques quelconque.
L'arrêt de la surfusion se produit autour de germes de congélation, poussières microscopiques qui sont actives à des températures plus ou moins basses. Dans les gouttelettes de certains nuages, l'absence de germes de congélation explique des surfusions intenses, pouvant s'approcher de − 40 0C. Au-delà survient toujours une congélation spontanée, dite homogène (cf. précipitations [météorologie]).
Bulles d'air autogènes
Après cette première phase, la congélation doit forcément se poursuivre grâce à un apport de frigories à travers la glace. Les sels et l'air dissous dans l'eau ne peuvent s'incorporer au réseau cristallin. Il apparaît donc des bulles d'air à l'interface glace-eau une fois la saturation de l'eau en air dépassée. L'eau saturée d'air à 0 0C et sous 1 atm renferme 2,85 p. 100 de son volume d'air (celui-ci étant mesuré sous les conditions normales).
Cela explique qu'au cœur des barreaux et cubes de glace artificielle qui a congelé en dernier, on trouve une glace très bulleuse. La composition de ces bulles n'est pas celle de l'air atmosphérique, mais celle de l'air dissous dans l'eau (34,9 p. 100 d'oxygène au lieu de 20,9 p. 100 ; 1,3 p. 100 de gaz carbonique au lieu de 0,03 p. 100).
Ces bulles d'air de la glace de congélation sont dites autogènes, par opposition aux bulles xénogènes de la glace de glacier ; lesquelles, provenant de l'air emprisonné dans le névé, ont la même composition que l'air atmosphérique. Les bulles autogènes ont le plus souvent une forme allongée, renflée à un bout et effilée à l'autre. Elles peuvent être à la limite de trois cristaux (bulles interseptales) ou, plus rarement, à la suite d'une congélation rapide, intracristallines.
Glace de rivière et de lac
Dans un lac qui se refroidit, la surfusion cesse à partir des bords et de cristaux de neige tombant à la surface. Une fois la surface couverte d'une pellicule de glace, les cristaux croissent vers le bas. Ceux qui ont leur axe optique vertical étouffent progressivement leurs voisins. Il se forme ainsi une belle glace sans bulles et à gros cristaux columnaires, allongés dans le sens vertical.
Des vagues ou du courant peuvent morceler la glace, puis la cimenter en un conglomérat. Une chute de neige peut la faire s'enfoncer. L'eau liquide du lac, protégée du froid par la neige, vient alors former un marécage sur la glace, avant de regeler en une masse très bulleuse, à petits cristaux. La texture finale d'une couverture de glace de lac est donc éminemment variable selon les lieux et selon les années.
Dans les rivières turbulentes, la cessation de la surfusion et la formation de cristaux de glace peuvent se produire en leur sein ( fraisil), ou même contre le fond. La glace adhérant au fond peut grossir assez pour remonter à la surface en entraînant l'objet sur lequel elle est fixée, fût-ce l'ancre d'un navire ! D'où son nom anglais d'anchor ice. Mais la plus grande partie de la glace se forme bien sûr en surface, donnant lieu à des embâcles qui entraînent l'inondation des berges.
Glace de mer
L' eau de mer gèle à − 1,8 0C et n'a pas de maximum de densité vers 4 0C permettant une stratification thermique comme dans les lacs. C'est pourquoi le gel de la mer commence dans les baies abritées où l'épaisseur d'eau est faible. En pleine mer on observe longtemps une couche riche en fraisil, le slush (ou sludge), qui amortit le sillage des bateaux.
Tant que la glace est mince, la houle peut la fragmenter en « crêpes de glace » (pancake ice des Anglo-Saxons) qui peuvent se recimenter et constituer des floes. Le mélange de vieille glace et de slush constitue le brash. Puis se forme la banquise, côtière (fast ice) ou dérivante (drift ice ou pack ice). Dans l'Arctique, la banquise côtière est séparée par la marée d'une banquette qui reste attachée au rivage et rend l'accès difficile, même lorsque la banquise a disparu (ice foot). Dans l'Antarctique, la banquise peut rester collée au continent même l'été. Là où la banquise subsiste plus d'un an (cas du pack couvrant le centre de l'océan Arctique), ce n'est pas parce que sa surface est une zone d'accumulation (dans ce cas il se formerait un shelf), mais parce que l'accrétion annuelle de glace sous la banquise compense un bilan annuel spécifique négatif au-dessus. L'épaisseur du pack arctique est d'environ 3 m, mais des fragments peuvent s'empiler, formant des hummocks qui peuvent atteindre 20 m de tirant d'eau.
Dès que l'eau contient plus de 6 g/l de sels minéraux (et l'eau de mer en referme 35), les axes optiques de la glace croissant à la surface ne sont plus horizontaux, mais verticaux. La surface inférieure d'un cristal est formée de fragiles lamelles verticales d'un millimètre d'épaisseur environ et écartées d'autant dans des plans de base cristallographiques. Leur croissance emprisonne des gouttelettes de saumure pouvant n'avoir que 10 μm de diamètre. De ce fait, la glace de mer jeune peut refermer jusqu'à 22 g/l de sel. Toutefois, au cœur de l'hiver, les gouttelettes de saumure migrent vers la zone moins froide, c'est-à-dire vers le bas. Aussi, en surface, la vieille glace de mer peut donner par fusion de l'eau potable.
Pipkrakes, glace surimposée
Les pipkrakes (mot suédois) désignent des fibres de glace qui, par temps de gel, poussent à la surface des sols nus et humides. Chaque fibre est un cristal filiforme, perpendiculaire à l'axe optique. Il croît par le bas, à partir de l'eau du sol, de 1 à 5 cm en une seule nuit.
Les glaciologues appellent glace surimposée (sous-entendu : au glacier) de la glace qui se forme à la base d'un névé saturé d'eau de fonte, au contact de glace imperméable froide (c'est-à-dire à température négative). C'est là le principal processus d'alimentation des glaciers et des calottes glaciaires arctiques (centre de l'inlandsis groenlandais exclu), et on peut aussi en observer occasionnellement au printemps, juste en dessous de la ligne de névé, aux moyennes latitudes.
Parfois les grains en sont petits, et l'orientation des axes optiques quelconque, comme dans le névé. Il y a eu simple congélation d'un névé saturé d'eau. Mais le plus souvent, la glace surimposée est formée de cristaux columnaires verticaux, aux axes optiques horizontaux. Il est tentant de supposer que le névé à été repoussé vers le haut et de rapprocher cette glace surimposée columnaire des pipkrakes.
Dans ce cas, la glace surimposée est criblée de myriades de trous verticaux, intercristallins, qui la font apparaître très blanche. Les poussières s'accumulent dans ces trous et, échauffées par le soleil, agrandissent le trou par fonte. Des algues et micro-organismes se développent dans cette boue, la rendant noirâtre. On l'appelle de la cryoconite. Finalement, la glace surimposée est criblée de trous circulaires, verticaux, de toutes tailles mais d'une profondeur uniforme, les trous à cryoconite.
Glace dans le sol
Lorsqu'un sol humide gèle, l'eau afflue par capillarité vers le front de gel, faisant gonfler le sol. Si la nappe phréatique est proche et le sol suffisamment perméable (formé de limon, et non d'argile), il peut ainsi se former dans le sol de volumineuses lentilles de glace pure. Ce sont les lentilles de glace se formant sous les chaussées qui, lorsqu'elles fondent au dégel, provoquent la formation de « nids de poule » et la détérioration des routes. Pour mettre une route « hors gel » il faut la surélever pour l'éloigner de la nappe phréatique et interposer une couche de gravier qui empêche l'ascension capillaire. Ce cas mis à part, la boursouflure temporaire du sol par la glace ameublit le sol ; elle est donc appréciée des agriculteurs.
Des alternances répétées de gel et de dégel expulsent les cailloux et les piquets du sol. Ils sont soulevés par une lentille de glace lors du gel ; au dégel le vide créé se remplit de boue et la pierre ou le piquet ne redescendent pas. Bien que ce phénomène soit bien connu des agriculteurs de nos régions, les géomorphologues l'ont étudié spécialement dans les régions arctiques, où en profondeur le sol est gelé en permanence (cf. milieupériglaciaire), ce qui entraîne l'été la formation d'une nappe aquifère à faible profondeur. De plus, l'absence de toute activité agricole a permis à ce processus d'opérer pendant des millénaires, créant des formes très curieuses : cercles et polygones de pierres.
Dans les régions arides de l'Arctique, les froids très rigoureux provoquent dans le sol gelé des fentes de contraction thermique tous les 60 à 100 m. Lors du bref été l'eau de fonte s'y infiltre et regèle, et le processus se reproduit tous les ans aux mêmes endroits. À la longue se forme ainsi un quadrillage de murs verticaux de glace pouvant avoir un mètre d'épaisseur dans le haut et qui s'enfoncent d'une dizaine de mètres dans le sol en diminuant d'épaisseur : il s'agit des coins de glace. Les coins de glace s'arrêtent en haut dans la couche de dégel saisonnier, provoquant un sillon où s'accumulent de gros blocs. On appelle les réseaux ainsi formés, très visibles sur les photos aériennes, des polygones de toundra.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Louis LLIBOUTRY : professeur à l'université de Grenoble-I, directeur du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement du C.N.R.S., président du Comité scientifique et technique de l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches
Classification
Médias
Autres références
-
ANTARCTIQUE
- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Edmond JOUVE , Jean JOUZEL , Gérard JUGIE et Claude LORIUS
- 16 485 mots
- 24 médias
L'exploration au sol et le développement des techniques de télédétection ont aboutit à une connaissance précise des caractéristiques physiques de la calotte glaciaire (ou indlandsis, ou encore inlandsis) : altitude et épaisseur de la glace, température moyenne en surface et taux d'accumulation de... -
ARCTIQUE OCÉAN
- Écrit par Robert KANDEL et Jean-Pierre PINOT
- 2 834 mots
- 5 médias
Au centre de l'Océan, l'épaisseur de glace est normalement comprise entre 3 m et 3,50 m. Mais les glaces brisées peuvent se chevaucher et atteindre localement des épaisseurs plus considérables. En été, la glace superficielle fond. En hiver, la glace s'épaissit, surtout par-dessous. Cette... -
ASCENDANCE, météorologie
- Écrit par Jean-Pierre CHALON
- 4 816 mots
- 10 médias
...elles sont le siège d’un courant d’air chaud ascendant. Leur sommet monte rapidement et prend l’apparence d’une tour. Lorsque les gouttes de pluie et les particules de glace formées dans l’ascendance sont devenues suffisamment grosses, elles tombes en entraînant de l’air dans leur chute. Courant ascendant... -
ASTROCHIMIE
- Écrit par David FOSSÉ et Maryvonne GERIN
- 4 390 mots
- 3 médias
...froids, aux températures voisines du zéro absolu, les conditions sont favorables à la condensation de molécules du gaz à la surface des grains de poussière. Des manteaux de glaces se forment, constitués principalement d'eau, puis de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone (chacun comptant pour environ... - Afficher les 45 références
Voir aussi
- FLUAGE
- CONGÉLATION
- HYDROGÈNE LIAISON
- SEL MARIN
- EAU, physico-chimie
- TEMPÉRATURE DE FUSION
- PHASE TRANSITIONS DE
- NÉVÉ
- ÉTAT CHANGEMENT D'
- RIVIÈRES
- DENSITÉ
- FUSION
- GLACIAIRE DOMAINE
- CRISTALLOGRAPHIE
- BANQUISE
- CAROTTAGE
- GLACIOLOGIE
- DÉFORMATIONS, mécanique
- DÉFAUTS, cristallographie
- DISLOCATIONS, cristallographie
- RÉSEAU, cristallographie
- PIPKRAKE
- LACUNE, cristallographie
- TEMPÉRATURE
- EAU DE MER
- MINÉRAUX
- DIAGENÈSE
- TÉTRAÈDRE, stéréochimie
- FOLIATION
- PÉTROGRAPHIE
- GEL, météorologie
- MONT-BLANC
- FONTE DES GLACES
- REGEL
- CRYOCONITE
- CLOSE-OFF
- CALOTTE POLAIRE
- FRAISIL
- RECRISTALLISATION