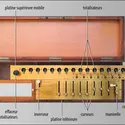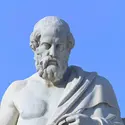LEIBNIZ GOTTFRIED WILHELM (1646-1716)
Article modifié le
Vers les monades
Dynamique et métaphysique
En définissant dans sa jeunesse la substance comme « un être qui agit », Leibniz annonçait déjà la manière dont il allait enrichir la détermination logique de la substance par une détermination dynamique : la substance agissante, contenant ses actions futures sous forme de virtualités, ne pouvait être en effet suffisamment définie par un concept logique. Leibniz tend à incorporer la dimension logique dans un réel qui est toujours dans un état de passage. Dans cette perspective, une substance n'est pas seulement un objet de connaissance parfaite pour Dieu. C'est aussi un sujet opérant à partir de sa puissance d'agir, un agent métaphysique qui perçoit, aspire au développement de ses virtualités, et exprime un point de vue irréductible, au carrefour des relations qui le constituent. Seuls les êtres abstraits ne relèvent que du principe d'identité et de non-contradiction.
À la connexion implicative sujet-prédicat qui caractérise les existants (« involutive » ou virtuelle) correspond un mode d'engendrement des actions et des événements par une substance singulière qui, à travers ses perceptions et ses appétitions, exprime ses connexions avec tous les autres sujets du même monde : chaque corps est affecté par tous les autres et les affecte en retour. C'est ce que que Leibniz appelle entr'expression. Infiniment complexes, les existants relèvent du principe de raison suffisante, qui désigne une volonté du meilleur active dans le choix d'un monde. Cela explique que, pour les intelligences non intuitives que sont les esprits finis, les événements soient imprévisibles. Seule l'intelligence infinie appelée Dieu peut embrasser d'une seule vue l'infini des connexions qui entrent dans chaque action d'un sujet singulier, et y déceler sa marque propre en saisissant une différence intrinsèque entre ce sujet et un autre.
Mais Dieu ne peut faire que les incommensurables soient commensurables, ni que les vérités de fait, dont l'analyse est infinie, reviennent à une identité. En passant de la logique à la physique, on aborde en fait un deuxième régime d'être, plus complexe que celui des essences : celui des res ou susbstances toujours individualisées, animées, sentantes et percevantes, s'orientant spontanément vers un meilleur état. La correspondance avec Arnauld (1686-1689) consacre le rétablissement des formes substantielles, et donc des intentions et des orientations vers une fin immanente pour les créatures. La nouvelle définition de la substance comme agissante, douée d'une puissance d'agir réglée (De la réforme de la philosophie première et de la notion de substance, 1694), aboutira au concept de monade, substance simple dont tous les êtres du monde sont composés. On retient que Leibniz a créé le concept de monade en empruntant un vocable grec signifiant « unité », mais sans comprendre toujours de quoi il s'agit : une cellule vivante ? une âme ? notre personne ? En tout cas, ce n'est plus ici la substance individuelle du Discours de Métaphysique, que Leibniz aurait seulement rebaptisée. C'est bel et bien d'un nouveau concept qu'il s'agit ici.
Monades et corps organiques
Après le tournant monadologique des années 1690, ce ne sont plus les substances individuelles, les personnes ou les esprits qui sont au cœur du dispositif leibnizien, comme l'était César dans le Discours de Métaphysique : « toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l'Univers, qu'elle exprime chacun à sa façon, à peu près comme une ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde ». Le regard de Leibniz descend d'un cran. Il s'attache maintenant à un niveau infrapersonnel où se fomentent les êtres vivants. Désormais, l'activité d'innombrables monades produit les êtres naturels, maintient leurs rapports internes et leurs rapports aux choses, leur créativité et leur plasticité. La nature est « pleine de vie ». Singularités vivantes toutes différentes, les monades, éléments derniers de toute chose, constituent une matière qui n'est inerte qu'en apparence : « peut-être que ce bloc de marbre n'est qu'un tas d'une infinité de corps vivants ou comme un lac plein de poissons ». La nature est partout en elle-même organique, elle se donne dans de multiples individualités échelonnées en une continuité sans faille : « rien ne se fait tout d'un coup, et c'est une de mes grandes maximes et des plus vérifiées que la nature ne fait jamais de sauts, ce que j'appelle la Loi de la continuité » (Nouveaux Essais sur l'entendement humain, Préface). Les activités intellectuelles et volontaires deviennent une forme supérieure de la perception et de l'appétition communes à toutes les monades, lesquelles ont toutes des corps assortis à leurs activités : frustes et unicellulaires pour les simples monades, ou complexes et organiques pour les « animaux ». Quant aux êtres humains, ils sont un degré particulier dans une échelle continue d'êtres vivants ordonnés selon les capacités sensorielles et cognitives de leurs corps. La vie des monades implique une multitude de perceptions confuses, dites « petites perceptions » ou « perceptions insensibles », susceptibles de devenir distinctes chez les monades supérieures (ou « esprits ») capables de retour sur leur activité et capables de retenir leurs perceptions au-delà d'un moment. Ce que nous appelons « conscience » et « mémoire ». Mais ce ne sont plus des facultés, ce sont des degrés supérieurs de l'activité qui nous est commune avec toutes les substances simples, lesquelles expriment chacune à sa manière les changements de rapports entre tous les corps. Perception et appétition sont les deux opérations des monades, les deux versants d'une opération expressive qui suppose des corps affectés par tous les changements de l'Univers. Le sentiment unifie les diverses répercussions des autres êtres sur le corps d'une monade, et cette unité en fait un être, puisque « être » et « être un » sont ici réciproques.
L'hypothèse monadologique, qui prend forme dans le Système nouveau de la nature (1695) succède à la conviction ancienne que « tout est plein de corps animés », et à la suggestion offerte par les expériences de Loewenhoek montrant que la moindre goutte d'eau contient « une infinité de petits animaux ». Pas de monades sans organes si la monade n'est qu'un point métaphysique, une concentration des perspectives qui s'y croisent, ou comme le sommet d'un cône qui serait son corps. Les monades confèrent leur énergie aux « machines de la nature » que sont les corps organiques. Ceux-ci sont machines dans leurs parties les plus infimes, faites d'une infinité d'autres « machines de la nature » plus petites, selon un emboîtement infini. La constitution monadologique des corps est donc une véritable alternative au dualisme cartésien. La machine ne s'oppose plus à l'organisme, et la capacité à la réflexion comme l'individualité sont supportées par la complexité organique. Leibniz reste considéré à bon droit comme le philosophe de l'individualité, mais cette individualité n'est plus nécessairement une personne. L'accent se déplace ici de l'historique à l'organique.
La République des esprits et le meilleur des mondes possibles
Le privilège des esprits est ainsi considérablement érodé par Leibniz, même s'il souligne les degrés de perfection qui donnent à certains êtres dits « raisonnables » des prérogatives particulières, avec les devoirs qui en découlent. Les esprits sont appelés à conduire l'Univers à une perfection plus grande, à l'optimiser : telle est leur vocation. Ils constituent une République des esprits, un règne de la Grâce qui se développe au sein de la Nature (Principes de la Nature et de la Grâce, 1714). C'est le cas des individualités organiques dont la monade dominante est douée de raison, degré supplémentaire de perfection qui donne accès à l'ordre de la Grâce, ordre de justice et de moralité contenu dans la Nature comme une invisible Cité de Dieu. Entrée dans une sphère des droits et des obligations qui enrichit la Nature, une créature raisonnable, capable d'activité réfléchissante et de « prendre la place d'autrui dans la pensée », est considérée comme une personne responsable des conséquences de ses actes. Responsable car capable de reconnaître son élan naturel et sa volonté dans son action. Seul le damné nie constamment la part qu'il prend dans l'interconnexion de toutes choses, sans voir que Dieu lui a seulement donné la force d'agir correspondant à son point de vue. Créé pour incarner un autre point de vue, il ne serait pas lui-même mais un autre. Un autre Sextius ou un autre César sont possibles, mais ils sont précisément une autre personne que celle qui présentement se plaint. Les énoncés contrefactuels sont pour Leibniz très utiles pour raisonner conditionnellement et envisager les conséquences possibles de nos actes. Ils ne décrivent pas un autre monde, mais bien les possibilités inscrites dans ce monde et non dans un autre. Nous choisissons ou non de les actualiser, et nous dessinons ainsi la trajectoire que Dieu aura prévue en choisissant le monde qui est le nôtre. Ainsi le libre-arbitre est sauf : en raison de la contingence ou nécessité hypothétique du choix, nous pouvons agir autrement que nous le faisons, et même nous soustraire – avec le temps – à certaines déterminations qui nous inclinent sans nous nécessiter ; mais jamais « sans raison ». Notre liberté est puissance d'agir dans la nature, majorée par une rationalité elle-même naturelle, et non pouvoir magique. Leibniz n'accepte pas d'« extra-territorialité » pour les esprits : il fait rentrer les intentions et les finalités dans un ordre complexifié et stratifié de la causalité.
Cette conception passe par la thèse bien connue, mais mal comprise, du meilleur des mondes possibles où chaque être créé a sa fonction dans l'ensemble. Dieu, intelligence infinie, est un architecte qui ne crée pas les êtres possibles qu'il trouve dans son entendement. Il est incliné à faire passer à l'existence la meilleure combinaison possible. Cette thèse d'un meilleur des mondes possibles est plausible, il existe des arguments forts en sa faveur, mais elle est en toute rigueur indémontrable. En effet Dieu pouvait ne pas créer si aucun monde possible ne répondait aux exigences de justice et d'harmonie. Leibniz devait donc justifier la création comme telle, sans se contenter d'un monde qui aurait été le moins mauvais possible. Ce qu'il a fait en plaidant la « Cause de Dieu », dans ses Essais de Théodicée(1710). L'harmonie est faite de correspondances et de proportions aussi invariables que des rapports entre nombres. Elle constitue la nature des choses. Dieu y prend plaisir. Comme on veut toujours ce qui plaît, Dieu veut l'harmonie, dont la perfection est moins quantitative que qualitative, ce monde constituant un ordre où chaque chose contribue à l'harmonie universelle (P. Rateau, Revue de métaphysique et de morale, no 70, P.U.F., 2011/2). Le péché des créatures est inévitable, car dû à leur finitude, non à une contribution positive de Dieu. Que l'état des choses ne soit pas présentement le meilleur possible, Leibniz le sait. Mais il replace tout ce qui a lieu dans une perspective dynamique de progrès et de perfectionnement, où les virtualités naturelles comme les efforts des « esprits » ont précisément leur part à jouer. Le dynamisme matériel de l'univers de Leibniz, assorti à la mise en vedette des propriétés harmoniques des choses, est mobilisé au service de la plus grande gloire de Dieu. Sans volontarisme : la Nature, qui suit la voie la plus déterminée, comme le montrent les lois de l'optique, mène à la Grâce, tandis que la Grâce perfectionne la Nature. C'est ce que Leibniz appelle « Harmonie préétablie entre les règnes de la Nature et de la Grâce », dont l'harmonie préétablie entre causes et raisons ou entre âmes et corps n'est qu'un cas particulier, est toujours un enveloppement d'un ordre dans un autre.
Éthique : amour et action des esprits
Une éthique découle de ces vues de Leibniz. La République des esprits est une société virtuelle, gouvernée par les lois de la charité. La réciprocité y soutient les droits et les obligations mutuelles, annonçant ainsi la future Justice de Dieu. Travailler au bien commun, c'est la pierre de touche de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ou du bien public donne le plus grand plaisir. Car aimer c'est toujours trouver son plaisir dans la félicité d'autrui, qui augmente à mesure que plus de collectivités sont concernées, ce qui est le cas avec l'amour de toute la création. Le cosmopolitisme de Leibniz concilie sans difficulté amour et intérêt propre. Il dépasse l'opposition entre utilitarisme et normativisme, si le plaisir que procure l'amour est à la mesure de la perfection de son objet. La musique en est le modèle. Elle nous plaît sans que nous sachions pourquoi, alors que l'harmonie des proportions en est la cause.
L'éthique leibnizienne, qui dépasse une politique souvent intéressée, ou cantonnée au droit strict et condamnée au « moindre mal », est à la fois désintéressée et source de bonheur, un bonheur inséparable du plaisir de l'intelligence et de l'ouverture. La progression infinie vers de nouvelles perfections est la source d'un bonheur aiguillonné par les imperfections à dépasser, et non d'une « jouissance où il n'y aurait plus rien à désirer et qui rendrait notre esprit stupide » (Principes de la Nature et de la Grâce). À chacun de nous de faire progresser l'Univers par une réalisation ou un théorème. Nous pressentons que nous agissons sur une autre scène, chaque personne jouant sa partition accordée à toutes les autres, et prenant sa place dans le concert universel.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Martine DE GAUDEMAR : professeure des Universités, professeure de philosophie à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
Classification
Médias
Autres références
-
LEIBNIZ : CALCUL DIFFÉRENTIEL
- Écrit par Bernard PIRE
- 212 mots
- 1 média
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) publie en 1684 les détails de son calcul différentiel dans son traité Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus. Il y reprend ses découvertes antérieures. Il avait introduit la notation moderne d'une intégrale dès 1675, calculé les dérivées...
-
MONADOLOGIE, Gottfried Wilhelm Leibniz - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 845 mots
G. W. Leibniz (1646-1716) n'a publié de son vivant qu'un seul ouvrage d'importance, la Théodicée (1710). La mort de Locke, en 1704, le dissuada de publier les Nouveaux Essais, en réponse à l'Essai sur l'entendement humain du philosophe anglais. Renommé dans toute l'Europe...
-
ABSOLU
- Écrit par Claude BRUAIRE
- 4 224 mots
...montrer que le système absolu, l'absolu comme système, loin de les résorber, leur confère l'être, puisqu'il est posé comme l'unique mesure de ce qui est. Le génie de Leibniz s'y est employé. Chaque être, explique-t-il, est sa détermination propre, intrinsèque, mais puisque toute détermination implique le... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...cas particulier de l'union universelle des idées avec leurs objets (M. Gueroult), devant être traité dans ce cadre plus global. Sur ce point, on le sait, Leibniz considère l'union de l'âme et du corps dans la monade – l'âme étant l'unité du corps et le corps le point de vue de l'âme – comme l' harmonie... -
ARITHMOMÈTRE DE THOMAS DE COLMAR
- Écrit par Valéry MONNIER
- 1 104 mots
- 1 média
L’arithmomètre utilise le principe du cylindre cannelé inventépar Gottfried Wilhelm Leibniz en 1672. Chaque cylindre possède sur sa circonférence neuf dents de longueur croissante (pour les chiffres de 1 à 9 ; absence de dent pour le chiffre 0). Lorsque l’opérateur inscrit un nombre à l’aide de... -
ART (Aspects esthétiques) - Le beau
- Écrit par Yves MICHAUD
- 5 576 mots
- 6 médias
...Beau et Bien, qui aboutit à l'émancipation du champ esthétique, le moment leibnizien est particulièrement intéressant. En effet, il est significatif que G. W. F. Leibniz emploie indifféremment dans son vocabulaire les termes de Beau et de beauté. Pour lui, la beauté est l'unité dans la diversité, qui renvoie... - Afficher les 76 références
Voir aussi