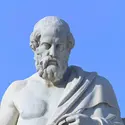GOÛT, esthétique
Article modifié le
Quelques étapes de l'histoire du goût
On ignore presque tout des artistes de l'Antiquité et des goûts personnels des grandes figures de l'histoire ancienne. Mais l'art de ces civilisations disparues, les vestiges archéologiques, plus que les textes, nous renseignent sur l'histoire, la vie, les coutumes des Égyptiens, des Grecs ou des Romains. Ces vestiges ont permis d'analyser les différentes écoles, les différents styles qui se sont succédé ou ont été juxtaposés, notamment dans le bassin méditerranéen. À partir des monuments et des œuvres préservés, si leur nombre est assez grand, il est possible de remonter aux sources et de pressentir quel fut le goût de ceux pour qui ils furent créés.
L'Antiquité : les données de l'archéologie
Cette démarche doit tenir compte évidemment des caractères, parfois exceptionnels, de la destination particulière de tel ou tel édifice, de telle ou telle sculpture. La vie des pharaons que révèlent les peintures et les reliefs de leurs tombes n'était pas celle de tous les Égyptiens. Les objets précieux, d'or, de bronze ou d'ivoire qui entouraient leurs momies n'étaient pas accessibles à tous. Mais ils indiquent ce que l'époque produisait de plus raffiné. Et la fresque des Oiseaux ou celle qui représente Toutankhamon partant pour la chasse évoquent, au-delà des occupations favorites des princes, leur prédilection pour un art décoratif d'une poésie subtile.
En Crète, c'est plus directement la vie même et par conséquent le goût de l'époque minoenne que reflètent les palais de Cnossos, de Malia, de Phaïstos : vie brillante, luxueuse, mais aussi amour de l'œuvre d'art, attrait des matières précieuses, sens du travail élaboré, recherche du plaisir de l'œil dans des décors d'une fraîcheur d'inspiration étonnante où transparaît, au-delà de l'épanouissement harmonieux des couleurs et des lignes, l'émerveillement devant le spectacle qu'offre la nature, un vol d'oiseau, un champ de lis, ou les souples évolutions des dauphins sur la mer.
Puis, dès l'époque mycénienne, la littérature vient appuyer les déductions que permet l'archéologie ; Homère décrit le palais de Nestor et ses richesses, « la coupe splendide [...] ornée de clous d'or » dans laquelle Hécamède lui offre à boire : « Elle a quatre anses et deux colombes d'or becquetant à côté de chacune », comme certaines coupes mycéniennes mises au jour par les fouilles.
En ce qui concerne l'histoire du goût, la Grèce classique, paradoxalement, échappe en partie à l'analyse, parce que la peinture, élément le plus révélateur sans doute en ce domaine, a entièrement disparu. Il faut recourir principalement aux textes pour comprendre l'importance qu'y attachaient les contemporains de Zeuxis, comme plus tard ceux d'Apelle. Il faut étudier le décor des vases pour découvrir les thèmes les plus appréciés des amateurs selon les époques et les régions, pour saisir un reflet de l'évolution qui entraîne, à la fin du ve siècle, l'apparition des sujets « de genre », des scènes de gynécée et des compositions exaltant la grâce féminine. Les figurines de terre cuite révèlent la même transformation, qu'il s'agisse d'ex-voto, d'objets funéraires ou de pièces appartenant au décor familier et placés comme tels dans la tombe de leurs propriétaires.
Au ive siècle seulement, leur qualité esthétique devient pour les amateurs un élément prédominant. Ces œuvres connaissent alors une diffusion remarquable. D'Athènes et, plus tard, de Tanagra, en Béotie, les ateliers de céramistes exportent aussi bien les figurines que les moules, ainsi que des réductions exécutées d'après les œuvres les plus célèbres de la statuaire, vers la Macédoine, la Thrace, l'Anatolie, la Cyrénaïque et jusqu'en Russie méridionale. À la fin du ive siècle, à l'époque hellénistique, la terre cuite est devenue avant tout une œuvre d'art, à l'égal des petits marbres et des bronzes. L'ampleur du phénomène constitue à coup sûr un épisode non négligeable de l'histoire du goût.
À partir de l'époque romaine, cette histoire comporte moins de lacunes. Les documents, œuvres d'art ou textes littéraires, sont plus nombreux. L'analyse, plus aisée, a été faite maintes fois : on sait la vogue de certains modèles grecs, l'intérêt pour les œuvres hellénistiques d'abord, puis le renouveau d'intérêt, au iie siècle, pour la statuaire classique et même archaïque.
Il y a là le reflet d'une évolution dans le goût du public. Le décor de la maison de Livie, sur le Palatin, est encore un reflet du goût, d'un certain éclectisme : dans une architecture en trompe l'œil s'insèrent trois « tableaux », l'un représente Io et Argos, transposition d'une peinture de Nicias d'Athènes (ive siècle), l'autre, Galathée et Polyphème, est d'inspiration tout alexandrine ; le dernier semble pris sur le vif ; c'est une scène de rue, un tableau de genre, avec des personnages aux fenêtres et une femme qui s'avance dans une ruelle étroite.
Ainsi, les fresques des maisons de Rome ou de Pompéi révèlent le décor de la vie et le goût de leurs habitants ; goût connu aussi grâce aux descriptions des poètes, aux commentaires d'un Pline, écrivant par exemple : « Nous aimons à tenir dans nos mains les richesses de l'art. »
Le Moyen Âge : difficultés de l'analyse
Cette rapide évocation montre quelles sont les énigmes à résoudre, les obstacles à surmonter, les indices à utiliser pour élaborer une histoire du goût. Si l' art de cour permet d'évoquer le goût de Byzance au temps de Théodora, il est des lacunes difficiles à combler (ainsi le goût durant le haut Moyen Âge européen), mais il est aussi des « clefs », des points de repère révélateurs : le prestige de l'Orient qui s'affirme très tôt à Venise, puis au temps des croisades dans toute l'Europe occidentale, l'effet souvent décisif des importations, des courants commerciaux, entre Naples et les Flandres au xve siècle, entre l'Italie et la France cent ans plus tard.
Mais, jusqu'à la Renaissance, les moyens d'information sont souvent indirects. L'art profane du Moyen Âge reste très peu connu. Les chroniqueurs évoquent surtout les événements historiques, parfois les fêtes, festins et tournois (qui rappellent l'art de cour), rarement les épisodes de la vie quotidienne. Ils sont muets sur les réactions de leurs contemporains devant les œuvres d'art.
En revanche, nous pouvons imaginer, grâce aux fameuses miniatures des frères de Limbourg, quel était le cadre où vivaient des princes, grands collectionneurs, comme le duc de Berry. Le mobilier, l'orfèvrerie, les vêtements de cette cour fastueuse devaient être pour les artistes et leurs contemporains l'expression du raffinement suprême.
La Renaissance : histoire de l'art et histoire du goût
À partir de la Renaissance, il est plus facile de connaître les prédilections qui s'affirment dans telle ou telle région de France ou d'Italie, celles des petites cours et celles qu'imposent le pape ou le roi.
Le Parfait Courtisan (1528), de Balthazar Castiglione, révèle ce qu'étaient l'idéal et le goût d'un milieu raffiné entre tous, celui d'Urbino : le succès de l'ouvrage hors d'Italie indique bien que ces aspirations étaient communes alors à toute une société.
En abordant cette période, si foisonnante de curiosités et d'inventions, il faut seulement éviter le risque de confondre les courants majeurs de l'histoire de l'art et les fluctuations du goût : pour les Médicis, Botticelli peignait Vénus, Mercure, La Primavera et, pour la haute bourgeoisie florentine, des tableaux de dévotion.
La fascination exercée par l' art italien a été générale en France dans la première moitié du xvie siècle. Les armées de Louis XII et de François Ier ont été éblouies par ce qu'elles ont découvert de l'autre côté des Alpes pendant les guerres d'Italie.
Leur enthousiasme n'eut rien d'un feu de paille. Après la vogue que connurent, dans presque toutes les provinces françaises, l'architecture, la peinture et la sculpture décoratives inspirées des modèles admirés dans la péninsule, l'arrivée des artistes florentins et bolonais à Fontainebleau instaura pour longtemps en France le culte de l'art italien. Mazarin, Louis XIV ne feront que raviver son éclat. Ce prestige ne connaît guère d'éclipses : les artistes, les connaisseurs et les profanes admirent également les antiques, les marbres et les miroirs importés de Rome ou de Venise, les velours et les soieries de Gênes ou de Milan.
Du « grand goût » au sentiment de la nature
Avec le règne de Louis XIV commence celui du « grand goût », imposé par le souverain à des fins politiques, combattu parfois et finalement triomphant. C'est à Vaux, chez le surintendant Fouquet, qu'il faut en chercher les premières manifestations, et c'est l'infatigable activité, l'imagination, le talent de Charles Le Brun qui en assurent le succès, qui créent un style.
Tandis que l'art de Versailles s'impose à l'Europe, les premiers signes d'une évolution se dessinent en France. Les grotesques de Berain, puis d'Audran, les thèmes aimables et gais qui se glissent dans le décor pompeux de Versailles autour du roi vieillissant annoncent une mutation profonde.
Plus qu'aucun autre style, le rococo s'épanouit en relation directe avec le goût de l'époque ; il semble même, parfois, le devancer et l'orienter : les artistes ont imaginé des thèmes nouveaux, les ont adaptés aux canons de l'époque, sûrs d'avance de leur succès.
Les différentes formes sous lesquelles le phénomène se généralise en Europe reflètent assez clairement, d'un pays à l'autre, les nuances du goût : il serait possible d'y percevoir ce qui appartient à un courant commun et ce qui relève de la sensibilité proprement française, allemande ou vénitienne, par exemple.
La transformation de l' art des jardins, au xviiie siècle, reflète un sentiment nouveau de la nature. L'architecte J. F. Blondel, dans son Architecture française (1752-1756), a clairement exprimé ce changement d'attitude : « Une promenade n'est véritablement belle qu'autant qu'elle peut rassembler des points de vue vastes, intéressants et variés [...] On doit trouver dans la nature de quoi satisfaire la vue par des objets opposés qui présentent, par leur diversité, autant d'intervalles pour passer alternativement de la régularité des formes à ce beau désordre que produisent les vallées, les coteaux, les montagnes, l'un faisant valoir l'autre par son opposition et transportant pour ainsi dire le spectateur de la vie tumultueuse à la vie tranquille. On est touché de ce sentiment à l'aspect des jardins de Saint-Germain-en-Laye, de ceux de Meudon [...] Tous les trésors qu'ils renferment présentent plutôt aux yeux l'effort de l'esprit humain que la simplicité de la nature. »
L'analyse de cet attrait, ou de ce refus, de la « simplicité de la nature » pourrait servir de fil conducteur, non seulement pour une histoire de la sensibilité, mais pour une histoire du goût. Ne faut-il pas voir, par exemple, la manifestation caractéristique d'un goût proprement vénitien dans la floraison des villas qui, le long du canal de Brenta, furent pendant deux siècles le séjour de prédilection des familles patriciennes, et dans le fait que, de Véronèse à Tiepolo, les peintres de la lagune trouvèrent à y exprimer l'un des aspects les plus brillants, et les plus attachants, de leur génie ?
Du XIXe siècle à notre temps : complexité et contradictions
Le problème du goût se pose différemment à partir du xixe siècle : son histoire est faite alors de trop d'épisodes, de contradictions, de petitesse et d'excès pour qu'on puisse en dégager une vue d'ensemble. Liés à la fois au mouvement des idées, aux oscillations de la politique, à l'évolution sociale, économique, industrielle, les phénomènes artistiques subissent les mêmes accélérations, aboutissent aux mêmes impasses.
Le goût est souvent conformisme. Il y a l'Académie et les peintres du Salon qui connaissent la gloire. Il y a l'art officiel et l'autre, entre lesquels le fossé se creuse. Le premier se préoccupe de fructueuses commandes, le second exprime ses propres aspirations, d'orientations fort diverses, sans se soucier des réactions du public. Le monde des impressionnistes dans la seconde moitié du siècle est un monde à part, sans aucune influence sur l'époque. Celle-ci est déconcertée, choquée, aveuglée. Elle n'est pas prête, en tout cas, à quitter les velours capitonnés, les draperies à pompons et les peintures au bitume du second Empire pour le « plein air » de Barbizon ou de Giverny.
À la fin du siècle seulement, avec l'Art nouveau, l'effort des créateurs secoue la paresse visuelle de leurs contemporains. Réagissant contre la fabrication en série née de l'avènement du machinisme, ils cherchent à exploiter de façon personnelle les ressources des matières rares ou précieuses.
Cette révolution a pour effet, non seulement une transformation du goût, mais encore un changement d'état d'esprit : après cet ébranlement décisif, il ne se créera plus de ces ornières profondes où s'enlise, pour des générations, le goût du public. Celui-ci accueille désormais sans « révolution » les formes et les rythmes inédits. À la veille de la guerre de 1914, les Ballets russes, en une saison, réussissent à éveiller la sensibilité visuelle d'un milieu pourtant écartelé entre d'obsédantes préoccupations de tous ordres.
Mais, si elle est plus ouverte, la société contemporaine est aussi plus versatile. Aujourd'hui, la puissance de la publicité, les impératifs de la mode, leur diffusion accélérée par les divers supports audiovisuels créent plutôt des engouements successifs, tout au plus des styles éphémères, ceux des années 1950, 1960, 1970 déjà... Le public choisit dans ce kaléidoscope, où l'intuition personnelle peut s'exercer avec bonheur. Mais l'adhésion est rarement assez unanime pour déterminer une tendance où l'on puisse reconnaître le goût d'une époque.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE : critique d'art
Classification
Média
Autres références
-
ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et société
- Écrit par Antoine PICON
- 5 784 mots
« On dit en général du goût que c'est un certain je-ne-sais-quoi-qui-plaît », déclare l'architecte Germain Boffrand dans son Livre d'architecture en 1745, en ajoutant que « cette idée est bien vague ». Aussi imprécise soit-elle, la référence des architectes des Lumières... -
ART (Aspects esthétiques) - Le beau
- Écrit par Yves MICHAUD
- 5 576 mots
- 6 médias
...séparé aux autres sentiments esthétiques, comme le sublime. D'autre part, il s'efforce de défendre encore la prétention à l'universalité du jugement de goût, alors que l'idée de goût implique au pire une diversité irréductible des jugements (ce que reconnaît déjà Du Bos), au mieux une normalisation des... -
ART (Aspects culturels) - La consommation culturelle
- Écrit par Pierre BOURDIEU
- 4 059 mots
- 2 médias
...choses de la vie, le goût populaire et le sérieux (ou la naïveté) même qu'il investit dans les fictions et les représentations indiquent a contrario que le goût pur opère une mise en suspens de l'adhésion « naïve » qui est une dimension d'un rapport quasi ludique avec les nécessités du monde. Voyant dans... -
ART (Aspects culturels) - Public et art
- Écrit par Nathalie HEINICH
- 6 256 mots
- 1 média
...puisqu'elle marque – en même temps qu'une certaine autonomisation de la production par rapport aux circuits marchands – une véritable institutionnalisation du goût comme faculté indépendante de la consommation matérielle, possédant en soi une finalité propre, désintéressée (ainsi que le conceptualisera l'esthétique... - Afficher les 44 références
Voir aussi