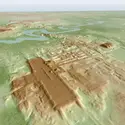GUATEMALA
| Nom officiel | République du Guatemala |
| Chef de l'État et du gouvernement | Bernardo Arévalo - depuis le 15 janvier 2024 |
| Capitale | Guatemala |
| Langue officielle | Espagnol |
| Population |
18 124 838 habitants
(2023) |
| Superficie |
108 890 km²
|
Article modifié le
Histoire
La période précolombienne
La période précolombienne de la région qui deviendra plus tard le Guatemala fut caractérisée par la florissante civilisation maya, s'étendant depuis le Yucatán (Mexique) jusqu'au Honduras et au Salvador actuels ; celle-ci atteignit un remarquable développement tant dans le domaine des arts que dans celui des sciences exactes, dont les sites majestueux de Tikal et de Uaxactún témoignent en partie (la forêt du Petén recèle d'autres monuments non encore explorés). Aux œuvres architecturales à fonction cérémonielle s'ajoutèrent le travail de la céramique, l'astronomie qui permit d'élaborer deux calendriers (l'un religieux, l'autre civil, qui comportait 18 mois de 20 jours et un mois de 5 jours, avec une remarquable précision). Également très avancés en mathématiques, les Mayas avaient conçu une forme de zéro. En revanche, ils ne connaissaient ni la roue ni les animaux de trait, et le travail des métaux n'apparut que très tard.
Les Mayas possédaient aussi de grandes aptitudes littéraires. Nous disposons malheureusement de peu de documents à l'heure actuelle, car ils furent en grande partie détruits par les Espagnols, notamment les missionnaires qui voulaient obliger les indigènes à abandonner leurs croyances. Cependant, quelques œuvres de la littérature maya ont pu être sauvées et leur écriture hiéroglyphique déchiffrée en partie ; la plus connue est le Popol Vuh, histoires anciennes du Quiché.
Les Mayas durent se soumettre successivement aux Toltèques, puis aux Aztèques venus du Nord vers 1300. À l'arrivée des Espagnols, la civilisation maya était en déclin, selon la plupart des chercheurs, pour des raisons mal connues. L'hypothèse de fléaux naturels, de la famine, de migrations, de la montée du militarisme, de guerres intestines, entre autres, a été avancée. Il faut également rappeler qu'en ce qui concerne la page de l'histoire maya qui précède immédiatement la Conquête, et coïncide avec elle, nous ne disposons que des textes écrits par les Espagnols : l'« effondrement » de la civilisation maya constituait un argument pour justifier la Conquête. Cependant, il semble vrai que la société que trouvèrent les Européens traversait une phase de mutations qui restent à déterminer.
La première guérilla contre le conquérant Pedro de Alvarado était dirigée par le résistant maya Tecún Umán. De multiples révoltes indiennes devaient ensuite jalonner l'époque coloniale et républicaine.
La colonisation
Les Espagnols pénétrèrent pour la première fois au Guatemala en 1523. Pedro de Alvarado, lieutenant de Cortés, ne réussit à soumettre définitivement le Guatemala qu'au bout d'un an de guerre, après avoir écrasé la place forte de Quezaltenango. Il y exerça une tyrannie sanglante, brûlant et pillant les villages, déportant et vendant les indigènes. Il est à l'origine du système de l'encomienda, qui consistait à octroyer aux « conquistadores » des terres et des Indiens réduits à la condition de serfs.
Après la mort de Pedro de Alvarado, en 1541, à Mexico, l'actuel territoire guatémaltèque fut incorporé dans la Capitainerie générale du Guatemala, qui comprenait toute l'Amérique centrale. Le système économique et juridique ainsi que les normes religieuses qui prévalurent dans ce territoire ressemblaient à celles qu'imposait la couronne espagnole dans toutes ses colonies. Tout particulièrement l'Espagne s'octroyait le monopole du commerce avec ces pays. L'Inquisition y sévit de 1572 à 1821.
L'indépendance
L'instabilité du pouvoir politique en Espagne en 1808 amène les anciennes colonies américaines à revendiquer leur autonomie. Le 15 septembre 1821, craignant une intervention mexicaine sur leur territoire, les Créoles, qui se sentent lésés par l'administration royale, écartés des charges les plus honorifiques et les plus lucratives, se révoltent puis votent l'indépendance. Durant ces luttes, les Indiens ont été tenus à l'écart ou bien enrôlés dans les troupes indépendantistes. Mais, en 1822, le Guatemala, comme les autres provinces d'Amérique centrale, est rattaché à l'Empire mexicain d'Iturbide qui s'achève en mars 1823. Les Provinces-Unies d'Amérique centrale se retrouvent alors au sein de la Fédération d'Amérique centrale qui prend fin en 1839 – après des dissensions entre les dirigeants. Elle fait place à cinq pays d'Amérique centrale : Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua et Costa Rica. Toutefois, le Guatemala hérite d'une organisation socio-économique et d'une culture résultant de trois siècles de colonisation, dans lesquelles le pouvoir des élites créoles est renforcé, tandis que les Ladinos connaissent une certaine mobilité sociale.
Alternance des conservateurs et des libéraux
Des gouvernements conservateurs (1839-1871) aux libéraux (1871-1944)
Pour la première fois depuis son indépendance, le Guatemala connaît une période de relative stabilité politique avec l'arrivée, à partir de 1839, des conservateurs au pouvoir. Jusqu'en 1871, les gouvernements de Mariano Rivera Paz, le premier président élu du Guatemala en 1839, puis de Rafael Carrera de 1844 à 1865 dirigent le pays et maintiennent les structures coloniales existantes. L'unique réussite économique de cette période est la reconversion de l'agriculture dans la production d'un nouveau produit d'exportation : le café. À la mort du conservateur Carrera en 1865, le renouveau du courant libéral s'engage. Miguel García Granados et Justo Rufino Barrios, notamment, préparent la révolution libérale de 1871.
En 1871, une nouvelle élite dirigeante accède au pouvoir par les armes. Cette révolution permet à Granados (1871-1873) puis à Barrios (1873-1885) d'occuper successivement la présidence et de mettre en œuvre une réforme libérale, une Constitution et un Code civil. Libérales sur les plans économique et religieux, les mesures prises restent autoritaires sur le plan politique (vie parlementaire limitée, liberté de la presse restreinte, importance de l'armée et de la police). Barrios mène une politique de réforme des institutions et de l'État en s'appuyant sur le développement d'un capitalisme agro-exportateur grâce à des capitaux étrangers (britanniques, américains et allemands). Il apparaît ainsi légitimement comme le modernisateur du Guatemala.
Par ailleurs, alors que, jusqu'à la fin du xixe siècle, le protestantisme était très peu présent, Barrios favorise son implantation en déclarant la liberté de conscience et de culte. Le catholicisme n'est plus religion d'État et l'absence de prêtres dans les villages contribue au succès du protestantisme avec la présence accrue de missionnaires. De plus, dès le début du xxe siècle, les missions protestantes nord-américaines traduisent la Bible en langue vernaculaire.
La dictature libérale se poursuit sous les gouvernements de Manuel Lisandro Barillas (1885-1892) puis de José María Reyna Barrios (1892-1898). Ensuite, Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), véritable tyran, fait régner la terreur sur l'ensemble du pays. L'ouverture aux intérêts étrangers se poursuit sous sa présidence. Les grands propriétaires terriens et les compagnies étrangères consolident leur mainmise sur le pouvoir politique et sur l'économie du pays. Vers 1920, les compagnies américaines contrôlent 70 % des importations et 80 % des exportations. La principale d'entre elles, la United Fruit Company, créée en 1899, s'est implantée en 1902 au Guatemala. Le gouvernement de Cabrera lui accorde des terres fertiles sur la côte pacifique pour la culture des bananes, des avantages portuaires et fait construire une ligne de chemin de fer.
Le siècle du café
La réforme libérale a pour finalité d'exproprier les Indiens et les petits paysans ladinos de leurs terres communautaires ou municipales afin de développer la propriété privée et le capitalisme agraire en même temps que la culture exportatrice du café. Au milieu des années 1880, la production caféière représente 85 % des exportations en valeur. Cette expansion de la production de café implique une forte mobilisation de la main-d'œuvre. Les populations indiennes des hautes terres, qui ont perdu leurs parcelles pour la culture vivrière, se trouvent enchaînées aux plantations et aux grands domaines fonciers par le biais de l'endettement et du travail forcé. Les propriétés foncières de l'Église sont également confisquées puis vendues. Parallèlement, le gouvernement guatémaltèque, qui souhaite développer l'agriculture exportatrice, encourage la croissance de l'immigration, principalement allemande. Ainsi, de 1896 à 1918, plus de 45 % des lots de terres concédés par le gouvernement, situés dans les départements où la population indienne est la plus importante (Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango), bénéficient à des Ladinos ou à des Européens.
Au début du xxe siècle, durant les longs mandats de Manuel Estrada Cabrera puis du général Jorge Ubico (1931-1944), la United Fruit Company continue à contrôler l'économie guatémaltèque : en contrepartie d'investissements (écoles, dispensaires, services), le gouvernement militaire d'Ubico accorde des facilités à cette entreprise, notamment sur le plan fiscal et de la législation du travail.
La « révolution d'octobre » et les premiers gouvernements démocratiques (1944-1960)
La politique arbitraire menée par le général Ubico, partisan de l'oligarchie foncière, conduit à sa destitution en 1944. Ubico avait emprisonné, assassiné ou réduit au silence ses opposants. Mais, dès le début des années 1940, de nouvelles contestations voient le jour, menées notamment par les enseignants et les étudiants. Ubico quitte le pays le 30 juin 1944, et le 20 octobre suivant, des jeunes officiers et des étudiants démettent son successeur, le général Federico Ponce. La mobilisation populaire menée par les classes moyennes, les syndicats et les nouveaux partis politiques, notamment le Parti guatémaltèque du travail (PGT, communiste) – créé en 1949 – entraîne la tenue d'élections. En mars 1945, le civil Juan José Arévalo, candidat désigné des partis réformistes, est élu président. Son successeur, le colonel Jacobo Árbenz, acteur de la « révolution d'octobre », est lui aussi élu démocratiquement en 1951.
Nouvelles libertés politiques
Pour ces deux présidents, il s'agit de mettre fin à l'État libéral et à la culture politique oligarchique. S'appuyant sur la nouvelle Constitution votée en 1945, le gouvernement introduit des lois pour améliorer les conditions socio-économiques des classes moyennes et des secteurs indiens. Il met en application un Code du travail et favorise d'importants programmes d'alphabétisation et de contrôle sanitaire. L'Institut national indigéniste (INI) est créé en 1945 afin de mettre au point les méthodes les plus appropriées pour « incorporer l'Indien au sein de la culture nationale ». À partir de la révolution de 1944, le nouveau contexte politique entraîne une reformulation à la fois de l'idéologie sociale nationale et de l'identité maya.
Crise de la propriété foncière et réforme agraire de 1952
La crise économique mondiale de 1929 a entraîné la chute de la production du café. Néanmoins, elle n'a pas eu pour conséquence la redistribution des terres. En effet, en ne renonçant ni à ses immenses domaines ni à l'agro-exportation, en n'investissant pas dans l'industrie, l'oligarchie caféière n'a pas favorisé de réforme agraire. À partir de 1950, la population croît rapidement et, entre les années 1950 et 1980, elle passe de 3 millions à 6 millions d'habitants. Cela implique des changements fondamentaux dans l'usage des terres à l'intérieur même des communautés paysannes et indigènes (réduction du temps de jachère) et une intensification de la fragmentation des terrains. Cette pression sur la terre oblige un grand nombre de paysans à migrer dans le pays et à se faire engager comme travailleurs saisonniers dans les plantations de café et de coton sur la côte pacifique.
Jacobo Árbenz promeut une réforme agraire qui s'attaque aux intérêts des compagnies nord-américaines, mais aussi aux privilèges de l'oligarchie caféière du pays. Ainsi, le décret 900 de la loi de réforme agraire de 1952 force notamment la United Fruit Company à céder une part importante de ses terres en friche (ou inutilisées) aux paysans. Toutefois, la politique agraire d'Árbenz ne dépossède pas les grands propriétaires au profit des petits paysans, car seules les terres non cultivées ou ne servant pas à l'élevage peuvent être redistribuées. Ainsi, pour l'ensemble du pays, seuls 602 000 hectares ont été expropriés et concédés à cent mille familles. Mais cette politique de réforme agraire vise directement les intérêts nord-américains et, dans le contexte de la guerre froide, Árbenz est accusé de sympathies communistes.
Fin de l'expérience démocratique et coup d'État
L'expérience démocratique s'achève rapidement. Le gouvernement réformiste est renversé, en juin 1954, par un mouvement armé fomenté par la CIA et dirigé par le colonel Carlos Castillo Armas. Celui-ci et la nouvelle junte militaire au pouvoir prennent rapidement le contrôle du pays. Devenu président grâce au coup d'État, Castillo Armas est assassiné en 1957. Le général Miguel Ydígoras Fuentes lui succède jusqu'en 1963 ; sous son gouvernement, les relations diplomatiques avec Cuba sont rompues et les opposants au régime réprimés. Un soulèvement de jeunes officiers, organisé contre le président le 13 novembre 1960, marque la naissance de la guerre civile et de l'affrontement entre la guérilla (Forces armées rebelles, [FAR] notamment) et l'armée.
La guerre civile (1960-1996)
Les contestations civiles et sociales, d'une part, menées par la classe moyenne et par le clergé empreint de la théologie de la libération, les guérillas marxistes, d'autre part, mais aussi la militarisation de l'État vont jeter le pays dans la spirale de la guerre et de la violence durant plus de trente ans.
L'influence des mouvements catholiques dans la contestation
En favorisant les revendications sociales des populations rurales et mayas, les nouveaux missionnaires catholiques participent au déclenchement de la guerre civile.
L'Action catholique, qui est, au Guatemala, le principal groupe religieux au discours contestataire – prônant une orthodoxie religieuse et critiquant l'ordre social établi – était présente, dès 1948, dans les zones indiennes des hautes terres. Grâce à la formation de catéchistes indiens ou de leaders laïcs, le clergé transforma les perspectives sociales et politiques des Indiens qui, dans le même temps, prirent conscience de leur situation. Dès les années 1960, ces ordres et ces congrégations commencent, sous l'influence du deuxième concile du Vatican et du mouvement de la théologie de la libération qui se développe alors en Amérique latine, à canaliser les convertis dans des mouvements paysans et coopératifs naissants (comme le Comité d'unité paysanne [CUC], qui sera créé officiellement en 1978). Dans les hautes terres du Guatemala, ils tentent de répondre aux problèmes sociaux et économiques et de suppléer l'État dans ces régions délaissées.
La présence de l'Action catholique ainsi que celle des Maryknoll (missionnaires catholiques nord-américains) se révèlent essentielles dans le passage de l'action politique à l'engagement armé dans la guérilla, face à l'épuisement des voies pacifiques, à l'impuissance politique de la Démocratie chrétienne (parti créé en 1956, mais qui n'arrive pas à s'imposer face aux partis de droite) ou encore à la répression étatique. En effet, dès la fin de l'année 1976, l'armée séquestre puis assassine des catéchistes dans les zones Ixil et de l'Ixcan (département du Quiché), poussant ainsi les catholiques à adhérer aux mouvements révolutionnaires. En 1980 et 1981, la répression étatique contre les membres de l'Église catholique se déchaîne (assassinats et persécutions de religieuses et de prêtres).
Pour contrecarrer l'influence grandissante des partisans de la théologie de la libération, assimilés souvent à des sympathisants d'extrême gauche, les États-Unis, dans le climat de la guerre froide et de la lutte anticommuniste, exhortent à la croisade du protestantisme fondamentaliste. De 1954 à 1960, les conversions sont multipliées par trois, puis par sept de 1960 à 1985.
Les mouvements de guérilla marxistes et la politique de contre-insurrection
L'année 1960, après l'échec du soulèvement militaire du 13 novembre, voit apparaître progressivement la guérilla, notamment celle des Forces armées rebelles formée par des ex-officiers de l'armée et des membres du PGT. Au début des années 1960, le Guatemala entre dans une période de troubles politiques de plus en plus violents, opposant la guérilla aux paramilitaires et aux militaires. Mais, face à la contre-insurrection de l'armée, la guérilla commence, à partir de 1966, à se démobiliser. Ce n'est qu'au début des années 1970 que certains membres des FAR prennent conscience des erreurs commises, notamment de l'absence de liens avec les populations rurales et indiennes. Une partie d'entre eux, exilés au Mexique, fondent alors l'Armée de guérilla des pauvres (EGP) puis s'installent, en 1972, dans le Quiché, département à majorité indienne. D'autres, restés au Guatemala, fondent, en 1979, l'Organisation révolutionnaire du peuple en armes (ORPA). L'EGP et l'ORPA consacrent leurs efforts à la mise en place de structures politiques et militaires clandestines dans les campagnes. Des militants chrétiens et des étudiants suspectés de sympathies communistes, fuyant les villes à cause de la répression sélective menée par l'armée ou les milices d'extrême droite (Armée secrète anticommuniste et Main blanche, notamment), viennent renforcer les mouvements révolutionnaires. Ceux-ci organisent de nombreux actes de sabotage économique et des attaques armées dès le début des années 1970.
Par ailleurs, de 1966 à 1982, une série de gouvernements militaristes se succèdent, et les assassinats politiques ponctuent les mandats des généraux élus à la tête du pays. Au début des années 1980, les grèves et les actions des organisations syndicales s'intensifient dans le pays ; les contacts entre les guérilleros et les masses populaires se développent. Les groupes de guérilla d'extrême gauche et le PGT se rassemblent, en 1982, au sein de l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (UNRG) et réclament la fin de la répression étatique, la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire garant des droits de l'homme, une réforme agraire et l'égalité pour la population indienne. En effet, malgré la loi de « transformation agraire » votée en 1962, et les répartitions de terres octroyées par les différents gouvernements aux paysans, le problème de l'accès à la terre persiste et la redistribution des terres demeure l'une des principales revendications de la guérilla.
Les mouvements de contestation civile
À la suite du tremblement de terre du 5 février 1976 (au moins 20 000 morts), plus d'un million de Guatémaltèques, principalement des Mayas, se retrouvent sans abri. Cette situation permet à l'armée, mobilisée pour les secours, de détourner l'aide internationale et, surtout, d'étendre son contrôle sur de vastes zones du pays. Des massacres sont perpétrés, comme dans le village de Panzos (Alta Verapaz), le 29 mai 1978, où cent cinquante Indiens sont assassinés par l'armée au service des grands propriétaires terriens. Les communautés indiennes revendiquent de plus en plus vivement leurs droits face aux exactions de ces derniers − vols de terre, travail forcé et esclavage par endettement − et celles des soldats − vols d'animaux, destruction des récoltes, enlèvements. En 1978, des paysans indigènes des hautes terres (du Quiché notamment), des travailleurs agricoles et des petits propriétaires ladinos créent un syndicat : le CUC. Une délégation occupe pacifiquement l'ambassade d'Espagne pour alerter la communauté internationale contre les usurpations de terres ; mais le 31 janvier 1980, l'armée donne l'assaut : trente-neuf personnes, dont des diplomates, sont tuées dans des conditions encore non éclaircies. Avant de rallier le mouvement de guérilla, ce syndicat organise, en février 1980, une grève réunissant soixante-dix mille coupeurs de canne à sucre et quarante mille cueilleurs de coton. Cette action, notamment, force le gouvernement à augmenter le salaire quotidien minimum des travailleurs agricoles de 1,12 à 3,20 dollars.
Contre-insurrection, répression, massacres et déplacements de population
La présidence du général Romeo Lucas García (1978-1982) est marquée par une répression et une violence sans précédent dans les hautes terres indiennes. La guerre civile a déjà fait des dizaines de milliers de victimes. Dès 1981, les assauts de l'armée contre les villages suspectés de soutenir la guérilla se généralisent dans tout le pays. En 1982, lors des massacres de Plan de Sanchéz et de San Francisco, respectivement, plus de deux cents et trois cents personnes, hommes, femmes et enfants, sont tuées. La population indienne de l'Altiplano prend alors les armes pour répondre aux exactions de l'armée.
Des élections frauduleuses ont lieu le 7 mars 1982, a l'issue desquelles le général Guevara se proclame successeur du général Lucas García. Mais, le 23 mars, un groupe de militaires encadrés par le général Efraín Ríos Montt, protestant fondamentaliste, prend le pouvoir par un coup d'État. Au cours de l'année 1982, de nombreuses populations rurales, souvent indiennes, soupçonnées de soutenir les guérilleros, sont massacrées par les troupes régulières. La poursuite de la politique de la « terre brûlée », afin d'isoler définitivement la guérilla de ses bases, se déploie essentiellement dans le nord et le nord-ouest du Guatemala. Les populations indiennes, notamment, se trouvent sous le contrôle de l'armée et de l'État. Les Patrouilles d'autodéfense civile (PAC), groupes paramilitaires, créées en 1981, militarisent totalement les campagnes.
Les contre-offensives violentes et massives de l'armée – dont les effectifs ont triplé entre 1977 et 1986 – brisent les mouvements de guérilla, trop dispersés géographiquement et insuffisamment équipés et préparés. La campagne contre-insurrectionnelle de Ríos Montt surpasse en violence celle de ses prédécesseurs.
Les massacres semblant avoir été planifiés, comme dans les départements de Huehuetenango (dans l'ouest du pays) et du Quiché, le terme de génocide a été employé par la Commission d'éclaircissement historique, qui a publié son rapport en 1999, pour qualifier les exactions et les actes de violence commis à l'encontre de la population indienne et paysanne. Par ailleurs, les guérilleros n'épargnent pas, non plus, la population civile, assassinant toute personne qui représente symboliquement le pouvoir des grands propriétaires (les contremaîtres ladinos), et les Indiens perçus comme traîtres.
Avec l'arrivée de trois mille soldats dans le département de Huehuetenango, en juin et juillet 1982, l'EGP, qui avait déployé des actions offensives, notamment contre des personnes proches de l'armée dans cette zone, déménage son quartier général pour la région voisine de l'Ixcan.
Les affrontements entre troupes régulières et guérilla obligent la population à se réfugier au Mexique. En 1982 et 1983, 1,5 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Plus de cent cinquante mille hommes, femmes et enfants (en majorité indiens) originaires des départements de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz et Petén, fuyant violences et massacres, s'installent dans des camps de réfugiés à la frontière mexicaine, au Chiapas. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas fuir se trouvent regroupés et contrôlés par l'armée dans des « villages modèles », tandis que la guérilla est condamnée à agir dans une région où les habitants ont été évacués.
En août 1983, Ríos Montt est destitué, à son tour, par des militaires. Le pouvoir passe alors à son ministre de la Défense, le général Oscar Mejía Víctores. Celui-ci relance la répression contre les mouvements de l'UNRG. Il parvient, en 1984, à les couper de leur base populaire et rurale. Mais la violence employée pour y parvenir est si forte que l'armée perd le soutien des sphères jusqu'alors acquises. Ainsi, la hiérarchie catholique dénonce la politique de « génocide » perpétrée au nom de la contre-insurrection, et l'oligarchie critique la mauvaise gestion économique du pays et, notamment, le poids croissant des dépenses militaires dans le budget national.
Première transition démocratique
La première transition démocratique a lieu en novembre 1986 avec l'élection à la présidence du civil Vinicio Cerezo, candidat de la Démocratie chrétienne. Son arrivée au pouvoir met fin aux gouvernements militaires successifs. Toutefois, la mauvaise situation économique du pays, les assassinats, les combats entre l'armée et la guérilla persistent. L'armée maintient la militarisation du pays. Aucun dialogue entre le gouvernement et l'UNRG ne s'instaure. Les revendications foncières de la part des mouvements paysans et les invasions de terres augmentent. Et les diverses tentatives de coup d'État, en 1988 et 1989, bloquent toute possibilité de règlement du conflit agraire.
L'élection présidentielle de 1990 est remportée par Jorge Serrano Elias, le candidat du Mouvement de l'action solidaire, parti dont il est le fondateur. Sous sa présidence débutent les négociations et les pourparlers avec l'UNRG, et les premiers retours de réfugiés s'organisent. Le 8 octobre 1992, à la suite d'un accord signé par le gouvernement, les premiers réfugiés (Retornados) sont autorisés à rentrer du Mexique, sous l'égide du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d'observateurs extérieurs. Mais, malgré la pression internationale pour mettre fin à ce conflit, les affrontements entre les forces armées se poursuivent.
Le président Serrano, ne pouvant s'octroyer les pleins pouvoirs, après l'échec de son autogolpe (auto-coup d'État), fuit le pays. Face à la vacance du pouvoir, le 6 juin 1993, Ramiro de León Carpio (ancien procureur des droits de l'homme) est nommé président par le Congrès.
La demande de terres, les mouvements indiens, les dénonciations d'exactions et de violations des droits de l'homme ou encore les programmes de retour des réfugiés marquent les années 1993 à 1995. Si les négociations entre les belligérants parviennent à ouvrir le Guatemala à la démocratie, elles bloquent sur la question socio-économique du règlement du conflit agraire.
La signature, en janvier 1994, du Traité de libre échange nord-américain (ALENA) entre le Mexique, le Canada et les États-Unis et l'insurrection néo-zapatiste au Chiapas conditionnent la paix au Guatemala, qui devient un nouvel objectif géostratégique pour les États-Unis et la communauté internationale. Les Nations unies assument un rôle de médiateur à partir de cette date et obligent les parties à respecter un calendrier.
Le retour à la démocratie
La création de l'ALENA et la fin de la guerre froide sont autant de facteurs qui accélèrent la fin du conflit guatémaltèque, la signature des accords de paix et le retour à des gouvernements démocratiques.
La signature de la paix : à la recherche d'un accord politique
Lors de l'élection présidentielle de janvier 1996, l'enjeu est la stabilisation des institutions et la réforme de l'État pour assurer la signature des accords de paix. Le candidat de la droite, du Parti de l'avancement national (PAN), Àlvaro Arzú Irigoyen, remporte l'élection. Il réunit les différents acteurs du conflit, l'UNRG, les militaires, les grands propriétaires terriens, à la table des négociations. Il obtient un cessez-le-feu avec la guérilla le 4 décembre. Les « accords pour une paix ferme et durable » sont signés le 29 décembre 1996, mettant fin à plus de trente-six années de guerre civile.
Les accords de paix ébauchent les contours d'un cadre institutionnel en vue de créer une nation multiethnique, pluriculturelle et multilingue. Ils promeuvent également les droits culturels des peuples indigènes, la lutte contre le chômage et l'appauvrissement, ainsi que le règlement de la question agraire. La guérilla est désarmée par une mission des Nations unies (Minugua). En février 1999 est publié le rapport de la Commission d'éclaircissement historique qui annonce que le conflit a fait plus de deux cent mille morts, majoritairement des civils mayas, et six cent soixante massacres ont été répertoriés. À cette date, les accords ont été partiellement mis en application, toutes les demandes de parcelles n'ont pu être satisfaites, même si l'accès à la terre a été juridiquement facilité.
En janvier 2000, Alfonso Portillo, candidat du Front républicain guatémaltèque (FRG), le parti de l'ex-dictateur Ríos Montt, remporte l'élection présidentielle. Il forme un gouvernement hétéroclite qui comporte des anciens guérilleros et des membres de l'extrême droite, puis décide d'imposer la loi et l'ordre dans le pays. Dans un climat où le taux de criminalité est très élevé, où les problèmes de corruption, d'intimidation constante vis-à-vis des militants des droits de l'homme, des juristes, des journalistes et des témoins aux procès en cours contre d'anciens militaires sont trop fréquents, le gouvernement lance, pour la première fois en 2001, des tentatives de réconciliation nationale (consolidation des accords de paix et création d'instances de dialogues).
En janvier 2004, le candidat de droite de la Grande Alliance nationale (GANA), Oscar Berger, est élu président devant l'ex-dictateur Ríos Montt (FRG) et le candidat du centre gauche Àlvaro Colóm. En représentant la droite conservatrice, Berger, ancien maire de la capitale, a mis fin au populisme autoritaire. Toutefois, le bilan économique de son mandat est entaché par les destructions causées par l'ouragan Stan (1995), mais aussi par l'inflation et l'insécurité galopantes.
En finir avec la discrimination historique : le mouvement maya
Pendant plus d'un siècle et demi, la population indienne, majoritaire dans le pays, a été systématiquement écartée des droits à la citoyenneté et de la politique nationale par les gouvernements libéraux, conservateurs, et par l'élite oligarchique, favorisant, de la sorte, les traditions racistes et autoritaires.
Au cours des années 1970 et 1980, une nouvelle génération de leaders et d'intellectuels mayas ont redécouvert l'importance historique de leurs racines et ont revalorisé cet héritage linguistique et culturel. Face à la violence et aux massacres perpétrés, qui ont provoqué la rupture du lien générationnel, s'est créée une nouvelle mobilisation indienne dans des organisations qui dénoncent ces violences. Des associations (comme l'Académie des langues mayas du Guatemala, créée en 1986, ou le Comité des organisations mayas du Guatemala regroupant une dizaine d'organisations indiennes) donnent alors corps à ces initiatives qui, au début des années 1990, dessinent un mouvement maya disparate mais de plus en plus présent sur la scène publique. La reconnaissance internationale de la militante maya-quiché des droits indigènes, Rigoberta Menchu Tum (Prix Nobel de la paix en 1992) a permis à ces organisations de sortir du silence. Ces mouvements indiens revendiquent des améliorations sociales et politiques ainsi que la reconnaissance de leurs particularismes.
Bien que le mouvement maya ne soit pas unifié au niveau national, il a un impact important dans le processus de paix des années 1990. Avec la signature des accords de paix en 1996, la population indienne, notamment maya, a été enfin reconnue, d'une part, par les élites et les intellectuels – non comme une minorité ethnique mais comme population bénéficiant des mêmes droits que les non-Indiens – et, d'autre part, par les populations mayas elles-mêmes qui osent revendiquer leur droit d'appartenir à la nation en tant que citoyen tout en conservant leurs particularités. Toutefois, lors du référendum de mai 1999, les Guatémaltèques rejettent toute modification de la Constitution de 1985 qui aurait permis la reconnaissance officielle du Guatemala comme pays multiethnique et pluriculturel (et aurait concédé aux Indiens des droits spécifiques, comme celui de bénéficier de lois coutumières).
De plus, les partis politiques traditionnels ont été incapables d'entreprendre les transformations nécessaires pour le pays. Les Indiens vivent toujours dans la pauvreté. Plus récemment, le mouvement maya a participé aux politiques nationales concernant l'éducation et la culture, et à la discussion préliminaire pour la préparation d'une stratégie nationale de réduction de la pauvreté.
Le 27 février 2007, Rigoberta Menchu annonce sa candidature à la présidentielle, sous l'étiquette du nouveau mouvement politique Winaq (signifiant équilibre et intégrité en quitché), allié au parti de centre gauche EG (Rencontre pour le Guatemala). Sans moyens financiers pour faire campagne, Rigoberta Menchu n'a fait qu'un faible score. Après une campagne électorale marquée par une rare violence (assassinats, rackets...), Alvaro Colóm, le candidat du centre gauche Unité nationale de l'espérance (UNE), a remporté l'élection présidentielle, le 4 novembre, face à l'ex-général Otto Peréz Molina, candidat de la droite conservatrice, Parti patriotique (PP), qui a axé sa campagne sur le recours à la force pour endiguer la délinquance et la corruption. Le nouveau président prône une politique sociale-démocrate « avec un visage maya » pour tenter de régler les problèmes endémiques du pays.
Le boom de l'émigration
Depuis les années 1990, des transformations majeures, telles que la croissance démographique, la fragmentation et la rareté croissante des terres, et les mouvements de migration urbaine et internationale, affectent l'économie rurale. Dans le même temps, l'extrême pauvreté et le manque d'accès aux services de base se sont considérablement accrus. En 2005, plus de la moitié de la population nationale (56,7 %) et près des trois quarts de la population indienne rurale vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Au regard de presque tous les indicateurs socio-économiques – revenus et consommation des foyers, éducation et scolarité, santé et nutrition infantile, accès à l'eau potable et conditions d'habitat, etc. –, la population rurale indigène du Guatemala figure parmi les plus pauvres d'Amérique latine.
À l'émigration forcée pendant la guerre civile s'ajoute, depuis les années 1990, une migration internationale à destination des États-Unis et du Canada. Cette migration économique, masculine dans un premier temps, concerne de plus en plus de femmes. Ce phénomène touche une famille guatémaltèque sur trois en 2005. Les transferts d'argent permettent d'améliorer les conditions de vie des familles restées sur place. Toutefois, elles ne résolvent pas les déficiences de l'État, notamment en matière d'éducation et de santé.
Environ 40 % de la population guatémaltèque est pentecôtiste ou protestante, et ce depuis la fin des années 1990, répartis dans plus de trois cents sectes. Le phénomène pentecôtiste révèle aujourd'hui de profonds changements sociaux au Guatemala. Le converti, en s'opposant à la coutume indienne et au catholicisme, se coupe de plus en plus de son passé indigène. Une révolution silencieuse s'est engagée qui, dans les prochaines décennies, peut voir le Guatemala devenir un pays majoritairement protestant.
Malgré les difficultés économiques et de nouvelles formes de violence comme celle des bandes de jeunes gens armés nommées maras, la population guatémaltèque tente à la fois d'asseoir la démocratie et de faire valoir sa culture pluriethnique. Mais la violence et la criminalité restent les problèmes majeurs du pays. C'est pourquoi le général à la retraite Otto Pérez Molina, du Parti patriotique, qui promet une politique répressive contre les maras, est élu à la tête de l'État le 6 novembre 2011. Malgré les efforts déployés par les gouvernements successifs, l'insécurité augmente.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marie-Chantal BARRE : chercheuse et consultante, titulaire d'un doctorat de troisième cycle en études des sociétés latino-américaines de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Paris
- Carine CHAVAROCHETTE : docteur en histoire
- Noëlle DEMYK : professeur de géographie à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot
- Michel GUTELMAN : attaché de recherche au C.N.R.S.
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
GUATEMALA, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
AGUADA FÉNIX, site archéologique
- Écrit par Éric TALADOIRE
- 2 830 mots
- 3 médias
Dans une perspective plus régionale, l’équipe de Richard Hansen poursuit, depuis 1988, une étude systématique dubassin de Mirador, au Guatemala, centrée sur le site majeur éponyme, le plus grand site connu du préclassique terminal. Les travaux ont permis de fouiller plusieurs ensembles majeurs,... -
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE
- 24 173 mots
- 23 médias
Comprenant l'extrême sud duGuatemala, le Salvador, le Honduras et la plus grande partie du Nicaragua, l'Amérique centrale nucléaire est séparée de l'extrême sud du continent nord-américain par la zone de faille senestre de la transversale de Polochic-Motagua. Elle est caractérisée par la présence... -
AMÉRIQUE LATINE - Rapports entre Églises et États
- Écrit par Jean Jacques KOURLIANDSKY
- 6 743 mots
- 2 médias
...sollicita et reçut le soutien des évangélistes. L'un d'entre eux, le pasteur Carlos Garcia accéda même à la vice-présidence après la victoire du candidat. Au Guatemala, deux hommes politiques d'origine catholique, devenus évangélistes et prédicateurs, ont occupé la magistrature suprême, recréant de la sorte... -
ASTURIAS MIGUEL ÁNGEL (1899-1974)
- Écrit par Rubén BAREIRO-SAGUIER et Bernard FOUQUES
- 3 214 mots
- 1 média
Pour pouvoir situer Asturias dans l'ensemble du roman hispano-américain, il faut rappeler ce qu'était avant lui la littérature de ce vaste monde qui s'exprime dans un espagnol variant d'ailleurs avec chaque région. Toute une forme du roman prit naissance avec un événement historique d'une grande importance...
- Afficher les 20 références
Voir aussi
- SERRANO ELIAS JORGE (1945- )
- AGRAIRES RÉFORMES
- LIBRE-ÉCHANGE
- MCCA (Marché commun centre-américain)
- AMÉRIQUE ESPAGNOLE
- PAUVRETÉ
- CIA (Central Intelligence Agency)
- GUERRE CIVILE
- PORTILLO ALFONSO (1951- )
- ARZU ALVARO (1946-2018)
- RIOS MONTT EFRAÍN (1926-2018)
- ALVARADO PEDRO DE (1485 env.-1541)
- PLANTATION AGRICULTURE DE
- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES
- AMÉRIQUE CENTRALE
- LADINO
- CARRERA RAFAEL (1814-1865)
- ARBENZ GUZMÁN JACOBO (1913-1971)
- CASTILLO ARMAS CARLOS (1914-1957)
- ESPAGNOL EMPIRE COLONIAL
- BERGER OSCAR (1946- )
- VOLCANISME ACTUEL
- AGRICOLES EXPLOITATIONS
- CAFTA (Central American Free Trade Agreement)
- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique centrale et Mexique
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945
- BARRIOS JUSTO RUFINO (1835-1885)
- UBICO Y CASTÃNEDA JORGE (1878-1947)
- COLÓM ALVARO (1951-2023)
- RÉPRESSION
- UNITED FRUIT COMPANY
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- ESPAGNOLE LANGUE
- SECTEUR AGRICOLE
- PROTESTANTISME HISTOIRE DU
- CEREZO AREVALO MARCO VINICIO (1942- )