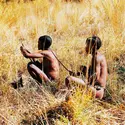GUERRE
Article modifié le
Les groupes humains, quelle que soit leur taille, se reconnaissent comme tels et affirment leur unité en se distinguant d'autres groupes. Il y a entre eux à la fois des affinités et des oppositions qui affectent leurs relations, dans la mesure où celles-ci ont une réalité, c'est-à-dire lorsque la proximité dans l'espace ou les moyens de communication les amènent à se poser les uns par rapport aux autres. Quand il s'agit de groupes qu'on peut considérer comme des totalités, par exemple au niveau des sociétés globales (tribus, nations, empires), les relations susceptibles d'exister entre eux peuvent, au-delà de toutes les nuances possibles, se classer en deux catégories, suivant qu'elles sont de l'ordre de la paix ou de celui de la guerre. Comment définir chacun de ces deux termes ? Quelles sont les causes et les conséquences et quels sont les divers aspects de la paix et de la guerre ? Ces problèmes comportent, certes, des éléments politiques, diplomatiques, militaires ; mais comme ils mettent toujours en cause des collectivités humaines, c'est à l'anthropologie et à la sociologie qu'il appartient d'en connaître au premier chef.
Peut-être y a-t-il toujours eu dans la vie sociale, et aujourd'hui plus que jamais, une inévitable succession de tensions et de périodes de relâchement. Alors, le cycle des guerres et des paix apparaîtrait comme un aspect de ce rythme essentiel. Une telle question s'approfondira si l'on remarque que les conflits sont en quelque sorte institutionnalisés dans la paix, puisque les nations entretiennent un appareil guerrier pour garantir la paix ou se préparer aux hostilités éventuelles, de même qu'inversement les guerres sont faites pour contraindre l'ennemi à accepter une certaine paix. Cette dialectique est-elle fatale ?
Guerre et paix
L'intelligence réciproque de la guerre et de la paix
Les études proprement sociologiques consacrées à la paix sont en nombre extrêmement réduit, surtout si on les compare à toutes celles qui ont trait à la guerre. Il n'en faudrait pas conclure à une préférence marquée de la part des auteurs pour la situation la plus souvent décrite, ou à une infirmité des méthodes d'approche à l'égard de la paix, qui est, indiscutablement, la forme d'existence normale des sociétés, même si l'on admet que les guerres sont inévitables. Les travaux sur la vie sociale en général, sur les institutions, les coutumes, les mœurs portent ordinairement sur ce qui se passe en temps de paix, sans qu'on éprouve le besoin de le spécifier. C'est le cas par exemple pour la plupart des monographies consacrées à tel ou tel peuple. La pauvreté de la littérature sociologique sur l'état de paix n'est donc qu'une apparence. Par contre, quand on décrit la vie des sociétés dans la guerre, c'est-à-dire les transformations que celle-ci apporte à leur existence normale, la cause de ce changement est mise en évidence et se trouve étudiée en elle-même. D'autre part, de même que la psychopathologie fournit des points d'observation privilégiés qui enrichissent la psychologie normale, de même les sociologues ont intérêt à porter leur attention sur ce phénomène social qu'est la guerre : par le fait même qu'il est exceptionnel, il rend en effet perceptibles des mécanismes importants qui, dans la paix, passent inaperçus ou sont à l'état latent. Enfin, la guerre intensifie la fusion des individus au sein de la société et crée une sorte de paroxysme de l'emprise sociale.
Cependant, ici encore, on n'a affaire qu'à une apparence, car en révélant les unités sociales dans leur opposition la guerre renvoie à une explication qui doit être cherchée dans la paix, dans l'état social qui précède les hostilités. Quant aux relations sociales, elles n'arrivent au point de rupture que pour des raisons qu'il faut pressentir dans les conditions de la paix.
Le paradoxe de ces apparences et de ces réalités, qui font s'éclipser réciproquement la paix et la guerre, donne à celle-ci une sorte de priorité dans les définitions, puisqu'elle s'annonce sans conteste dans le fracas des armes, et que la paix se montre, par contraste, quand les combats ne viennent pas troubler la vie des collectivités. On aboutit donc à préciser d'abord le concept de guerre pour définir ensuite celui de la paix comme l'absence de guerre, donc d'une manière purement négative. D'ailleurs le mot « paix » désigne l'acte qui met fin aux hostilités, comme par exemple dans l'expression « paix de Tilsit ». On peut le prendre aussi dans un sens positif, qui lui confère une autre valeur ; c'est ainsi que, selon saint Augustin, la véritable paix ne consiste pas seulement dans l'absence de lutte armée, mais dans l'ordre pacifique (tranquillitasordinis). Inversement, absence de guerre ne signifie pas nécessairement absence de conflit.
Outre ces distinctions inhérentes aux définitions, on peut essayer de classer les différentes sortes de paix. Raymond Aron propose une typologie ternaire fondée sur les répartitions de la puissance, c'est-à-dire sur le rapport entre les capacités qu'ont les unités politiques d'agir les unes sur les autres. De ce point de vue, il s'établit une paix d'équilibre dans laquelle les puissances se font contrepoids, ou une paix d'hégémonie dans laquelle les nations sont dominées par l'une d'entre elles, ou encore une paix d'empire dans laquelle un État impérial confisque l'autonomie des nations qui lui sont soumises. Cependant, ajoute Aron, la paix ne se réduit pas toujours à un rapport de puissance, de sorte qu'aux trois types énumérés il faudrait ajouter la paix d'impuissance qui résulte de la terreur ou de l'intimidation réciproques, comme c'est le cas peut-être avec la menace de représailles atomiques, et la paix de satisfaction, qui constitue une sorte d'idéal dans lequel l'absence de guerre proviendrait simplement de l'absence de revendications.
Causes de la paix et plans de paix
On peut chercher les causes de la paix dans la disparition des causes de guerre. Très souvent, on a été conduit ainsi à dépasser le niveau des faits politiques ou militaires pour s'attacher aux impulsions agressives qui, plus profondément, ont leur siège dans la psychologie individuelle. La pacification définitive tiendrait alors à une amélioration du genre humain. Mais, à ces vues séduisantes, on peut objecter que, dans la réalité, les guerres sont provoquées par des événements, des processus, des décisions qui échappent au contrôle des peuples concernés, de sorte que la paix internationale est un phénomène sui generis qui ne peut pas s'expliquer uniquement par la psychologie individuelle ou interindividuelle.
Les plans de paix, plus ou moins réalistes ou utopistes, sont nombreux dans l'histoire diplomatique et dans celle des idées. Outre les plans qui se fondent sur des partages d'influence, et par conséquent sur le principe d'équilibre, ou sur la domination, on peut ranger dans une catégorie générale ceux qui visent à supprimer une cause de guerre. Comme le constate Gaston Bouthoul, la plupart de ces projets conduisent à l'élimination du motif de guerre qui a précédé leur élaboration. Ainsi, le plan de Sully aboutissait surtout à établir que la période des guerres de religion était révolue ; ceux de Rousseau et des Girondins prenaient acte de la fin des guerres dynastiques. D'autres plans encore cherchent à contrôler les moyens de la guerre, avec l'espoir que le désarmement général rendra celle-ci impossible, et avec l'idée que disparaîtra ainsi cette incitation à la violence qu'entraîne la possession d'armes efficaces.
Plus positifs furent les projets conduisant à l'élaboration d'instances supranationales, comme la Société des Nations (1919), puis l'Organisation des Nations unies (1945), dont la mission n'était pas seulement de mettre la guerre hors la loi, mais d'instaurer une concertation régulière entre les puissances. Cependant, le problème d'une force permettant de faire respecter les décisions d'arbitrage reste difficile à résoudre.
Enfin, plus utopiques, plus éloignés en tout cas des réalisations actuelles sont les projets de fédération mondiale ou d'État mondial qui visent à faire reposer la paix soit sur la suppression des nations, soit sur leur fusion progressive en une unité plus vaste.
Une lutte entre collectivités organisées
Si l'on veut donner au mot « guerre » un sens assez précis et pas trop éloigné de l'usage courant, on doit pouvoir distinguer la guerre du simple conflit ou de la lutte entre individus. Toute définition doit donc mettre en évidence le caractère collectif de la guerre et aussi le fait qu'elle suppose l'emploi des armes. Cependant, cela n'implique pas que le conflit dont elle est la manifestation se réduise entièrement à son aspect militaire. En ce sens, Quincy Wright a raison de dire qu'elle est « un conflit simultané de forces armées, de sentiments populaires, de dogmes juridiques, de cultures nationales ». Mais il n'y a pas de guerre à proprement parler tant que ces tensions n'aboutissent pas à la lutte violente. Il faut même, pour que ce concept puisse être employé, que l'affrontement ne soit pas trop limité.
D'autre part, une guerre présente toujours une certaine dimension dans le temps. Ainsi, le heurt de deux armées qui dure seulement quelques heures fait plutôt penser à un coup de main. Pourtant, on peut se demander si, dans le cas inverse d'une période très longue d'hostilités, comme par exemple dans la guerre de Cent Ans, on doit parler d'une guerre ou d'une série de guerres entrecoupées de trêves, ou de combats dispersés. En général, on convient de considérer que l'état de guerre se prolonge aussi longtemps qu'un traité de paix ou un armistice ayant un effet durable n'y a pas mis fin.
On peut enfin avoir quelque difficulté à préciser la nature sociologique des groupes dont l'affrontement armé constitue une guerre. Lorsqu'il s'agit de nations, de « sociétés globales » organisées, un tel problème ne se pose pas. Mais à l'intérieur d'un empire, et plus encore au sein d'une nation, des luttes armées de province à province, de clan à clan, ou bien encore entre sectes religieuses, entre classes, entre féodaux ou entre grandes familles mobilisant leurs clientèles peuvent avoir ou ne pas avoir une ampleur voisine de celle qui caractérise la guerre. À la limite, on se demandera si toute guerre civile est à proprement parler une guerre. Il semble plus conforme à l'usage de réserver ce terme aux cas où sont opposées des collectivités possédant chacune une certaine autonomie soit par essence, soit par la décision qu'elles prennent et mettent en action à ce propos de se constituer en unités séparées.
Si l'on veut réunir en une formule les principaux critères retenus, on définira la guerre comme une lutte armée et homicide, présentant une certaine amplitude et se déroulant dans une certaine durée de temps, entre des collectivités organisées ayant une autonomie politique au moins relative.
L'état de guerre est d'ailleurs relativement aisé à discerner dans la mesure où, le plus souvent, il n'est pas seulement un état de fait mais se présente comme une situation socialement reconnue. Même lorsqu'il n'y a pas effectivement de déclaration de guerre dans les règles, l'opinion internationale est en général d'accord pour faire la différence entre un incident de frontière et une guerre proprement dite. Par exemple, le conflit israélo-arabe se présente comme une longue période de tension marquée par de nombreux incidents militaires, parfois sanglants, dans laquelle pourtant on repère des épisodes appelés « guerres », tels ceux qu'on désigne sous le nom de « guerre de Six Jours » (1967), de « guerre du Kippour » (1973), et dont on fait coïncider le début avec une offensive de grande envergure et la fin avec la signature d'un armistice, fort éloigné d'être une paix dans le sens positif du terme.
Poussant plus loin l'assimilation de la guerre à une situation institutionnalisée, les juristes des xviiie et xixe siècles l'ont définie par l'égalité des droits que possèdent les deux parties adverses à régler leur conflit par les armes, ce qui entraîne l'abstention des neutres.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean CAZENEUVE : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Paris-IV-Sorbonne
- P. E. CORBETT
: auteur de
Law in Diplomacy - Victor-Yves GHEBALI : professeur à l'Institut universitaire de hautes études internationales, Genève
- Q. WRIGHT
:
emeritus professor of international law , université de Chicago
Classification
Médias
Autres références
-
BOUTHOUL GASTON (1896-1980)
- Écrit par Hervé SAVON
- 1 272 mots
Juriste et sociologue, docteur en droit et docteur ès lettres, Gaston Bouthoul aurait pu s'engager dans une carrière universitaire classique qui eût été assurément brillante. Mais ce non-conformiste tranquille a craint d'aliéner ainsi une trop grande part de sa liberté. Entré au barreau (il fut notamment...
-
CALLIGRAMMES, Guillaume Apollinaire - Fiche de lecture
- Écrit par Guy BELZANE
- 1 627 mots
...du recueil, signalée par son titre même, on ne saurait tenir pour secondaires les circonstances de sa rédaction, et, de fait, sa thématique centrale – la guerre – dont Apollinaire donne une vision profondément originale. À sa parution et plus encore dans les années qui ont suivi, Calligrammes n’a... -
CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 728 mots
- 3 médias
...Néolithique, quand apparaissent la fortification des villages et la création d’armes ad hoc. Dans les observations ethnographiques, la fréquence de la guerre semble varier suivant les régions et relever souvent de la vendetta, d’autant qu’elle ne met aux prises que quelques dizaines de combattants. En... -
CLAUSEWITZ KARL VON (1780-1831)
- Écrit par André GLUCKSMAN
- 4 636 mots
Savoir rassembler ses forces, tout subordonner à la nécessité d'obtenir une victoire décisive, telle est la condition première de toute stratégie efficace et rationnelle. Chaque guerre est recherche de la décision, le moyen de cette décision est l'épreuve de force (réelle ou potentielle). « Cette unicité... - Afficher les 22 références
Voir aussi
- SDN (Société des nations)
- SANCTIONS
- GUERRE RÉVOLUTIONNAIRE
- ACTION HUMANITAIRE
- SOCIÉTÉS PRIMITIVES ou PRIMITIFS
- PROTECTION CIVILE ou SÉCURITÉ CIVILE
- AGRESSION
- REDDITION
- GUERRE DROIT DE LA
- NEUTRALITÉ
- KELLOGG FRANK BILLINGS (1856-1937)
- ARMES CHIMIQUES & BIOLOGIQUES
- ARMEMENTS CONTRÔLE DES
- VAN BINKERSHOEK CORNELIUS (1673-1743)
- BRIAND-KELLOGG PACTE (1928)
- BLESSÉS DE GUERRE
- MILITAIRES DOCTRINES ET TACTIQUES
- GUERRE CIVILE
- BOMBE ATOMIQUE
- GAZ DE COMBAT
- GUERRE TOTALE
- LUDIQUE ACTIVITÉ
- CONCILIATION
- HAYE CONFÉRENCES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES DE LA
- MARITIME DROIT
- WRIGHT QUINCY (1870-1970)
- PAIX, maintien de la paix et règlement des différends
- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES
- NAVIRES DE COMMERCE
- CONFLIT ARMÉ