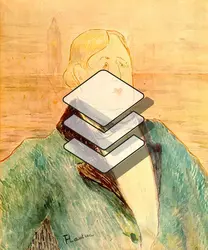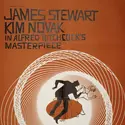TOULOUSE-LAUTREC HENRI DE (1864-1901)
Article modifié le
Toulouse-Lautrec , c'est une vie. Une vie singulière, entièrement commandée par un événement initial, accidentel, aux conséquences effroyables. Comme cet homme ainsi marqué d'un sceau fatal fut un artiste, on ne peut étudier son art sans tenir compte de sa biographie. Au reste, son cas est analogue à celui de quelques grands artistes et grands poètes contemporains, apparus dans une société bourgeoise fortement structurée, ayant ses croyances, ses modes, sa morale, et qui ont trouvé dans les particularités de leur destin une incitation à s'exprimer en totale opposition à tout ce conformisme. Ainsi, il s'est produit, dans le domaine des formes et des idées, au cours des vingt dernières années du xixe siècle, une rupture due à la subjectivité de quelques hommes de génie. Et le terme de génie prend ici tout son sens de différence radicale et décisive.
Toulouse-Lautrec a été un de ces hommes. Si, en tant qu'artiste, il doit être considéré comme une des sources de ce qu'on appellera l' expressionnisme, c'est que son drame personnel a fait naître en lui un besoin d'expression d'une violence extrême. C'est cette violence d'expression qui constitue son art et son style.
La condition de Toulouse-Lautrec
Henri de Toulouse-Lautrec est né à Albi, du comte Alphonse de Toulouse-Lautrec-Monfa et de la cousine de celui-ci, Adèle Tapié de Céleyran. Vieille noblesse occitane, qui remonte peut-être aux comtes de Toulouse, héros des guerres cathares. Et noblesse campagnarde, confinée dans sa province et dans des traditions chimériques. Le jeune garçon est élevé dans les propriétés de la famille, puis il ira au lycée à Paris. Son père est un personnage extravagant, féru de courses et de chasses. D'ailleurs, tout cet énorme groupe tribal vit dans la familiarité des chiens et des chevaux, et ceux de ses membres qui ont un brin de talent de dessinateur ou d'aquarelliste – talent souvent remarquable – en font leurs modèles favoris à côté de portraits de parents. La mère du jeune Henri est une créature malheureuse, d'une douceur et d'une sensibilité qui tranchent avec les allures de ce petit monde féodal. Elle sera adorée de son fils.
Deux accidents, à quelques mois de distance, en 1878, font de ce fils un nabot. Il a quatorze ans. Son sort est dès lors tracé : celui d'un marginal, sinon d'un monstre. Le buste témoigne encore de l'homme vigoureux, sportif, amateur d'équitation, de natation, de navigation, qu'il eût dû rester, que, furieusement, il s'acharne à rester pour la rame et la voile. Les jambes sont raccourcies, torses, atrophiées. La tête, là-dessus, semble démesurée. Néanmoins, toute blessée, injuriée qu'elle est, la vitalité de cet être se montre encore impatiente, éclate en un besoin forcené de déambulation en une bousculade de propos fantasques. Mais il ne se peut que l'avilissement physique ne transperce, dans l'expression du visage, la beauté du regard derrière le binocle, les lèvres épaisses et tristes, encadrées par la faunesque rudesse de la barbe et de la moustache. Cet homme, plus qu'aucun autre, a pris conscience de ce que peut devenir un destin absurde quand plus rien ne l'arrête : on croirait qu'il va toucher au tragique, au sublime. En réalité, il atteint le niveau du grotesque.
La vocation de Lautrec a éclaté très tôt, encouragée par un peintre ami de la famille, Princeteau, sourd-muet, donc touché, sans doute, de se découvrir un petit frère dans un autre infirme. Cette vocation, d'emblée, brûle les étapes. Le jeune Lautrec trouve dans le dessin le moyen le mieux approprié à rendre cette vérité de caractère et de relief, presque caricaturale, qui, pour lui, est la vérité des gens et des choses, celle de tous les personnages de son entourage, y compris, bien entendu, les chevaux. En peinture aussi il use d'un coup de brosse léger, nerveux, produisant la même sorte d'effet. En 1882, il s'installe à Paris avec la candide intention de faire son apprentissage en commençant par l'école des Beaux-Arts. Mais bientôt il découvre ce qui, en authentique matière d'art, se passe à Paris : la fondation des Indépendants, la huitième et dernière exposition des impressionnistes, Degas, Van Gogh, Gauguin. Il a loué un atelier au coin de la rue Tourlaque et de la rue Caulaincourt, à Montmartre, désormais sa patrie. Il est chez lui au cirque Fernando, au Moulin de la Galette, au Moulin-Rouge, dans les cabarets, le Mirliton où règne Aristide Bruant, les bals, les buvettes populaires, et çà et là, par contraste, trouve un lambeau de végétation sauvage et obstinée, comme le jardin du père Forest.
Toulouse-Lautrec est un génie urbain. Il ignore l'air et la lumière de la nature et les problèmes que les éléments ont posés à ses prédécesseurs, ses amis, les impressionnistes. À la ville, surtout la ville des villes, Paris, il en va autrement : on y est presque exclusivement sensible aux êtres humains. La rue n'est pas une atmosphère, ni un site ou un décor, mais le lieu – pareil à certains autres spécifiquement établis et désignés – où des êtres humains se manifestent par leur geste, leur physionomie, leur habillement, et si vite que l'œil n'en retient que quelques traits, une silhouette, un signe graphique. Cette même ville, le malheureux Lautrec est incapable de participer à sa vie tumultueuse par le travail social ou la relation mondaine. Il n'en connaît donc qu'un fragment, et dans lequel toute vie se réduit aux artifices du spectacle et du plaisir, et se concentre dans la nuit.
Étourdissant de cocasserie, brûlé d'alcool, il vagabonde à travers la nuit, à l'aide de son « petit bout de canne », de son « crochet à bottine », en compagnie de ses amis, qui l'adorent malgré son despotisme, et dont le nombre ira croissant, son camarade de lycée et futur biographe Maurice Joyant, le cousin Gabriel Tapié de Céleyran, Paul Leclercq, Maxime Dethomas, les peintres Bonnard et Vuillard, créateurs d'un nouveau modernisme, les écrivains de la Revue blanche, Thadée Natanson qui a laissé sur lui le plus beau livre de souvenirs qui soit, Tristan Bernard, Romain Coolus – et tant d'autres qui sont, comme lui, curieux de rencontres saugrenues et poétiques, mais aussi amateurs et connaisseurs, et très raffinés. Amateurs et connaisseurs d'un certain art que produit la vie lorsqu'elle se résume ainsi en un artifice. Mais cet art de l'artifice est prodigieux. Le travail, tel que nous l'entendons avec sa nécessité vitale et sa finalité sociale, est banni de ce monde fermé du Montmartre nocturne : c'est exact, mais il convient d'observer que l'artifice et le plaisir ne s'obtiennent pas sans un travail d'une autre sorte et dépourvu d'utilité générale, travail quand même, que notre bande de connaisseurs sait apprécier, travail d'une tension formidable et d'une minutie horlogère, et qui assure la perfection du bond de l'écuyère, de l'entrechat de la danseuse, du tour de chant de la divette de café-concert. Thadée Natanson nous conte que Lautrec voyait partout une question de technique ; « technique » était un de ses mots favoris, et il l'articulait avec une gravité comique : tek-nik. Technique aussi sans doute l'art du chirurgien dont Lautrec s'émerveillait autant que de celui de cette belle machine pleine de risques qu'était le quadrille du cancan. Le cousin Gabriel, qui faisait sa médecine, l'avait conduit aux grandes représentations que donnait à son hôpital, dans ses opérations chirurgicales publiques, le professeur Péan, virtuose du scalpel, en habit noir, lui aussi, qui est la tenue de la scène, de la haute noce et de tous les offices nocturnes. Lautrec en tirera nombre de dessins à l'encre et deux tableaux.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean CASSOU : écrivain
Classification
Médias
Autres références
-
ELLES (H. DE TOULOUSE-LAUTREC )
- Écrit par Barthélémy JOBERT
- 238 mots
Les onze pièces publiées par Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) pour la suite Elles sont à la fois caractéristiques de ses thèmes favoris (à l'exception de la clownesse Cha-U-Kao, toutes les femmes qu'il représente appartiennent en effet au monde des maisons closes) et de sa pratique de l'...
-
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC ET L'ESTAMPE - (repères chronologiques)
- Écrit par Barthélémy JOBERT
- 670 mots
1891 Moulin Rouge, La Goulue, à la fois la première lithographie de Lautrec et sa première affiche (toutes seront dans cette technique). L'œuvre démontre son habileté technique et stylistique. Par l'économie de moyens et la simplification des formes (la profondeur de la scène ne vient que de...
-
AFFICHE
- Écrit par Michel WLASSIKOFF
- 6 818 mots
- 12 médias
La découverte de l'estampe japonaise exerce également en Occident une impression profonde.Henri de Toulouse-Lautrec (La Goulue, 1891) et Pierre Bonnard (La Revue blanche, 1895) s'approprient ses procédés : asymétrie, aplats de couleur, délimitation des surfaces par des cernes épais. Dessinant souvent... -
ALBI, histoire et histoire de l'art
- Écrit par Marcel DURLIAT
- 1 090 mots
- 2 médias
En dépit des aléas de l'histoire, Albi a toujours joué le rôle d'une petite capitale régionale. La contrée dont elle a orienté le destin n'est pas une région naturelle. La ville a établi sa zone d'influence en organisant et en contrôlant les échanges entre deux domaines complémentaires...
-
IMPRESSIONNISME
- Écrit par Jean CASSOU
- 9 486 mots
- 32 médias
...comme plus tard chez les Nabis. Mais il éclate avec une force prodigieuse chez un artiste, qu'on ne peut séparer de Degas qu'il admirait : Toulouse-Lautrec. Il est, lui aussi, un aristocrate, issu d'une grande famille du pays d'Oc. Deux fractures successives des deux fémurs en ont fait un... -
LITHOGRAPHIE ORIGINALE AU XIXeSUP SIÈCLE - (repères chronologiques)
- Écrit par Barthélémy JOBERT
- 412 mots
1819 Francisco Goya exécute sa première lithographie. Mais c'est en France, durant son exil, qu'il pratiqua véritablement la nouvelle technique, à Paris mais surtout à Bordeaux, où il réside et où il exécute la série des Taureaux dits de Bordeaux (1825).
1820 Début de la publication...
Voir aussi