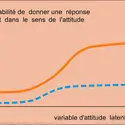SPENCER HERBERT (1820-1903)
Article modifié le
L'extension à la sociologie du « postulat universel »
La connaissance unifiée devait précisément résulter du système rationnel élevé sur le principe de la persistance de la force reconnu agissant dans l'« organique » comme dans le « sur-organique », domaine pour l'étude duquel Spencer a emprunté au premier quelques notions essentielles.
Revus par Huxley pour la zoologie et par Hooker pour la botanique, les Principes de biologie (1864-1867), ouvrage que son auteur considérait « comme ayant le plus de valeur », reprenaient, en la fondant dans la théorie générale de l'évolution, la doctrine darwinienne, ébauchée par Malthus, de la sélection naturelle. En ramenant, d'autre part, l'acquisition d'une structure différenciée à la subdivision croissante des fonctions, Spencer appliquait à la vie organique l'idée de Milne-Edwards de la division physiologique du travail ; idée riche de prolongements, car, si celle de la lutte pour la vie fut exploitée par Bagehot et Gumplowicz, on peut dire que De la division du travail sociallui doit un de ses points de départ, même si Durkheim ne l'a pas expressément mentionné, et le fonctionnalisme une de ses sources. Dans les Principes de sociologie, dont les trois volumes parurent entre 1877 et 1896, les structures et les fonctions sociales furent donc comparées aux structures et aux fonctions biologiques précédemment étudiées.
Mais il ne faut pas exagérer le « biologisme » de Spencer. Malgré des abus de comparaison, il n'omit pas de souligner les dissemblances existant entre les organismes régis par la loi de la symétrie et la société qui est, par nature, asymétrique. Ses convictions politiques et éthiques l'amenèrent même à accentuer certaines différences qui distinguent les sociétés humaines des sociétés animales. En déclarant que les cellules de l'unité biologique sont subordonnées au tout, tandis que la société doit exister pour l'intérêt de chacun de ses membres, Spencer visait le socialisme dans lequel il voyait la forme moderne du despotisme militaire.
Il convient de même d'observer que son évolutionnisme, s'agissant des phénomènes sociaux, n'eut rien de rigide. Si sa typologie où s'opposent société militaire et société industrielle n'est pas sans rappeler celle de Comte, ni sans présenter bien des affinités avec les types sociaux caractérisés par Durkheim, elle gagne à être rapprochée de la classification élaborée par Oswald Spengler en termes nietzschéens et qui, comme on sait, a été reprise par Ruth Benedict dans ses Patterns of Culture. Bien que la vision cyclique en soit absente (encore que Spencer ait précisé que les sociétés naissent et meurent comme les individus et qu'à ses yeux le socialisme soit apparu comme une régression), la typologie spencérienne doit être dissociée du schéma optimiste d'une progression linéaire, solidaire du développement du machinisme. Ainsi que l'a remarqué J. Cazeneuve, ce sont les conditions qui sont faites aux individus et les institutions qui les régissent qui ont fourni à l'auteur des Principes les critères de sa dichotomie. D'où ses longues analyses consacrées aux institutions domestiques, cérémonielles, politiques, ecclésiastiques, industrielles et professionnelles, dont l'amélioration doit suivre la décadence de l'organisation militaire que Spencer dit, cependant, initialement essentielle, puisque c'est par la guerre, qui joue un grand rôle dans la genèse du pouvoir politique, que les peuples parviennent à la notion d'État.
Sous cet éclairage, son portrait du primitif n'apparaît pas sans nuances. On a critiqué son explication de la religion primitive, qui part de la constitution de la notion de dualité pour aboutir, par la croyance à la survie du double et la formation de la notion d'esprit, au culte des ancêtres, et l'on a mis en doute l'« évidente » acquisition de la notion de dualité sur laquelle elle se fonde, par le primitif identifié à l'enfant du civilisé. Il est de fait que, dans le premier volume des Principes de sociologie, l'unité des processus mentaux est postulée, la fonction spécifique des pratiques rituelles négligée, et que, prisonnier de son interprétation individualiste, Spencer n'a pas su voir dans les croyances ces représentations collectives que Durkheim et Mauss devaient mettre en lumière. Mais on peut se demander si certaines de ses explications ne sont pas plus modernes que celles d'un Lévy-Bruhl qui, dans ses premiers ouvrages, a opposé radicalement la mentalité prélogique du primitif et la mentalité du civilisé. « Nous devons partir du postulat que les idées primitives sont naturelles et, dans les conditions où elles se produisent, rationnelles », écrit Spencer (Principes de sociologie, t. I), pour qui le primitif, remplaçant les relations complexes par des relations simples, aboutit à un classement erroné dans la mesure où la complexité des choses ne correspond pas à la complexité de son esprit. On peut se demander également si certaines des « illusions évolutionnistes » dénoncées par A. Lalande n'ont pas contribué au développement de la théorie psychanalytique dans laquelle on sait la place importante qu'occupent les processus d'intégration ; à moins qu'elles n'en relèvent directement comme ces idées de sommeil et de rêves (ibid., t. I, chap. x), ou la notion de double qui bénéficierait d'être rattachée à un souvenir d'enfance de Spencer (Autobiographie). Il est établi, en tout cas, que les idées de multiplication des effets, de ségrégation, d'interdépendance ont été intégralement reprises par Pareto dans son analyse de la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux.
Ne serait-ce que par l'extraordinaire richesse des matériaux mis en œuvre par Spencer, qui est à l'origine d'une vaste collecte des données d'où il voulait dégager des « corrélations sociologiques » que les historiens de son temps étaient, croyait-il, incapables d'apercevoir, les Principes de sociologie sont autre chose que la simple illustration de la thèse aujourd'hui contestée du progrès conçu comme une « nécessité bienfaisante ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard VALADE
: professeur à l'université de Paris-V-Sorbonne, secrétaire général de
L'Année sociologique
Classification
Média
Autres références
-
ANCÊTRES CULTE DES
- Écrit par Mircea ELIADE et Encyclopædia Universalis
- 3 199 mots
- 1 média
C'estHerbert Spencer (1820-1903) qui, le premier parmi les modernes, a fortement souligné l'importance des ancêtres dans l'histoire des religions. En effet, pour le philosophe anglais, le culte des ancêtres serait à l'origine même de la religion. Le « sauvage » considère comme surnaturel ou divin tout... -
ARCHAÏQUE MENTALITÉ
- Écrit par Jean CAZENEUVE
- 7 048 mots
...organisation, la structure et la morphologie de ces sociétés ; sa théorie de la formation des collectivités primitives, qui sur certains points reprenait celle de Spencer, est restée classique, mais n'a pas réussi beaucoup mieux que celle de Spencer à se dégager d'une hypothèse évolutionniste particulière. Pour... -
ATTITUDE
- Écrit par Raymond BOUDON
- 4 176 mots
- 2 médias
Le mot attitude vient du latin aptitudo. Son sens primitif appartient au domaine de la plastique : « Manière de tenir le corps. [Avoir] de belles attitudes », dit Littré. Du physique le terme se transpose au moral : « L'attitude du respect » ; puis il déborde le moral pour indiquer des dispositions diverses...
-
BIOLOGISME
- Écrit par Sébastien LEMERLE et Carole REYNAUD-PALIGOT
- 2 772 mots
...biologiques. Les théories de Charles Darwin font également l’objet d’application à la sphère sociale ( darwinisme social) sous des plumes influentes. Les théories d’Herbert Spencer, qui font de la lutte pour l’existence et la sélection naturelle le moteur des sociétés humaines, ou encore celles... - Afficher les 12 références
Voir aussi