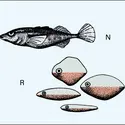HIBERNATION
Article modifié le
Par hibernation on entend la « manière de passer l'hiver ». Il s'agit d'une faculté qu'ont certains êtres vivants de s'adapter aux conditions climatiques hivernales : abaissement de la température moyenne, réduction des heures d'éclairement, diminution des précipitations. On rencontre les formes d'hibernation les plus prononcées dans les climats tempérés frais où les caractères de l'hiver sont particulièrement nets.
L'adaptation que représente l'hibernation correspond à une diminution des manifestations vitales, c'est-à-dire à une réduction de la dépense d'énergie ; végétaux, Invertébrés et Vertébrés obtiennent ce résultat par des procédés très variés, lorsque les conditions climatiques les y obligent. Il en va autrement pour la plupart des Mammifères et des Oiseaux, qui se sont rendus indépendants des conditions climatiques et conservent durant toute l'année une température élevée et constante, correspondant à une dépense d'énergie forte : ce sont des homéothermes. Ceux d'entre eux qui passent à un état de vie ralentie en hiver sont dits hibernants.
L'hibernation chez les Mammifères
Les Mammifères hibernants
L'hibernation des Mammifères se rencontre dans tous les ordres, des Monotrèmes et Marsupiaux jusqu'aux Primates (Lémuriens), mais surtout chez les Rongeurs (marmottes, spermophiles, loirs, hamsters, lérots, etc.). Parmi les Insectivores hibernants, on connaît le hérisson, le tenrec, le setifer. Chez les chauves-souris des régions tropicales, les macrochiroptères sont homéothermes et présentent une température centrale constante au froid, tandis que les microchiroptères meurent en hypothermie quand la température ambiante approche 10 0C. En revanche, les microchiroptères des zones tempérées sont hibernants. Bourlière a, le premier, interprété cette particularité comme le fruit d'une adaptation des microchiroptères tropicaux aux conditions climatiques des régions tempérées. De fait, on peut mettre en évidence chez tous les hibernants certains caractères d'espèces d'origine tropicale : ils sont naturellement mal protégés contre le froid, aussi sont-ils obligés, pour ne pas se refroidir, d'augmenter leurs combustions énormément, beaucoup plus que les espèces originaires de régions plus froides. En automne, ils « renoncent » à s'épuiser en luttant contre le froid quand ils ne trouvent plus le combustible (la nourriture abondante) nécessaire pour assurer des combustions intenses.
Physiologie de l'hibernation
Le moment où les hibernants entrent en sommeil est assez indépendant des conditions climatiques. Dans une région déterminée, les hibernants disparaissent à une époque assez précise, mais la même espèce (ou une espèce voisine) vivant à une latitude plus élevée, ou à plus haute altitude, peut disparaître plus tôt. Cette disparition plus élevée, ou à plus haute altitude, coïncide avec un degré assez marqué d'engraissement et une involution de nombreuses glandes endocrines (antéhypophyse, glandes sexuelles, thyroïde, cortex surrénalien, pancréas endocrine). Les parathyroïdes, au contraire, sont très actives, comme aussi la graisse brune interscapulaire qui est, à la fois, une réserve de graisse et une glande à sécrétion interne jouant un rôle essentiel dans le réchauffement des hibernants.
On a longtemps considéré l'involution de l'appareil reproducteur comme caractéristique de l'hibernation. Barkow (1846) a nié l'hibernation de l'ours en se fondant sur le fait que la femelle met bas en janvier et allaite jusqu'en mars. Aujourd'hui, on sait que l'ours est hypothermique en hiver (31 0C de température rectale) et qu'il est dans cet état devenu inoffensif ; Hock (1958) a parlé de carnivorean lethargy. De fait, par unité de poids et par heure, l'ours en sommeil ne consomme pas plus d'oxygène (20 ml) qu'une chauve-souris de 5 g à 0 0C, qu'un loir de 100 g à 5 0C, qu'une marmotte de 4 kg à 5-10 0C, qu'un tenrec de 600 g à 15 0C. Tous les hibernants en sommeil produisent pratiquement 0,1 kcal par kilo à la température qui leur est la plus favorable pour cet état.
Sommeil et sommeil hivernal
Les hibernants à activité diurne, comme la marmotte, entrent en sommeil quotidien le soir ; au début de l'automne, la marmotte se refroidit de plus en plus à chaque endormissement vespéral. Lorsque sa température est tombée au-dessous de 12 0C, elle ne se réveille que le surlendemain ou même plus tard : elle est entrée en hibernation. Quant au loir et au lérot, animaux à vie nocturne, c'est le matin qu'ils s'endorment et c'est aussi le matin qu'ils entrent en hibernation.
Aucun hibernant ne peut dormir tout l'hiver de façon ininterrompue. On assiste à des réveils périodiques : tous les 5 à 6 jours chez le hamster, 7 à 15 jours chez la marmotte, 15 jours à 3 semaines chez le loir et le spermophile d'Europe. Si le réveil périodique n'a pas lieu, l'hypothermie de l'hibernation conduit à la mort. Si l'on extirpe en été l'hypophyse de l'animal et qu'on le place en chambre froide, il devient hypothermique et s'endort, mais il ne se réveille pas, et, au bout de 8 jours, il meurt : les réveils périodiques sont une nécessité.
L'endormissement n'est pas un phénomène passif : chez l'hibernant qui s'endort, la température baisse régulièrement, puis elle se stabilise pour décroître ensuite plus rapidement. De telles variations de l'émission de chaleur montrent qu'il ne s'agit pas d'un processus passif.
Au cours de leur léthargie hivernale, les hibernants se réveillent si la température ambiante tombe au-dessus d'une certaine valeur qui varie avec les espèces ; elle est particulièrement basse pour les chauves-souris et particulièrement élevée pour le tenrec. On peut en conclure qu'il existe une température optimale pour le sommeil hivernal.
Estivation
L' hibernation du tenrec a été qualifiée d'estivation, non pas parce que le tenrec dort durant l'hiver austral, c'est-à-dire l'été boréal, mais parce que la température adéquate pour l'hibernation est de 15 0C et que, si elle s'abaisse et atteint 12 0C, le tenrec peut se réveiller. Bien des Mammifères primitifs – tel le marmouset d'Amérique tropicale – entrent en sommeil saisonnier en été quand la température ambiante tombe au-dessous de 20 0C. Contrairement à ce que l'on a supposé un certain temps (Shaw, 1925 ; Kashkarov et Levis, 1927), il ne s'agit pas d'une léthargie estivale chez des hibernants ne trouvant plus de nourriture verte hydratée ; quand l'animal ne trouve plus que de la nourriture sèche, il renonce à s'alimenter et c'est le jeûne, combiné à une température relativement basse, qui entraîne le sommeil « estival ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Charles KAYSER : professeur honoraire à la faculté de médecine de Strasbourg.
Classification
Médias
Autres références
-
CHÉLONIENS ou TORTUES
- Écrit par Vivian de BUFFRÉNIL
- 4 616 mots
- 6 médias
Lacapacité d'hibernation des Chéloniens en réponse au froid, dans les régions tempérées, ou à la sécheresse, dans les régions arides et désertiques, est considérable : certaines populations passent jusqu'à 6 mois en état de vie ralentie. Les formes terrestres et les formes amphibies hibernent... -
CHIROPTÈRES ou CHAUVES-SOURIS
- Écrit par Robert MANARANCHE
- 2 189 mots
- 2 médias
Undernier trait remarquable de la biologie des Chiroptères mérite d'être évoqué : leur aptitude à l'hibernation. En relation avec l'absence d'insectes actifs durant la période froide, les Chauves-Souris entomophages, des régions tempérées surtout, ont un sommeil hivernal... -
COMPORTEMENT ANIMAL - Fondements du comportement
- Écrit par Dalila BOVET
- 2 830 mots
- 5 médias
Les comportementsd'hibernation des marmottes sont stimulés à la fois par des rythmes endogènes, par la longueur du jour et par la température. Les rythmes endogènes peuvent parfois suffire, au moins pendant un certain temps : l'écureuil terrestre américain entrera en hibernation même s'il est en... -
MAMMIFÈRES
- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT , Robert MANARANCHE , Pierre-Antoine SAINT-ANDRÉ et Michel TRANIER
- 10 799 mots
- 20 médias
Un autre phénomène qui peut paraître en contradiction avec l'homéothermie, qui a été soulignée comme un caractère mammalien, est l'hibernation ou sommeil hivernal accompagné d'une baisse importante de la température du corps. Beaucoup de Microchiroptères, de Rongeurs et d'Insectivores hibernent.... - Afficher les 8 références
Voir aussi