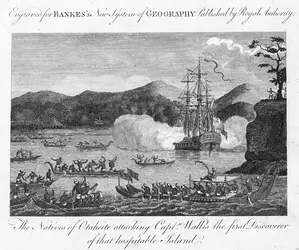PACIFIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN
Article modifié le
L'affirmation du Pacifique comme centre économique et géopolitique
Le Pacifique des lendemains de la Seconde Guerre mondiale ne resta pas bien longtemps une zone incontestée d'influence américaine, car l'U.R.S.S. puis la Chine à partir de 1949 encouragèrent le développement de conflits régionaux (guerre de Corée, 1950-1953 ; insurrections communistes aux Philippines ; guerre d'Indochine puis du Vietnam, 1945-1975). En même temps, les mouvements d'indépendance affectèrent d'abord de grands pays riverains comme les Indes néerlandaises, devenues Indonésie (1949), la Malaisie (1957), séparée en 1965 de Singapour, mais s'étendirent ensuite aux îles et archipels océaniques, même minuscules, donnant naissance à une série de micro-États qui gardent souvent des liens étroits avec les anciennes puissances de tutelle. On aboutit ainsi à un nouveau partage du Pacifique. Ces jeunes États ne comptent bien sûr ni par leur superficie de terres émergées (sauf la Papouasie - Nouvelle-Guinée), ni par leur population. Ils ont néanmoins bénéficié jusqu'à ces toutes dernières années d'une attention particulière et d'aides importantes de la part des grandes puissances mondiales et des organismes internationaux. À cela, plusieurs raisons :
– D'abord, la définition des zones économiques exclusives de 200 milles a donné à ces archipels fragmentés en de multiples îlots éparpillés sur de grandes distances le contrôle d'immenses surfaces océaniques : le meilleur exemple est celui des modestes îles Kiribati (ex-Gilbert) qui, avec 690 kilomètres carrés et 65 000 habitants, disposent d'un espace maritime de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés, sept fois la surface de la France. Cela signifie la mainmise sur des zones de pêche (thons tropicaux) considérables, dont ces petits États peuvent monnayer l'exploitation, et, ultérieurement peut-être, sur des richesses sous-marines encore inexploitées (nodules polymétalliques).
– Ensuite, ces petits États se sont trouvés placés au cœur d'un espace maritime qui a été l'un des grands enjeux stratégiques de la rivalité entre les grandes puissances dans le cadre de la guerre froide et de ses prolongements ; la présence des États-Unis, de l'U.R.S.S., de la Chine, du Japon, mais aussi celle de Taiwan, des deux Corées, du Vietnam sur les rives du Pacifique conférait aux archipels situés au cœur de celui-ci un intérêt géostratégique indéniable, dont certains ont bénéficié ou parfois même ont su jouer pour obtenir des soutiens internationaux nécessaires à leur développement. On peut remarquer aussi que la petite taille de ces espaces insulaires rend l'aide qui leur est apportée plus « gratifiante » pour les donateurs que celle qui s'engloutit dans de grands États continentaux en situation de détresse économique.
– Au milieu des années 1990, les données des rivalités, voire des affrontements internationaux ont en partie changé de nature avec l'effondrement de l'U.R.S.S. et l'affirmation de la prépondérance au moins militaire des États-Unis. Dans le domaine économique, le poids du monde Pacifique n'a cessé de se renforcer depuis déjà plusieurs décennies au point d'apparaître comme l'espace le plus dynamique et le plus prometteur en termes de développement des activités, des échanges et des emplois. Sont riverains du Pacifique non seulement les deux plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis et le Japon, mais encore nombre d'autres pays qui comptent parmi ceux dont la croissance est la plus rapide et dont les potentialités de développement sont les plus fortes : citons sur la façade occidentale la Chine continentale, la Corée du Sud, Taiwan, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, l'Australie, sans parler des villes-États ou enclaves comme Singapour et Hong Kong, en attendant demain les Philippines et le Vietnam ; n'oublions pas sur la façade orientale du Pacifique le Canada, le Mexique, mais aussi le Chili par exemple. Pour nombre de ces États, les échanges commerciaux, maritimes et aériens constituent une base fondamentale du développement économique.
De ce fait, les petits États insulaires du Pacifique se trouvent toujours, au début du xxie siècle, dans une situation géostratégique de premier plan, sur des axes commerciaux fondamentaux, mais dans un contexte politique qui a réduit sensiblement leur rôle réel. Ils ont perdu, par exemple, leur fonction d'escale aérienne sur les routes transpacifiques du fait de l'allongement de l'autonomie des avions à réaction qui permet les traversées du grand océan sans escale. Ils restent cependant objets d'attention de la part des grandes nations riveraines qui souhaitent affirmer des zones d'influence et désirent parfois éliminer la présence de puissances n'appartenant pas directement au monde pacifique (politique de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande vis-à-vis de la France). C'est aussi pour faire face aux conséquences de l'émiettement politique de ces mondes insulaires que l'on a cherché à développer des « organisations régionales » regroupant les différents pays (Commission du Pacifique Sud devenue Communauté du Pacifique, basée à Nouméa, Forum du Pacifique Sud basé à Suva, etc.). Cette nécessaire coopération est en œuvre également dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles (cyclones, tsunamis).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Christian HUETZ DE LEMPS : professeur, directeur de l'UFR de géographie, université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
AMÉRIQUE (Histoire) - Amérique espagnole
- Écrit par Jean-Pierre BERTHE
- 21 858 mots
- 13 médias
Les trafics duPacifique sont plus ténus, malgré leur grande importance commerciale. En décembre 1591, Philippe II, qui cherche à limiter l'hémorragie de métal blanc vers l'Extrême-Orient, réduit à deux navires par an le commerce entre Acapulco et Manille, réglemente sévèrement – mais en vain – l'exportation... -
ANZUS (Australia, New Zealand and United States)
- Écrit par Jean DELMAS
- 333 mots
Traité tripartite de sécurité conclu par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique, dans le cadre du réseau de pactes d'assistance mutuelle tissé par les États-Unis de 1949 à 1954. Signé le 1er septembre 1951, soit huit jours seulement avant le traité...
-
APIA
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 251 mots
- 1 média
La ville d'Apia, située sur la côte nord de l'île d'Upolu, dans l'océan Pacifique Sud, est la capitale des Samoa depuis 1959. Son observatoire, les bâtiments de l'Assemblée législative et une station de radio se trouvent sur la péninsule de Mulinuu, un promontoire qui sépare...
-
AUSTRONÉSIENS
- Écrit par Jean-Paul LATOUCHE
- 919 mots
Pris dans un sens strict, les Austronésiens forment un groupe ethnolinguistique considérable dispersé de Madagascar aux îlesHawaii et recouvrant la totalité de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines, la quasi-totalité de la Mélanésie et de Formose, et enfin la Micronésie...
- Afficher les 46 références
Voir aussi
- TAHITI
- PEARL HARBOR (7 [8] déc. 1941)
- BÉRING DÉTROIT DE
- SAAVEDRA ALVARO DE (mort en 1529)
- QUEIROS ou QUIRÓS PEDRO FERNANDEZ DE (1565-1615)
- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE
- INDES ORIENTALES COMPAGNIE HOLLANDAISE DES
- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA
- PACIFIQUE GUERRE DU ou GUERRE NIPPO-AMÉRICAINE (1941-1945)
- BATAVIA
- COMMERCE, histoire
- TOUR DU MONDE
- HARRISON JOHN (1693-1776)
- ESPAGNOL EMPIRE COLONIAL
- FOURRURES
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945
- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946
- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830
- BALEINE
- ZEE (zone économique exclusive)
- MAGELLAN DÉTROIT DE
- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES
- BÉRING VITUS JONASSEN (1681-1741)
- ROUTES MARITIMES
- ROGGEVEEN JACOB (1659-1729)
- GUADALCANAL ÎLE DE
- MENDAÑA DE NEIRA ÁLVARO DE (1541 env.-1595)
- SANTAL
- ANSON GEORGE (1697-1762)
- MALACCA DÉTROIT DE