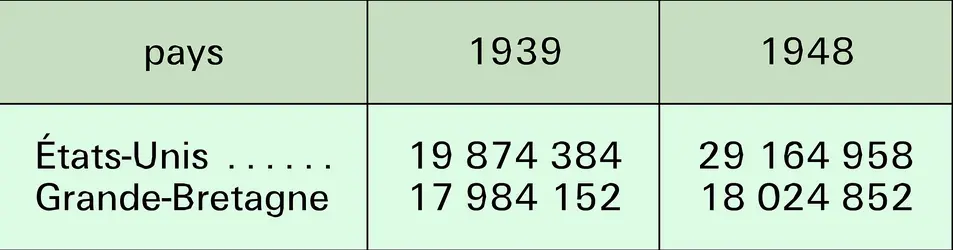MARINE MARCHANDE HISTOIRE DE LA
Article modifié le
La marine marchande après la Seconde Guerre mondiale
Difficultés économiques
Les premières années de l'après-guerre ont été consacrées à la reconstitution des flottes de commerce détruites au cours du conflit. Une fois la reconstruction achevée, de nouvelles difficultés extrêmement sérieuses sont venues assombrir les perspectives économiques de la marine marchande.
Au premier rang, il faut placer la concurrence du transport aérien. Le développement de l'aviation commerciale depuis la guerre est cause, notamment, de la disparition quasi totale du trafic régulier de passagers (en 1957, l'avion avait « rattrapé » le navire sur le trafic transatlantique, chacun des deux ayant transporté un million de passagers) et de l'écrémage de tous les transports de produits légers et luxueux dans le prix desquels le coût du transport n'entre de toute façon que pour une faible part.
La concurrence au sein même de la marine marchande s'est d'autre part fortement avivée, sous l'influence de trois facteurs. Entre 1947 et 1969, quarante-cinq flottes nouvelles se sont créées : de nombreux pays neufs estiment en effet que les difficultés de création d'une flotte de commerce sont largement compensées par l'indépendance économique à laquelle elle permet d'accéder, par l'économie de devises étrangères, par la garantie de ne pas se trouver isolé en cas de conflit et par le prestige qui s'attache à la possession d'un pavillon. Il faut sans doute y voir aussi la réaction de pays qui ont longtemps souffert d'être tributaires de flottes coloniales ou du système d'organisation du transport de lignes régulières.
Plus grave encore est le développement spectaculaire des pavillons de complaisance. Ces pavillons sont ceux que certains États (Panamá, Liberia) accordent de façon extrêmement libérale à des navires qui n'appartiennent en réalité aucunement à leurs ressortissants. L'origine de ces flottes remonte aux années 1920, époque où des navires de croisière des États-Unis passèrent sous pavillon panaméen, afin de se soustraire aux lois sur la prohibition de l'alcool. Mais elles se sont surtout développées après la Seconde Guerre mondiale avec la flotte pétrolière, née de la révolution énergétique. Les États qui accordent des pavillons de complaisance attirent les armateurs en n'assujettissant les navires qu'au minimum d'exigences fiscales, de standards sociaux et de sécurité. Des flottes organisées suivant de tels principes sont naturellement très compétitives et représentent une concurrence sérieuse pour les pavillons traditionnels, contraints de « jouer le jeu ».
Signalons enfin que les conférences maritimes (ententes internationales entre armements qui desservent le même secteur géographique et qui appliquent des tarifs de fret identiques), attaquées violemment de tout temps par les États en voie de développement (pays chargeurs de matières premières à bas prix) qui en restent tributaires, ont subi, à partir de 1960, une concurrence sévère de la part d'« outsiders » puissants, comme certaines flottes d'Europe orientale.
À ces difficultés déjà sérieuses, il faut ajouter l'accroissement constant des coûts d'exploitation, tenant à la technicité toujours plus grande des bâtiments modernes, à l'apparition de charges nouvelles (obligation de réparer les dommages de pollution causés par les hydrocarbures) et, surtout, aux revendications sociales du personnel maritime.
Les transformations
Pour sortir de leur mauvaise passe, les marines marchandes modernes se sont engagées au tournant des années 1960 dans une double voie : abaissement des coûts et spécialisation. Les politiques et les structures de la marine marchande ont, elles aussi, été influencées par les données nouvelles.
La recherche de l'abaissement des coûts a poussé, jusqu'en 1973, les compagnies de navigation à accroître de façon spectaculaire le tonnage des navires et particulièrement des pétroliers. Dans la course au gigantisme, les chiffres sont éloquents : l'Atlantic Seaman, lancé en 1950, avait un tonnage de 30 115 tonnes de port en lourd (t.p.l. : unité de poids correspondant sensiblement au poids des marchandises susceptibles d'être transportées) ; l'Universe Ireland et le Pierre Guillaumat lancés respectivement en 1969 et 1977 avaient un port en lourd de 327 000 et 550 000 tonnes. La tendance au gigantisme allant de pair avec l'intensification des besoins mondiaux en pétrole, la part des pétroliers dans la flotte mondiale s'est accrue constamment jusqu'en 1980.
Depuis cette date, les pays européens ont de plus en plus cherché à freiner leurs importations de pétrole et le nombre de navires pétroliers désarmés n'a cessé de croître.
La recherche d'une plus grande efficacité économique dans le domaine de la navigation de lignes régulières a entraîné la mise en exploitation, dès le milieu des années 1960, de navires porte-conteneurs, chacun constituant une unité d'emballage aux dimensions standardisées. Ces navires dont la taille s'accroît sans cesse – certains d'entre eux peuvent transporter plus de 4 000 conteneurs – évincent peu à peu les navires conventionnels sur la plupart des secteurs géographiques. Malgré le coût élevé de tels navires, des installations terrestres requises, des parcs de conteneurs à acquérir et à gérer, l'économie est certaine, car l'accélération des opérations de manutention se traduit par un gain de temps de relâche dans les ports et, par conséquent, une rotation plus rapide des navires et donc une rentabilité accrue.
Les progrès de la manutention classique ont eux-mêmes été remarquables (ouverture automatique des cales, pompage des liquides et céréales, système du roulage). Enfin, l'automatisation appliquée aux navires a permis de réduire considérablement les équipages : la trirème athénienne classique de 100 tonneaux avait un équipage de deux cents hommes ; celui des navires les plus modernes n'excède pas dix-huit hommes.
Quant à la spécialisation poussée des flottes de commerce, elle permet aux navires modernes d'assurer le transport et la manutention de chaque marchandise dans les meilleures conditions de conservation et de rapidité. Citons, parmi les navires spécialisés, les méthaniers aptes au transport des gaz liquéfiés à très basse température, les transporteurs de voitures neuves, les transporteurs de colis lourds, les transporteurs de produits chimiques... Parallèlement, des flottes de navires à double ou triple spécialisation se sont développées. Ces navires bivalents ou polyvalents sont moins vulnérables d'un point de vue économique que les unités à vocation unique. Parmi ces navires, on mentionnera : les pétrovraquiers, les pétrominéraliers, les porte-conteneurs rouliers, les porte-conteneurs vraquiers...
La flotte de navires à passagers s'est, de son côté, beaucoup transformée. Les navires de ligne tendent à disparaître presque complètement, à l'exception de quelques grands paquebots, ambassadeurs de prestige, au profit des transbordeurs qui assurent le plus souvent des liaisons courtes (trans-Manche, relations entre la France et le Maghreb). Par ailleurs, les flottes des croisières n'ont cessé de perfectionner leurs unités pour tenter de maintenir leur place ou même de l'améliorer sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Le cadre institutionnel mondial dans lequel la marine marchande exerce son activité a également profondément évolué. À partir des années 1970, les pays en développement ont trouvé dans la C.N.U.C.E.D. (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement : organisme spécialisé de l'O.N.U.) une tribune pour exprimer leurs doléances contre une organisation du transport maritime mondial qu'ils estiment trop imprégnée par les rapports de domination économiques qui prévalaient avant leur accession à l'indépendance. Ils s'efforcent, non sans succès, d'obtenir, par voie de conventions internationales, une réforme des règles de droit et des principes de fonctionnement du transport maritime. C'est au sein de la C.N.U.C.E.D. en particulier que voit le jour, en 1974, un code de conduite des conférences maritimes, qui prévoit notamment le partage de certains trafics selon la règle dite du 40/40/20 (40 p. 100 étant réservés aux compagnies de transport maritime de chacun des pays co-échangistes, les 20 p. 100 restant étant accessibles à des armateurs battant un pavillon tiers). Après avoir fait reconnaître ce principe de répartition des cargaisons dans le domaine des lignes régulières, les pays en développement cherchent à l'étendre au domaine des transports de vrac : pétrole, minerais, matières premières. Ils visent aussi à éliminer les pavillons de complaisance.
Le ralentissement économique mondial consécutif aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 va cependant couper court à cette aspiration à un nouvel ordre maritime mondial. La domination des flottes de pavillon national se délite, notamment dans le secteur du transport de pétrole puis progressivement dans les autres secteurs du transport en vrac. Les difficultés de l'activité de transport maritime – baisse des prix et de la rentabilité – favorisent les demandes d'immatriculation auprès des registres ouverts (pavillons de complaisance). Une nouvelle ère a débuté, celle de la globalisation du transport maritime. Elle est marquée par une concurrence exacerbée entre les pays du Nord et ceux du Sud, que les premiers peinent à soutenir. En l'absence de normes suffisantes étendues à l'échelle mondiale, les différences de coût du travail rendent la compétition quasi impossible entre les équipages du Sud et ceux du Nord, condamnant ces derniers à s'abandonner davantage encore aux pavillons de complaisance. L'insécurité économique, sociale et écologique (naufrages, marées noires...) résultant de ces évolutions a considérablement renforcé le besoin de régulation de l'activité maritime mondiale.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Françoise ODIER : conseiller juridique du Comité central des armateurs de France, Paris
- Yves POULIZAC : directeur de l'Institut d'économie des transports maritimes, Arcueil
- Martine RÉMOND-GOUILLOUD : professeur de droit
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
AMALFI
- Écrit par Jean-Marie MARTIN
- 383 mots
Ville de la province de Salerne, située sur la côte sud de la péninsule de Sorrente, au débouché de la minuscule vallée des Moulins entourée de falaises verticales qui l'isolent de l'arrière-pays. Le lieu semble avoir servi de refuge à des Campaniens fuyant les Lombards à la fin du ...
-
ANGO JEAN (1480-1551)
- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION
- 392 mots
Armateur dieppois. Issu d'une famille d'origine rouennaise, fils d'armateur — son père arme le premier navire français connu qui ait atteint Terre-Neuve (voyage de La Pensée, 1508) —, Jean Ango transforme l'entreprise paternelle, déjà importante, en une grande affaire capitaliste...
-
ASSURANCE - Histoire et droit de l'assurance
- Écrit par Jean-Pierre AUDINOT , Encyclopædia Universalis et Jacques GARNIER
- 7 497 mots
- 1 média
Ce contrat, qui répondait aux besoins de la navigation à une époque où tout voyage en mer s'apparentait à une aventure, est probablement né sur les bords de la Méditerranée. Il fut perfectionné par les juristes romains et rendit d'immenses services au commerce maritime pendant toute l'Antiquité et... -
ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN
- Écrit par Jacques GODECHOT et Clément THIBAUD
- 13 673 mots
- 12 médias
Le développement de la sidérurgie est également la cause du déclin maritime de la Grande-Bretagne. Ce sont les États-Unis qui réalisèrent le premier bateau à vapeur ; le Clermont, construit par Fulton, navigua sur l'Hudson dès 1807, et c'est un bateau à vapeur américain, le Savannah... - Afficher les 49 références
Voir aussi
- TRANSPORTS ÉCONOMIE DES
- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME
- LIBRE-ÉCHANGE
- TONNAGE
- FLOTTE DE COMMERCE
- CONFÉRENCE, droit maritime
- ARMATEURS ou ARMEMENT NAVAL
- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA
- CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement)
- MARINS
- COMMERCE, histoire
- ÉCONOMIE MÉDIÉVALE
- NAVALE CONSTRUCTION
- GALÈRE
- TRANSPORT DE MARCHANDISES ou FRET
- TRANSPORT DE VOYAGEURS
- MARINE HISTOIRE DE LA
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914
- FOIRES MÉDIÉVALES
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945
- NAVIRE STATUT DU
- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES
- PÉTROLIER
- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS
- NAVIRES DE COMMERCE
- PAQUEBOT
- BATEAU À VAPEUR