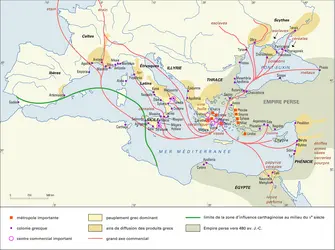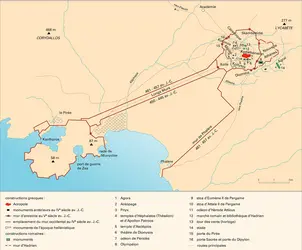MÉDITERRANÉE HISTOIRE DE LA
Article modifié le
Temps modernes
De la prise de Constantinople à la mort de Philippe II
Soliman le Magnifique
Après la prise de Constantinople, la conquête ottomane s'étendit rapidement aux pays de la Méditerranée orientale. Maîtres des détroits, les Turcs chassent les Génois de la mer Noire et de la mer Égée. Venise perd ses positions en Grèce et dans l'Archipel, se replie sur Chypre qu'elle enlève aux Lusignan. Elle conclut avec le sultan une alliance qui lui permet, malgré tout, de continuer son commerce avec le Levant. Puis les Ottomans conquièrent l'Égypte sur les Mamelouks, prennent Le Caire (1517), établissent leur suzeraineté sur La Mecque et l'Arabie. Soliman le Magnifique s'empare de Bagdad et de la Mésopotamie, mais il est arrêté dans sa marche vers l'Inde. En même temps, il prend Rhodes (1522), pénètre dans les Balkans et l'Europe danubienne où tombent successivement Belgrade (1521) et Bude (1526) ; Vienne est assiégée (1529). La navigation chrétienne, refoulée vers l'ouest, est désormais harcelée par la marine turque et les corsaires maghrébins, comme Khayr al-Din, dit Barberousse, que le sultan s'adjoint comme auxiliaires et qui lui permettent, malgré les opiniâtres tentatives de Charles Quint pour se maintenir à La Goulette de Tunis ou pour prendre Alger, d'étendre le protectorat ottoman sur le Maghreb littoral (le Maroc excepté). Par l'intermédiaire des pachas et de leurs gardes turques qu'ils installent dans les pays, les Ottomans organisent un vaste empire militaire. Des architectes et des artistes, héritiers des traditions byzantines, persanes ou syriennes, embellissent Constantinople qui regagne bientôt son rôle d'emporium majeur de la zone méditerranéenne.
En même temps que se développent les conquêtes turques, l'expansion portugaise dans l'océan Indien détourne, au profit de Lisbonne, le trafic commercial des épices, détenu jusque-là par les Arabes, et qui aboutissait à Alexandrie ; la rapide décadence de celle-ci retentit sur Venise, son principal client. Confisqué dans l'Océan par les Portugais et leurs successeurs hollandais et anglais, le commerce asiatique retrouve, pour une part, la voie continentale des caravanes par la Mésopotamie et l'Asie antérieure. Constantinople reprend sa position de grande ville d'affaires entre l'Asie et l'Europe, animée par des négociants syriens, persans, juifs, grecs. Les riches marchés de Constantinople et des villes des Échelles (Smyrne, Alep, Tripoli) sont exploités par les Vénitiens, puis – à la faveur des Capitulations – par les Marseillais que suivront plus tard les Compagnies du Levant hollandaise et anglaise.
Les guerres d'Italie
Une telle évolution était impossible à prévoir, même à l'heure où le Génois Christophe Colomb, agissant pour le compte de l'Espagne, découvre l'Amérique et au moment où les Portugais atteignent l'Inde. La Méditerranée était alors le centre du trafic avec l'Orient, et l'Italie en restait l'étape essentielle, inégalée par l'éclat et l'opulence de ses riches cités banquières et commerçantes qu'illustrent tous les prestiges de l'humanisme et de la Renaissance. En 1480, la France acquiert, avec la Provence, les droits du roi René héritier des Anjou sur Naples, Chypre et le royaume de Jérusalem. Pour faire valoir ces droits, établir son hégémonie sur l'Italie et sur la mer, Charles VIII, renversant la politique réaliste de ses prédécesseurs – rassembleurs des terres « françaises » – entreprend les guerres d'Italie. Le grand mirage impérial et archaïque des rois français a été soutenu pourtant par les intérêts capitalistes, par les gens d'affaires modernes ambitionnant de reconquérir les marchés du Levant, de ravir à Venise sa primauté économique. Mais l'aventure des guerres d'Italie n'est que le premier acte du drame qui, tout au long du xvie siècle, bouleverse inexorablement les structures de la Méditerranée occidentale. La dynastie d'Aragon s'est définitivement réinstallée à Naples, abandonnée par Charles VIII. Plus tard, dans le Milanais perdu par François Ier, s'établissent les Espagnols (Charles Quint, puis Philippe II). Le pape maté, Venise contenue et isolée, l'Italie, morcelée en de multiples et stériles despotismes, tombe sous l'influence espagnole.
L'apogée de Venise
La péninsule fournit à l'Espagne des subsides et des troupes (Milanais, Naples), des blés (Sicile) ; ses abords sont solidement gardés contre les Turcs (installation des chevaliers de Rhodes à Malte par Charles Quint en 1530) ou délivrés des Français (restitution à Gênes de l'île de Corse un moment occupée par Henri II, 1554-1558). Seule Venise (et le Piémont) échappe à l'emprise espagnole. La Sérénissime – diminuée relativement à ses rivales septentrionales, Londres, Anvers, Amsterdam – conserve ses traditions industrielles, ses célèbres réseaux diplomatiques et commerciaux, une belle flotte. Et alors que le grand art florentin s'étiole c'est, au contraire, au bord de la lagune l'éblouissement de la peinture de Titien, de Véronèse et de Tintoret.
Dès lors, la Méditerranée devient le théâtre méridional de la politique de prestige des Habsbourg, mais aussi et surtout un glacis, capital pour le protectorat de la chrétienté romaine par l'Espagne et la sécurité de l'Europe centrale. Ainsi s'explique l'alliance paradoxale du Roi Très Chrétien de France avec la Porte musulmane (1536). La flotte turque qui relâche à Toulon permet de contenir la tentative hégémonique espagnole dans le golfe du Lion et de préserver la vocation méditerranéenne de la France. Les Capitulations obtenues par François Ier inaugurent l'entente franco-turque.
La poussée turque dans les Balkans (aux portes d'une Allemagne déchirée par la Réforme) oblige les Habsbourg à disperser leurs efforts. L' Espagne, au reste, donne le meilleur de ses soins aux Indes américaines : Cadix, sur l'Atlantique, croît et s'enrichit cependant que Barcelone décline. Laissant à ses cousins de Vienne le soin de défendre l'Europe continentale, Philippe II, qui, par Milan et Naples, contrôle l'Italie, y encourage l'exaltation des valeurs de la Contre-Réforme espagnole, et en particulier la résistance aux Turcs, qui (malgré le soutien chancelant de la France engagée dans ses guerres de Religion) ne cessent de progresser (prise de Chio sur les Génois ; de Chypre sur les Vénitiens). Pie V bénit la nouvelle croisade qui associe Espagnols et Vénitiens. La victoire de don Juan d'Autriche à Lépante (1571) rejette les Turcs vers la Méditerranée orientale. Dans la partie ouest de la mer, la prééminence espagnole s'affirme avec éclat mais ne peut empêcher la persistance des entreprises commerciales françaises avec le Levant et le Maghreb, ni l'activité des corsaires barbaresques d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Au reste, la destruction de l'invincible Armada sur les côtes de l'Angleterre élisabéthaine (1588) sonne le glas de l'hégémonie navale de l'Espagne. Quand disparaît Philippe II (1598), les Anglais et les Hollandais pénètrent en Méditerranée où, concurremment avec les Français et les Vénitiens, ils entendent participer au commerce du Levant.
Le déclin espagnol
La décadence économique des vieux royaumes
L'Espagne, cependant, se ruine sous l'effet de son désastreux système colonial et de ses engagements politiques. Derrière la façade de sa puissance, de l'éblouissante production artistique du « siècle d'or », des lézardes apparaissent, que Rocroi (1643) mettra en lumière. Gênes, devenue puissance financière de premier ordre, prête d'immenses sommes à l'Espagne banqueroutière ; elle se rembourse grâce aux « retours » des colonies qui font prospérer et sa banque et sa marine. Les Rois Catholiques livrent la Sardaigne à de grands propriétaires espagnols et génois dont l'avidité achève d'appauvrir l'île. La Corse, tenue par les forteresses génoises, doit fournir à la république argent et soldats. Les royaumes de Naples et de Sicile, malgré le rôle de grenier à blé de cette dernière, déclinent irrémédiablement sous la lourde domination des vice-rois espagnols.
Même atmosphère dans la Florence des grands-ducs de Toscane ou dans la Rome pontificale. L'ostentation baroque des palais, églises et cérémonies, de l'opéra naissant ne peuvent faire oublier la décadence économique, les ports ensablés, les maigres flottes de galères incapables d'assurer la sécurité de leurs côtes.
Venise, du moins, a conservé son indépendance. Malgré ses revers maritimes et la concurrence que lui font les Ragusains, les Français et les Anglais, elle continue à faire belle figure. Et sans doute son déclin, que signale l'intérêt croissant qu'elle porte à sa terre ferme, se dissimule-t-il longtemps derrière la persistance de son commerce oriental et ses sursauts d'énergie militaire et navale.
La politique française : de Sully à Colbert
Dans cette Méditerranée espagnole, la puissance navale turque reste cependant redoutable. Contre ses ennemis et leurs vassaux, la Porte organise la piraterie comme un commerce fructueux. À Alger, à Tripoli, à Constantinople s'entassent les prisonniers chrétiens. Razzias identiques de la part des Européens et de l'ordre de Malte qui alimentent leurs chiourmes de galériens turcs ou maghrébins. Dans cette conjoncture toujours précaire, Marseille et sa chambre de commerce conservent dans les pays de l'empire ottoman d'importants intérêts. Henri IV et Sully ont renoué avec la Porte. Richelieu, qui crée la flotte du Levant, donne une grande attention à l'équipement naval de la Provence et au commerce du Levant. Bientôt Colbert favorise l'éclosion – d'ailleurs éphémère – de compagnies marseillaises pour le commerce méditerranéen. Louis XIV entend doubler les opérations commerciales d'une politique de prestige soutenant – vainement, d'ailleurs – les Vénitiens en Crète (1671), intervenant en souverain protecteur dans les querelles entre chrétiens orientaux (mais favorisant les Latins). C'est la fin, semble-t-il, de l'hégémonie turque.
L'écroulement de la puissance ottomane
De fait, le dynamisme de la puissance ottomane s'est émoussé au cours du siècle. Malgré la prospérité de certains emporiums orientaux comme Bagdad ou Alep, malgré l'opulence démesurée des sultans de Constantinople, la léthargie économique gagne les régions continentales de l'Empire, soumises à une administration corrompue et incapable, dominées par les oligarchies militaires graduellement devenues héréditaires et par là moins combatives. La religion, formaliste à l'excès, se révèle comme un obstacle puissant à l'évolution, à la modernisation. Les intrigues du sérail et l'arbitraire sanglant des sultans empêchent toute politique suivie, même si le prestige diplomatique de la Porte et sa puissance militaire restent considérables. Coupée du commerce de l'océan Indien, l'Égypte s'endort. Le Maghreb, qui n'attire plus les richesses de l'Afrique noire détournées vers l'Atlantique, périclite. Profitent de cette situation les princes chrétiens balkaniques vassaux de la Porte, mais de plus en plus attirés par la Russie orthodoxe qui se rapproche de la mer Noire. Les Grecs, surtout, s'insinuent dans la haute administration impériale et se posent désormais en intermédiaires privilégiés entre le Divan et les Occidentaux.
Sporadiquement, la guerre éclate en Méditerranée. En guerre avec l'Espagne, la France expédie Abraham Duquesne aider la Sicile révoltée (1674-1678). Blake promène ses escadres dans la mer espagnole, bombarde Alger, démantèle Tunis, libère les esclaves chrétiens (1655). Louis XIV punit de même les Barbaresques. Enfin, l'Angleterre acquiert Tanger. Elle occupera vingt ans (1660-1680) ce point d'appui – analogue aux présides espagnoles de Melilla et d'Oran – qui préfigure l'installation à Gibraltar en 1704. La Turquie cependant sait profiter des occasions offertes par la conjoncture européenne. Contre l'Autriche, affaiblie par la guerre de Trente Ans, le vizir Kupruli lance ses troupes, conquiert la Hongrie (1662), et n'est arrêté qu'à Saint-Gothard par les armées françaises (1664). La rupture franco-turque permet aux puissances maritimes et mercantiles, à la Hollande et à l'Angleterre surtout, de s'immiscer dans le commerce de Constantinople. Deux nouvelles et terribles offensives turques seront réprimées (1673, 1687), et le roi de Pologne Jean Sobieski sauve Vienne. Dès lors, c'est comme une nouvelle croisade que mènent les Autrichiens, auxquels se joignent Russes et Polonais. Le traité de Karlowitz (1699) inaugure le reflux turc. La Turquie démembrée est rejetée sur les Balkans ; la Russie atteint la mer Noire, Venise se réinstalle en Morée sur la côte maghrébine, la France occupe un moment Tétouan. Malgré les revers passagers de Pierre le Grand en lutte contre le roi de Suède, Charles XII, allié de la Porte, revers qui forcent le tsar à abandonner Azov, la Russie poursuit sans relâche son expansion vers le sud, aux dépens de l'Empire ottoman, vers la mer Noire, et – grâce à la complicité des sujets orthodoxes de la Porte – étend son influence sur les Balkans et, au-delà, vers la Méditerranée.
Renaissance de la Méditerranée occidentale
L'introduction, sur le théâtre méditerranéen, de nouveaux et ambitieux acteurs complique encore la situation. Au cours de la seconde moitié du xviiie siècle, la conjoncture économique et le despotisme éclairé raniment la Méditerranée occidentale, la décadence de l'Empire ottoman s'accentue et le problème de son destin face aux ambitions occidentales est posé. Méditerranée et pays méditerranéens font bien figure, à cette époque, de régions subordonnées du point de vue politique et économique. Il ne faut pas en exagérer pourtant la décadence : pour la Provence maritime, c'est une belle époque ; l'Espagne se ranime ; un prérisorgimento se fait sentir en Italie ; la Grèce se réveille.
Nouvelles forces politiques, spirituelles et économiques
Dans la Méditerranée occidentale, la France recueille de la succession d'Espagne et de ses séquelles d'importants avantages. Louis XIV a installé à Madrid son petit-fils Philippe V, dont les fils iront régner à Naples et à Parme. En achetant la Corse à la république de Gênes (1768) et grâce à son protectorat de fait sur l'ordre de Malte, la France installe un réseau d'intérêts stratégiques, économiques et culturels fort important. Le libéralisme peu à peu introduit dans l'économie espagnole redonne sa chance à Barcelone, qui ranime son port et ses industries. L'Espagne revigorée récupère en 1783, sur l'Angleterre, Minorque perdue en 1708. Le royaume de Naples, partiellement réorganisé pendant la période autrichienne (1709-1739), fait de nouveau figure de puissance sous les Bourbons, restés populaires même au début de l'ère révolutionnaire. Son commerce, sa marine s'accroissent ; quelques industries se créent ; la vie culturelle reste vigoureuse avec Vico, Filangieri, Pergolese, les Scarlatti. L'influence du jansénisme, qui dans les États bourboniens dirige le combat contre la toute-puissance de l'Église, provoque aussi l'expulsion des Jésuites d'Espagne, de Parme, de Naples ; ils se réfugient auprès du pape en attendant la « destruction » de la Compagnie, dont l'activité s'était étendue jusqu'à l'Arménie chrétienne, vassale des Ottomans. En même temps que déclinent les aspects principaux de la civilisation politico-religieuse du baroque méditerranéen, les États ecclésiastiques – et, en particulier, les États pontificaux – révèlent leurs maux incurables. Malte devient mondaine, laïque et commerçante ; sa vocation militaire disparaît comme ses galères. Les républiques ne valent guère mieux. Les fêtes continuelles à Venise (qui jette les derniers feux d'un art éblouissant avec Vivaldi, Canaletto, Guardi, Tiepolo) dissimulent mal la sclérose commerciale et politique de la république de saint Marc. Raguse, république de saint Blaise, maintient un trafic oriental sans envergure. Gênes est trop faible, bloquée entre la France et le Piémont qui la convoite. C'est à ce dernier État (devenu royaume de Sardaigne quand l'île lui fut attribuée en 1719) que pourrait appartenir l'avenir, n'était sa rivalité latente avec l'Autriche.
La puissance autrichienne
Le meneur de jeu, tout compte fait, est l'Autriche. L'empereur qui a, lui aussi, convoité la succession d'Espagne, a dû renoncer au trône de Madrid. Mais les traités d'Utrecht et de Rastatt (1713-1714) lui ont donné le Milanais, Naples et la Sardaigne. Si Parme et les Deux-Siciles passent finalement à des infants, la Toscane par contre est attribuée à François de Lorraine, époux de la future impératrice Marie-Thérèse. Plus encore que les Bourbons, les Autrichiens en Milanais et leurs archiducs en Toscane introduisent dans la péninsule italienne les réalisations d'une administration rigoureuse, anticléricale, appuyée sur la bourgeoisie éclairée qui développe les industries du Milanais et fait de Livourne un port franc, vite rival de Marseille et de Naples. Dans l'Adriatique, l'Autriche, maîtresse de la Croatie et de la Serbie, développe Trieste et sa Compagnie d'Orient.
En outre, l'empereur, conseillé par le prince Eugène de Savoie, a repris l'offensive contre les Turcs. À cette croisade moderne se sont joints Venise, le pape et même le Portugal de Jean V. Le traité de Passarowitz (1718) consacre et étend les avantages acquis à Karlowitz. L'Autriche organise dans les Balkans ses confins militaires. Mais Venise a perdu la Morée.
Une puissance extra-méditerranéenne, l'Angleterre, inexpugnable à Gibraltar et installée à Minorque (qu'elle rend à l'Espagne en 1783), développe son commerce au Levant. Pour elle, les pays méditerranéens sont les pions qu'elle manœuvre sur le flanc sud de la France, son principal concurrent industriel et colonial. Mais elle n'oublie pas pour autant de surveiller les expansionnismes parallèles et rivaux de l'Autriche et de la Russie aux dépens de l'Empire ottoman en voie de dislocation.
Dislocation de l'Empire ottoman
Sur les régences barbaresques, sur l'Égypte même, la suzeraineté turque n'est plus que nominale. L'Espagne s'enhardit jusqu'à reconquérir Oran, qu'elle finira par abandonner après d'incessants conflits où se révèle l'opiniâtre résistance des Algérois. À Constantinople, des sultans incapables abandonnent le pouvoir effectif à des Grecs qui servent surtout les intérêts de leurs compatriotes. Dans les Balkans, les peuples soumis, travaillés par des agents autrichiens et russes, se réveillent. En Grèce, dans l'Archipel, une semi-autonomie s'installe. En Valachie, des hospodars grecs sont prêts à trahir. Les prélats orthodoxes se tournent vers le patriarcat de Moscou.
Rien d'étonnant, dès lors, que, parallèlement aux grands conflits qui embrasent l'Europe occidentale, l'avance de l'Autriche et de la Russie se poursuive contre les Ottomans. Longtemps ennemie de l'Autriche, la France s'emploie avec succès à sauver l'empire du sultan (et y gagne en 1740 le renouvellement des Capitulations, si utiles à son commerce). Son alliance avec l'Autriche (1755) affecte en conséquence ses relations avec la Porte, dont l'Angleterre alors se fait la protectrice. Mais la Grande-Bretagne ne peut contrecarrer les desseins orientaux de Catherine II de Russie, qui achève la conquête de la Crimée, s'insinue en Bessarabie et convoite ouvertement Constantinople. Au cours du conflit de 1770, la tsarine expédie une armada russe qui détruit la flotte turque à Tschesmé (Asie Mineure), événement d'immense portée puisqu'il force le sultan à ouvrir les détroits aux bateaux de commerce russes. Dès lors, les Russes, comme les Anglais, croisent en Méditerranée, agitent les peuples balkaniques au nom de la religion orthodoxe, décrètent leur suzeraineté sur Raguse, favorisent les orthodoxes des Lieux saints et, pendant la crise ouverte par la Révolution française, tentent de confisquer l'ordre de Malte et ses îles.
Révolution française et Empire napoléonien
La Révolution française en Méditerranée aura d'immenses conséquences. L'Italie est profondément secouée. À Gênes, à Florence, à Naples, à Rome, les anciens régimes sont remplacés par des républiques sœurs. La deuxième campagne d'Italie (1801) raffermit le joug français sur la péninsule. Napoléon se fait roi d'Italie mais, au lieu de l'unifier, il installe ses parents dans des « royaumes » sur mesure.
La conquête napoléonienne s'est étendue – aux dépens de l'Autriche – dans le golfe Adriatique, en Dalmatie, sur les îles Ioniennes. Dans la course à l'Orient et au dépeçage de l'Empire ottoman, Napoléon assume les ambitions autrichiennes de naguère et se heurte dès lors à la Russie, qui n'a cessé d'étendre ses conquêtes vers le sud (guerre austro-russo-turque, 1788-1792). Le mirage oriental qui donne naissance à l'expédition d'Égypte – et qu'engloutira la campagne de Russie – a inquiété l'Angleterre qui, inlassablement, cantonne le conquérant dépourvu de marine après Trafalgar : Malte, la Sicile, les îles Ioniennes, Corfou sont autant d'étapes antinapoléoniennes qui, éclairant l'Angleterre sur ses intérêts, remettent finalement en ses seules mains l'équilibre du pouvoir en Méditerranée. Pourtant, la propagation des thèmes révolutionnaires et l'aventure napoléonienne y ont introduit, à côté des ambitions matérielles et stratégiques, les idées (si fécondes pour l'Italie, les Balkans, la Grèce) de renaissance nationale et de liberté.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André BOURDE : professeur à l'université de Provence, directeur de l'Institut d'art
- Georges DUBY : de l'Académie française
- Claude LEPELLEY : chargé d'enseignement à l'université de Lille
- Jean-Louis MIÈGE : professeur émérite d'histoire à l'université de Provence
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
ABOUKIR BATAILLE D' (1er août 1798)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 504 mots
- 1 média
Appelée bataille du Nil par les Anglais, cette bataille est l'une des grandes victoires de l'amiral Nelson. Elle oppose le 1er août 1798 les flottes française et britannique dans la rade d'Aboukir, à proximité d'Alexandrie, en Égypte.
En février 1798, le général Bonaparte,...
-
AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations
- Écrit par Marc MICHEL
- 12 429 mots
- 24 médias
Au moment où la Libye accédait à l'indépendance et allait grossir les rangs du groupe afro-asiatique à l'O.N.U., les questions marocaine et tunisienne faisaient irruption sur cette même scène dans des conditions infiniment plus dramatiques. Les positions de départ avaient été clairement affirmées à... -
AFRIQUE ROMAINE
- Écrit par Noureddine HARRAZI et Claude NICOLET
- 9 566 mots
- 10 médias
La domination administrative et politique de Rome sur les diverses régions de l'Afrique du Nord (mis à part la Cyrénaïque et l'Égypte) s'étend sur près de six siècles : depuis la prise et la destruction de Carthage par Scipion Émilien (146 av. J.-C.) jusqu'au siège et à la...
-
AJACCIO
- Écrit par Bernard RAFFALLI
- 895 mots
- 2 médias
Chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse et du département de la Corse-du-Sud, « cité impériale » ainsi que la nomment ses habitants, Ajaccio (67 007 hab. en 2012) occupe dans la partie sud-ouest de l'île les bords d'un des plus beaux golfes de la Méditerranée. La légende prétendait...
- Afficher les 121 références
Voir aussi
- ISLAM, histoire
- PISE
- MINORITÉS
- VENISE RÉPUBLIQUE DE
- TONNAGE
- ITALIE GUERRES D' (1494-1559)
- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME
- COLONISATION ANTIQUE
- PIRATES
- BYBLOS (auj. DJEBAIL), Liban
- GRECQUE COLONISATION
- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA
- MANDAT COLONIAL
- VOYAGEURS AU MOYEN ÂGE
- COMPTOIRS
- COMMERCE, histoire
- ÉCONOMIE MÉDIÉVALE
- SARRASINS
- FONDOUK
- RÉFORMISME MUSULMAN
- SICILE, histoire
- NORMANDS
- MARCHANDS AU MOYEN ÂGE
- MARINE HISTOIRE DE LA
- EUROPE, politique et économie
- PAIX ROMAINE
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945
- ROMAINE EXPANSION
- AUTRICHE, histoire jusqu'en 1945
- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- COOPÉRATION INTERNATIONALE
- ITALIE, histoire, de 476 à 1494
- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789
- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945
- URBANISATION
- CONSTANTINOPLE
- GRANDE-BRETAGNE, histoire : XVIIIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945
- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient
- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1440 à 1880
- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945
- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1945 à nos jours
- NORD-SUD RELATIONS
- ROME, des origines à la République
- ROME, l'Empire romain
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939
- RUSSIE, histoire, des origines à 1801
- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917
- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
- ROUTES MARITIMES
- ALEXANDRIE, histoire
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- ITALIEN EMPIRE COLONIAL