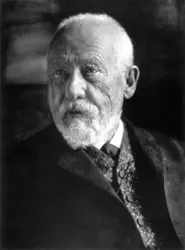HISTORICITÉ
Article modifié le
La compréhension du mode d'être de l'historicité
Dilthey et le comte Yorck
Dilthey, en tant qu'héritier de l'école historique, fut le premier à prendre conscience des conséquences philosophiques que contient cet héritage, et qui, avec l'idée du « droit naturel », mettaient aussi en question l'idée de la vérité intemporelle. Avec son ami le comte Ludwig Yorck von Wartenburg, esprit très remarquable, il était tout entier occupé à penser l'historicité. Dans cet effort, le comte Yorck était le véritable guide. C'est déjà lui l'auteur de la formule : « Notre intérêt commun, c'est de comprendre l'historicité . » En un certain sens, le terme d'historicité procède de son sens personnel du langage, comme le prouvent une série de créations conceptuelles analogues qu'il affectionnait, mais avant tout l'emploi emphatique du concept de vitalité (cf. Gerhard Bauer, Geschichtlichkeit).
Du comte Yorck provient aussi la formule : « La différence générique de l'ontique et de l'historique », que reprendra notamment Heidegger. En soi, c'est évidemment une formulation inspirée de Hegel. Car, dans sa célèbre introduction à l'histoire du monde (Die Vernunft in der Geschichte), celui-ci avait brillamment développé la différence catégoriale entre nature et esprit, en distinguant, par manière d'exemple, le sens historique d'un concept comme celui d'évolution et son sens naturel. Par opposition au cours périodique du devenir dans la nature, c'est la caractéristique de l'être historique « de croître sans cesse dans la répétition en s'élevant et en intégrant » (ἐπίδοσις εἰς αὑτό : Aristote, De anima, II, 5, 7).
Telle est la conception du grand historien J. G. Droysen, dont le précis de science historique (Grundriss der Historik) doit être considéré comme le chef-d'œuvre de la réflexion sur soi de l'école historique. On trouve constamment dans son œuvre des formules qui sont tout à fait inspirées par l'esprit de Hegel, par exemple : « Le savoir de l'histoire est l'histoire elle-même. » Mais c'est seulement dans l'échange entre le comte Yorck et Dilthey et dans leur effort commun de pensée que se révéla clairement toute la difficulté de penser le mode d'être de l'historicité en recourant à l'ontologie grecque, même si l'on tient compte des transformations que celle-ci a connues à l'époque moderne. La correspondance des deux hommes est un document unique pour saisir la tension problématique qui se déploie dans leur vivante amitié spirituelle. Le grand savant Dilthey, plus tard mondialement célèbre, y apparaît presque comme dominé par son ami le comte Yorck von Wartenburg. Car ce luthérien du terroir, propriétaire d'un grand domaine silésien, qui vivait l'existence quotidienne d'un agriculteur et qui représentait sa profession et son milieu social au Sénat prussien, était moins tenté de dissoudre l'histoire dans la pensée que Dilthey, héritier du romantisme allemand et disciple de F. Schleiermacher. C'est un vieux thème du luthéranisme que la vérité de la prédication chrétienne ne peut pas être saisie d'une manière adéquate par la clarté de la conceptualisation philosophique des Grecs. La redécouverte par Luther de l'Ancien Testament, qu'il traduisit, a rendu à l'écoute de la Parole de Dieu sa position religieuse privilégiée, et la question torturante que pose au Faust de Goethe la traduction du prologue johannique, c'est-à-dire du concept grec de logos, est une expression de la même tension problématique. La solution de Faust : « Au commencement était l'action », si paradoxale et si éloignée du texte qu'elle paraisse, pose en tout cas le problème de l'aversion à l'égard de l'« intellectualisme » grec, problème dont Dilthey a déjà reconnu, dans le « fait-action » (Tathandlung) de Fichte, la solution spéculative contemporaine. L'idée hégélienne de la phénoménologie, ainsi que l'objectif qu'il assigne de manifester la substance comme sujet, va dans le même sens.
Le problème des sciences humaines
L'ontologie grecque de la substance dominait encore très fortement la dialectique de l'idéalisme allemand et son concept du savoir absolu ; c'est ce qui apparut tout particulièrement dans le fait que même la critique de l'école historique contre le panlogisme spéculatif de Hegel ne put se soustraire entièrement à cette domination. Sans doute Dilthey a-t-il affirmé qu'il importait de caractériser le « lien vital » de la force et de la signification comme le fondement de toute notre connaissance historique ; mais ses études relatives à l' herméneutique, dans la ligne de Schleiermacher, ne purent éviter d'aboutir à penser l'histoire comme un texte à interpréter. Certes, ce texte ne doit pas être déchiffré par une construction philosophique a priori, mais par la recherche historique ; toutefois, l'hypothèse selon laquelle l'ensemble significatif de l'histoire représente un texte lisible reste obscure et difficile à légitimer.
Dilthey a entrepris de fonder les sciences humaines sur l'expérience immédiate ; c'est pourquoi il a remplacé la psychologie causale et explicative, qui régnait alors, par une psychologie « descriptive et compréhensive » qui part de l'unité téléologique de la « structure » et non de la résultante des influences causales. Or, d'après lui, tout ensemble structural est un ensemble vécu. Par cette voie, on parvient en fait à interpréter les créations de l'esprit humain, que Hegel a nommées l'« esprit objectif », telles que l'art et la religion, comme une expression de la vitalité de l'homme. Cependant, l'ensemble de l'histoire n'est pas expression en acte : l'histoire n'est faite par personne et voulue par personne ; et, considérée comme le cours total des événements, elle n'est vécue par personne : qu'est-ce qui en fait donc l'unité d'un ensemble ? Il est significatif que le modèle préféré de Dilthey soit l'autobiographie. En celle-ci, effectivement, la totalité d'une vie est pensée et interprétée comme un ensemble vécu et dans une vision rétrospective. Mais qui est le sujet identique du cours de l'histoire du monde et de l'enchaînement causal de l'histoire du monde ? La doctrine de Dilthey sur « la construction du monde historique dans les sciences humaines » n'apporte finalement aucune réponse à cette question, et sa « typologie des visions du monde » cherche, derrière l'historique, une réalité supra-historique : la complexité de la « vie ».
La phénoménologie et les philosophies de l'existence
De l'historicité, il a été aussi question dans un autre ensemble systématique de la philosophie de cette époque ; ainsi chez Bergson et dans l'idée, dont l'influence est durable, d'une phénoménologie génétique et constitutive, telle que l'a développée Edmund Husserl. La question qui dirigeait les recherches de ce dernier était la suivante : comment, à partir de la temporalité absolue de la vie de la conscience, de ses intentionnalités fluentes, s'édifient objectivité et validité ? Ce sens spécial de l'historicité absolue comme temporalité n'a rien à voir avec le problème de l'historicité dont on a parlé jusqu'à présent, puisque durée et validité objective étaient précisément parvenues à s'édifier dans les opérations de la conscience. C'est plus tard que Husserl, en cherchant à radicaliser le programme de la phénoménologie, a tenu compte de l'historicité des mondes biologiques, à vrai dire seulement par réaction à la critique radicale de Heidegger contre le concept de la conscience transcendantale.
À côté de Husserl, Max Scheler, en édifiant l'éthique des valeurs du point de vue de son contenu, a cherché lui aussi à éclaircir et à fonder phénoménologiquement le problème de l'historicité. En se rattachant à l'idée husserlienne de la phénoménologie considérée comme recherche a priori des essences, il a fondé une doctrine a priori des valeurs, mais sans éluder la question des rapports de ce système a priori des valeurs aux expériences historiques, réelles et concrètes, des valeurs. C'est pourquoi il distingua entre les formes concrètes d'ethos et la théorie a priori des valeurs, à vrai dire non sans faire intervenir un dernier effet en retour de la théorie philosophique sur un ethos « éclairé » de l'humanité future. L'historicité des formes d'ethos est négligée encore davantage chez Nicolai Hartmann. Pareillement, la réflexion infatigable sur le problème du relativisme historique qu'entreprit Ernst Troeltsch, en se rattachant à Dilthey, et la philosophie de la vie, inspirée par Nietzsche, dont partit Georg Simmel pour interpréter les objectivations de la civilisation, ne conduisirent pas réellement au problème radical de l'historicité et ne dépassèrent pas au fond la relation hégélienne entre l'esprit et l'histoire.
L'heure sonna véritablement pour ce problème lorsque ce qu'on appelle la philosophie de l'existence porta à un point radical la critique de l'idéalisme transcendantal. Elle était placée sous le signe de la redécouverte de Kierkegaard qui, écrivain chrétien, disciple de Schelling et critique de Hegel, avait, en affirmant l'impossibilité de déduire l'existence de la pensée, éveillé un thème capable, au-delà de Hegel et contre lui, de conférer à l'historicité, un rang autonome. Un mot clé résume l'entreprise heideggérienne de critique du concept néo-kantien de conscience transcendantale (la formule du néo-kantisme, empruntée aux Prolégomènes de Kant, était exactement : « la conscience en général ») et ce mot clé – « herméneutique de la facticité » – radicalisait les intentions de Dilthey. Formule paradoxale, pour autant que ce qu'on peut saisir comme « sens » par l'interprétation paraît séparé de la facticité imprévisible du donné de fait par un abîme infranchissable. Le même thème s'annonçait dans la doctrine jaspérienne des situations limites, expression qui désigne la limitation critique des possibilités de l'exploration scientifique du monde. L'existence de l'homme échappe à l'objectivation opérée par la science, pour autant qu'elle est caractérisée justement par l'unicité de la décision réclamée d'elle dans les situations de la vie. L'unicité irremplaçable de chaque choix à faire entre des possibilités concrètes rend manifeste la finitude radicale de l'existence humaine. Déjà le concept de la situation dans laquelle on se trouve et qui possède, par l'horizon qui lui correspond, sa perspective propre, exclut le savoir anonyme de la science, autrement dit indique les limites de celle-ci. Surtout, il existe des situations caractéristiques, par exemple la mort, que l'on ne peut penser à l'avance, de même qu'inversement elles rendent manifeste ce qu'un homme est véritablement. Mais la situation limite de toutes les situations limites est évidemment celle de la temporalité et de l'historicité elles-mêmes, qui caractérisent la situation comme telle.
L'herméneutique de Heidegger
Existence et finitude
C'est d'abord dans sa Psychologie des conceptions du monde (Psychologie der Weltanschauungen, 1919) que Karl Jaspers a exposé sa doctrine des situations limites ; il l'a plus tard développée, en lui donnant une signification fondamentale, dans son ouvrage Philosophie. Mais, plus radicalement que lui, Heidegger a élevé la question du caractère limite de la situation, ainsi que de la finitude et de l'historicité de l'existence humaine, au niveau de la philosophie classique, tout en détruisant la tradition de la métaphysique. Il renversa la problématique traditionnelle, du fait qu'il renonça à penser l'existence historique de l'homme à partir d'un concept de l'être évident par soi – concept qui est à l'origine de l'ontologie grecque de la substance –, mais, par une démarche inverse, il posa l'existence humaine comme base phénoménale de l'ontologie. L'être-là (Dasein) est un étant qui se comprend en fonction de son être, c'est-à-dire qui est caractérisé par la compréhension de l'être. Cela n'est pas une détermination supplémentaire d'un étant en soi, du genre de la « substance », mais, au contraire, tout sens de l'être en soi ne peut être manifesté qu'à partir de cet être-là qui se connaît dans sa finitude. Les modes d'être de la subsistance (Vorhandenheit), de la disponibilité (Zuhandenheit) et de l'être-là font apparaître non seulement l'ontologie grecque de la substance, mais aussi l'idéalisme de la conscience et l'objectivité ordonnée à celle-ci comme des interprétations secondes du Dasein. Leur fondement est l'herméneutique de la facticité. Avec ce déplacement d'accentuation ontologique, le problème du conditionnement historique de toute connaissance perd son acuité relativiste, car on voit à présent que la connaissance dite objective, par exemple celle des données mathématiques ou l'application des mathématiques à l'objectivité accessible à l'expérience, constitue un mode d'être dérivé, dont le fondement propre est l'être-là, caractérisé par la compréhension de soi. Ainsi, l'historicité devient le concept ontologique central, qui ne se détermine pas par privation à partir d'un être absolu ou d'un être éternel, mais, au contraire, justifie la revendication d'être de ces autres modes d'être.
Compréhension et interprétation
Avec cette radicalisation ontologique, le problème de la connaissance historique et la méthodologie des sciences historiques perdent leur position centrale. Si la question épistémologique de la philosophie néo-kantienne de l'histoire était de déterminer comment un fait donné devient un fait historique, le concept de fait apparaît maintenant comme un produit d'abstraction, et non comme le donné qui ne pose pas réellement de question. Dans l'élaboration critique des conséquences du nouveau point de départ ontologique, Heidegger montrait comment la critique nietzschéenne du concept de conscience, avec son extrémisme qui démasque, confirme le primat de l'interprétation en face des faits. Le mot de Nietzsche : « Il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'existe qu'une interprétation morale des phénomènes », trouve ici son corrélatif : il n'y a pas de « perception pure ».
Par la suite, Heidegger a abandonné la formule paradoxale d'une « herméneutique de la facticité ». En fait, cette formule laisse entendre qu'il y a un texte donné de la facticité qui est interprété par l'esprit connaissant, alors qu'en vérité l'interprétation, c'est-à-dire la compréhension de l'être, constitue le mode d'être de l'être-là lui-même. Or, puisque cet être-là est, d'après sa détermination essentielle, « à-venir », projet jeté, le concept d'historicité, lui aussi, implique une prééminence trompeuse de la connaissance de soi sur l'être. Ce n'est pas l'historicité consciente de soi qui est le véritable fondement de la question de l'être. Ce serait revenir finalement au concept hégélien de l'absolue transparence de l'esprit se connaissant, contre lequel l'expérience de l'historicité s'était frayé la voie, dans l'expérience laborieuse de recherche et le travail de réflexion du siècle post-hégélien. Aussi Heidegger va-t-il abandonner finalement le concept même d'historicité et le remplacer par celui de Geschicklichkeit (caractère de ce qui survient, de ce qui est envoyé, et aussi de ce qui est bien disposé), en lui donnant une signification tout à fait opposée au sens normal (habileté) de ce mot et en le faisant dériver de Geschick (destin). Car l'expérience de l'historicité se caractérise en ceci : elle n'est pas éprouvée comme une présence consciente du souvenir et de la mémoire dans leur constitution propre, mais comme ce qui est survenu à quelqu'un, sans que l'on en ait obtenu à chaque fois une conscience appropriée. Ce que l'expression Geschick et l'expression partiellement apparentée Schickung (destinée, au sens de dispensation) rendent visible, c'est que, à partir de la compréhension de l'être et de la compréhension de soi-même, le mode d'être de l'historicité ne peut pas être pensé d'une manière adéquate.
Langage et historicité
Cependant les questions radicales de Heidegger ont précisément permis aussi de penser l'interprétation et la compréhension, non comme de simples possibilités de connaissance et des modes de la conscience, mais comme un mode d'actualisation de ce qui survient à quelqu'un et de ce qui est survenu. Si l'herméneutique philosophique a découvert en toute compréhension un caractère d'événement, ce fut la conséquence d'une intelligence plus profonde des sciences historiques, elle-même rendue possible par les questions posées par Heidegger. En particulier, c'est seulement grâce à la radicalisation par ce dernier concept d'historicité qu'un autre phénomène pénétra au cœur de la philosophie, à savoir le problème du langage. Certainement, à d'autres points de vue tout différents aussi, il est caractéristique de la problématique de la philosophie actuelle que ce mode de manifestation de la pensée qu'est le langage soit devenu un thème central. Du caractère verbal de notre expérience du monde, on peut faire un objet d'analyse logique, en développant la théorie de la signification et la syntaxe de toutes les langues possibles et en fournissant ainsi une base théorique à la diversité historique des mondes linguistiques. Ainsi, certains thèmes de la philosophie du langage, tels que la philosophie idéaliste les avait envisagés et que Wilhelm von Humboldt surtout les avait développés, sont prolongés et élevés à une précision objective supérieure. Mais l'historicité des univers linguistiques est ici finalement recherchée en direction de quelque chose qui éclaire toutes les manifestations historiques du langage en y montrant de simples réalisations de possibilités théoriques. Cela peut se justifier proprement par le fait qu'on parvient ainsi à une maîtrise croissante de l'interaction et de la communication entre les hommes. Mais le problème radical de l'historicité perd son acuité, quand on comprend ce qui est historiquement unique comme la particularisation d'un universel. Si l'on voit au contraire dans le langage, non un simple instrument, déterminé par son usage et la maîtrise de cet usage, mais le mode d'actualisation de l'existence humaine dans son historicité propre, alors le langage n'est pas un ensemble instrumental pour l'expérience du monde et la communication de l'expérience, qu'il convient d'affiner et de perfectionner, mais, dans un sens radical, quelque chose d'historique. À ce point de vue, on parle – par exemple en pensant à la théologie de la révélation et de l'incarnation, mais aussi au langage de la loi et du droit, ou aux formes d'expression qui caractérisent l'œuvre d'art en ce qu'elle a d'unique – du caractère événementiel du langage. Ce qui arrive dans le parler ne se ramène pas au sens, réitérable et fixé, de ce qui est dit. Une malédiction qui est prononcée sur quelqu'un ne coïncide pas avec la simple compréhension de ce qui est dit verbalement et que peut saisir aussi celui qui n'est pas le sujet maudit lui-même. Une malédiction n'atteint son but que lorsque le sujet maudit la reçoit dans son être propre. De même, toute autre manifestation verbale originelle de l'être-dans-le-monde humain est indissociable des unicités historiques, dans lesquelles s'édifie l'être humain.
Ici, en particulier, la moderne psychologie des profondeurs a créé une nouvelle possibilité de vérifier l'historicité radicale de l'homme, en la confirmant, comme le font Jacques Lacan et Paul Ricœur, par l'analyse de la structuration de la personne et de l'existence sociale de l'homme.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Hans Georg GADAMER : professeur émérite à l'université d'Heidelberg
Classification
Médias
Autres références
-
DÉCADENCE
- Écrit par Bernard VALADE
- 9 946 mots
Longtemps hantée par le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident, la réflexion sur la décadence est solidaire d'une méditation sur l'Histoire dans laquelle elle s'inscrit. Elle l'est également de spéculations sur le destin des civilisations dont le devenir...
-
DILTHEY WILHELM (1833-1911)
- Écrit par Sylvie MESURE
- 1 222 mots
- 1 média
...l'entreprise (que poursuivra notamment G. Simmel) vise à établir l'autonomie de ces sciences de la réalité sociale, culturelle et politique qui rassemble l' historicité de leurs objets et que Dilthey nomme « sciences de l'esprit » (Geisteswissenschaften). En rupture avec l'épistémologie positiviste... -
ANTIQUITÉ
- Écrit par Pierre JUDET DE LA COMBE
- 1 984 mots
...camp choisi, cette querelle supposait que l'on dispose de critères rationnels, universellement valides pour juger les productions d'époques différentes. Elle devenait caduque à partir du moment où le caractère historique de l'humanité était pris en compte : il s'agissait alors non plus de juger, mais de... -
HARTOG FRANÇOIS (1946- )
- Écrit par François DOSSE
- 1 152 mots
- 1 média
François Hartog aura surtout innové en introduisant, au cœur de la discipline historique, le concept nouveau de la diversité desrégimes d’historicité. Ce concept lui est apparu comme pertinent à partir de ses liens avec l’anthropologie de Marshall Sahlins, et il a donné lieu à un premier article... - Afficher les 16 références
Voir aussi