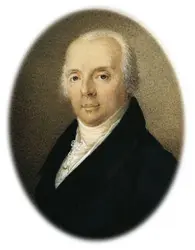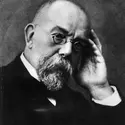HYGIÈNE
Article modifié le
Le xxie siècle : l’hygiène au défi de la santé globale
Le xxe siècle a enregistré des progrès considérables en termes de gain d’espérance de vie. Des médecins anglo-saxons, dans une enquête publiée en 2007 par le British Medical Journal sur les progrès médicaux, ont désigné comme cause principale de ces gains, le rôle prépondérant de ce qui a été réalisé en matière d’hygiène publique depuis 1840, avant les vaccinations et les antibiotiques. Même si on a pu parler à ce propos de « dérive hygiéniste », les débuts du xxie siècle montrent encore plus la nécessité de conforter la place des pratiques hygiéniques pour protéger la santé des populations. C’est ainsi que la stratégie de sanitation – traduite en français par « assainissement », trop limitatif – ou WASH (water sanitation and hygiene) a pris une place dominante dans les actions des organisations internationales telles que l’OMS et l’UNICEF.
Il faut en effet tenir compte de l’évolution du concept de santé par laquelle les notions de sécurité sanitaire et de « santé globale » ont pris une importance croissante dans un monde « globalisé ». Dans cette dynamique de prévention, la discipline médicale « Hygiène » doit intégrer les différentes composantes de la santé physique, mais également sociale et mentale. Elle ne doit pas se limiter à la seule lutte contre les maladies infectieuses, qui reste cependant une part essentielle de son activité, mais aussi se préoccuper de l’environnement et de sa pollution croissante, tout ce qui a contribué à l’émergence du concept « One Health » (« une seule santé ») au début des années 2000.
La pandémie de Covid-19 en 2020-21 a montré aussi la nécessité de prendre en compte les conséquences psychosociales engendrées par une crise sanitaire d’ampleur. Les hygiénistes doivent également se préparer aux conséquences déjà perceptibles du changement climatique avec la hausse des températures moyennes plus favorables à certains micro-organismes (bactéries, parasites, etc.) et insectes vecteurs en mettant en place des réseaux spécifiques de surveillance. Le changement attendu du régime des précipitations aura des conséquences néfastes pour l’homme (inondations, glissements de terrain…). La fréquence des périodes de canicule – très difficiles à supporter pour les personnes les plus fragiles dans des constructions mal isolées –, la diminution des ressources en eau pour la consommation humaine, animale et l’agriculture, l’émergence de nouvelles espèces invasives, etc., doivent engager les hygiénistes à mettre en place les moyens de limiter les conséquences éventuelles de ces phénomènes sur les populations exposées. En d’autres termes, dans la mesure ou la finalité de l’hygiène est de minimiser les dangers et les risques de l’environnement pour l’homme, ces changements impliquent une adaptation des pratiques et une extension des domaines de compétence de l’hygiéniste alors que l’essence de l’hygiène reste cependant inchangée.
Promotion des stratégies vaccinales
Concernant la protection contre des maladies infectieuses, la vaccination a été et reste une pièce centrale de l’hygiène. Les progrès des sciences médicales permettent de lutter à l'échelle mondiale contre des affections qui exerçaient – et qui, dans certains pays, exercent toujours –, d'importants ravages. L’épisode de la Covid-19 a montré une fois de plus les limites de ce progrès, fût-ce temporairement – avec des conséquences humaines et économiques très importantes, une estimation de 15 à 20 millions de morts par l’OMS, des séquelles préoccupantes chez de nombreux patients guéris, ainsi qu’une crise économique mondiale…
Cependant, l’hygiène y a retrouvé toute sa force. D’abord avec la promotion quasi universelle des « gestes barrières ». Ensuite, la mise au point rapide de nombreux vaccins contre l’agent de la Covid-19, le Sars-CoV-2, a permis une prophylaxie collective : des millions de personnes ont été vaccinées presque simultanément, établissant un barrage constitué par les sujets immunisés, entre l'agent pathogène et les sujets réceptifs. Ce concept d’immunité collective était parfaitement adapté pour certaines maladies infectieuses « anciennes » comme la rougeole. L’apparition en fréquence croissante de nouvelles zoonoses liées à un contact plus étroit entre homme et animal et à une accélération des échanges internationaux et des voyages, conduit à généraliser cette approche vaccinale pour des menaces qui pèsent sur l’espèce humaine comme, potentiellement, la grippe aviaire. C’est dans ce contexte que l’OMS invite les pays à se préparer au scénario de la « maladie X », qui devrait survenir un jour ou l’autre, risquant de poser des problèmes du même ordre que la Covid-19, voire plus graves. Fait remarquable concernant les moyens de lutte contre une telle maladie, cette dernière épidémie a vu la mise en œuvre extrêmement rapide de nouveaux vaccins à ARN messager, aisés à construire et à adapter. Cette technologie a montré tout son intérêt en association avec les mesures de prophylaxie individuelle et collective, malgré les réticences d’une partie de la population alimentées par les fake news et des avis médicaux contradictoires. La facilité de mise en œuvre de ces vaccins permet d’envisager une réponse rapide à l’apparition de variants d’un virus comme à d’autres agents pathogènes.
La prophylaxie vaccinale de masse est, de plus, amplement facilitée par la mise au point de vaccins polyvalents qui, associant des vaccins contre plusieurs agents infectieux, permet dans un même temps de créer une immunité contre plusieurs maladies infectieuses. Elle va devoir associer les nouveaux types de vaccins à d’autres plus classiques dans un contexte où une partie de l’opinion publique rechigne à se faire vacciner, y compris parmi le personnel soignant. La pensée hygiéniste devra s’assigner aussi comme mission d’apaiser ces réticences, ce qui constitue un chantier difficile, mais d’importance majeure. La population a cependant dans sa majorité compris l’intérêt de respecter les mesures préventives hygiéniques traditionnelles (hygiène des mains, port du masque, distanciation physique, isolement, limitation des rassemblements, etc.), redécouvrant ainsi les principes de base de l’hygiène systématisés dans les grands traités du début du xxe siècle, comme celui de l’Allemand Max von Pettenkofer.
La dissémination du virus SARS-CoV-2 par voie respiratoire prépondérante a favorisé la prise de conscience de l’importance de l’hygiène des bâtiments, surtout collectifs – en particulier au regard de l’insuffisance d’aération et de ventilation des locaux, avec la mise en place de jauges de fréquentation (nombre de personnes autorisées par m²) et le lancement de travaux pour limiter la contamination de l’air dans les espaces clos (renouvellement, filtration, etc.). Ce chantier n’est pas vraiment nouveau pour l’hygiéniste ; si la lutte contre la tuberculose s’attaque depuis longtemps aux logements insalubres, il est aussi nécessaire de se pencher sur les constructions récentes et les locaux mal ou pas ventilés, non conçus pour accueillir diverses activités humaines s’y déroulant. C’est dans ce cadre que les propositions du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) créé au xixe siècle, puis remplacé par le Haut-Conseil de la santé publique (HCSP) à l’aube des années 2000 sont toujours d’une grande utilité, et largement reprises dans la réglementation sanitaire.
Renforcer la réglementation sanitaire internationale
Des mesures de surveillance ont été établies dès 1851 (Ire Conférence internationale) et modifiées régulièrement, afin de protéger les pays contre les épidémies mondiales que provoquaient la peste, le choléra, la fièvre jaune, la variole, le typhus exanthématique et la fièvre récurrente. La réglementation actuelle consiste, entre autres, en l'application systématique de mesures d'isolement, de désinsectisation, de désinfection, de dératisation, selon la provenance des sujets, et en la pratique de vaccinations pour les voyageurs se rendant dans certains pays, obligatoires – comme celle contre la fièvre jaune pour les zones tropicales d’Afrique et Amérique du Sud –, ou recommandées, selon les pays – contre l’encéphalite japonaise, l’encéphalite à tiques, la fièvre typhoïde, les infections invasives à méningocoques, les hépatites A et B, la rage, la grippe saisonnière et la Covid-19. Elle a largement été mise en application, ou plutôt mise à l’épreuve du feu, de façon parfois désordonnée ou à visée protectionniste par les différents États, lors de la pandémie de Covid-19.
D'autres affections ont retenu l'attention des hygiénistes, tels le paludisme, la maladie du sommeil, la bilharziose, le trachome, la grippe, les maladies vénériennes, les diarrhées, le sida, le virus de la grippe aviaire H5N1… Tout un arsenal de lutte et de prévention a été développé pour suivre l’évolution de leur situation épidémiologique au plan national comme international. Le réseau de la surveillance de la grippe en est un exemple. En ce qui concerne les maladies à vecteurs, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour suivre leur évolution épidémiologique (capture d’insectes, suivi satellitaire des conditions sanitaires, des écosystèmes comme dans le cas de la peste au lac Tchad, etc.) et pour améliorer les méthodes de lutte antivectorielle (nouvelles moustiquaires, insecticides et désinfectants, méthodes de lutte biologique, etc.). Cependant, les insectes vecteurs et agents pathogènes s’adaptent très vite. La propagation en Europe de maladies qui n’étaient pas autochtones initialement – comme le chikungunya ou encore la dengue, véhiculés par le moustique tigre – montre que certaines évolutions peuvent se réaliser très vite, particulièrement en raison du changement climatique. Il est donc urgent de mettre au niveau des besoins les règles régissant la quarantaine, l’isolement et le commerce mondial afin d’éviter qu’une cacophonie comme celle qui a accompagné la Covid-19 ne se reproduise.
La production et surtout l’usage des antibiotiques doivent également être réglementés. Si leur utilisation a permis de célébrer des décennies de victoires sur les maladies infectieuses, la situation a bien évolué depuis la fin du xxe siècle avec l’apparition croissante de phénomènes de résistance. Certaines bactéries, en particulier en milieu hospitalier, peuvent être quasi totalement antibiorésistantes, et la mortalité qui leur est liée est considérée comme une des plus sérieuses menaces pour l’humanité à l’horizon de 2050. L’utilisation larga manu d’antibiotiques et autres agents biocides ne pourra que renforcer cette menace si l’on considère les relations entre mécanismes de résistance au niveau génétique. Ainsi, certains mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques – comme les « pompes d’efflux » – sont les mêmes que pour la résistance aux désinfectants ; l’émergence de populations résistantes s’opère donc au laboratoire comme sur le terrain. Ce phénomène est amplifié par l’usage massif d’antibiotiques en élevage comme facteurs de croissance (pratique maintenant interdite dans l’Union européenne) ou celui tout aussi massif de désinfectants pour lutter contre certains parasites (poux des volailles) ou micro-organismes (Campylobacter spp. sur les carcasses de poulets), s’accompagnant tous deux de l’émergence de résistances.
La situation est aggravée par les conséquences des pollutions chimiques dues à l'implantation des structures industrielles de production d’antibiotiques. Deux pays, l’Inde et la Chine, concentrent à eux deux environ 90 % des usines de production de ces molécules à visée antimicrobienne sans traitement d’épuration adéquat des effluents. En conséquence, fleuves et rivières véhiculent des germes résistants sélectionnés par ces substances libérées dans l’eau, que l’on a même pu retrouver dans des réseaux d’adduction d’eau publique. C’est un problème de pollution en soi, avec ses effets sur la faune et la flore, mais cela favorise aussi le nombre de malades, la sélection de germes résistants et la présence de porteurs sains de germes résistants à ces antibiotiques. La facilité et la rapidité des déplacements rendent de ce fait crédible une menace pour des populations distantes si les mesures adéquates locales d’isolement des malades et de dépistage des porteurs sains ne sont pas mises en place, ce qui n’est guère envisageable dans le contexte sanitaire de certains de ces pays et, bien entendu, si la cause de ces pollutions n’est pas traitée en amont. C’est donc dans le traitement adéquat des eaux résiduaires de ces usines par des stations d’épuration avant rejet dans le milieu extérieur et la mise en place de filières adaptées pour la production d’eau potable que repose une possible prévention.
De l’hygiène collective à l’hygiène de vie
L’extension de la notion de santé par l’OMS entraîne celle du domaine couvert par l’hygiène, jusqu’à toucher la vie personnelle des individus. C’est en effet en influençant cette dernière que l’on peut chercher à atteindre cet « état de complet bien-être physique, mental et social » auquel aspire l'OMS. Malgré les efforts consentis dans le domaine de la santé publique, cet objectif est loin d’être réalisé pour une grande partie de la population mondiale. C'est ainsi qu'en plus des fléaux endémiques qui frappent toujours les populations à niveau de vie précaire et sur lesquels la santé publique cherche à agir, on meurt des suites d’attitudes largement individuelles – de plus en plus du cancer et de conséquences de l’obésité liées à l’excès de nourriture, à la « malbouffe », souvent dans les populations les plus pauvres et à trop peu d’exercice physique dans les pays développés. De plus en plus de messages de prévention – de diététique, contre le tabac, l’alcool et le manque d’exercice – sont adressés aux populations. Par ailleurs, le marquage des aliments pour leur valeur énergétique est un pas vers une éducation de base du public à propos de l’alimentation. Les maladies cardio-vasculaires et le cancer sont les deux grandes causes de mortalité des pays industrialisés. Les étiologies de ces affections sont connues : la sédentarité, le tabac, l'alcool, les erreurs alimentaires et l'environnement y jouent un rôle non négligeable. L'intervention de l'hygiéniste s'impose donc ici dans le contexte d'une lutte coordonnée et d'un dépistage précoce réalisé dans le cadre de la médecine préventive.
L'accroissement des troubles psychiques est un fait indéniable, particulièrement dans les pays industrialisés. Il se fait ressentir aussi dans les pays en voie de développement, où l'industrialisation brutale crée une foule d’inadaptations. La délinquance juvénile, qui traduit d’une certaine manière l'état de santé mentale d'une population, est en constante augmentation. Les psychoses, les névroses, les conduites suicidaires se rencontrent de plus en plus couramment, de même que les toxicomanies et l'utilisation de substances tranquillisantes. La protection de la santé mentale (« aptitude parfaite à nouer des relations harmonieuses avec ses semblables »), bien développée sur le plan curatif, nécessite un grand effort dans le domaine de la prévention ; il faut multiplier les organismes de dépistage, mais c'est principalement une action éducative d'hygiène mentale collective qui permettra de réduire ces manifestations pathologiques.
L’information de prévention auprès des jeunes notamment s'impose donc dans tous les pays. Différentes instances étatiques et supranationales sont chargées de réglementer ces divers points. On ne parle plus alors d’hygiène, mais de santé publique. L’intention reste cependant parfaitement hygiéniste, comme en témoigne le concept d’« hygiène de vie ».
L’hygiène dans la cité
À des degrés divers, tous les environnements sont confrontés de manière croissante à des problèmes de pollution – chimique, microbiologique, voire physique (champs électromagnétiques, radiations) – de l’eau, de l’air intérieur et extérieur aux bâtiments, du sol, des aliments, liés aux développements industriels et à l’augmentation corollaire des nuisances qui leur sont associées. Des progrès techniques très importants ont parallèlement été réalisés avec l’impulsion de normes environnementales et de règles d’hygiène visant à réduire les divers types de pollution à leur origine, alors que les sources d’exposition augmentent ainsi que le nombre des personnes exposées. La pollution de l'atmosphère d'origine chimique ou microbienne est la conséquence directe du développement des agglomérations urbaines. Les causes en sont bien connues : produits de dégradation des industries, foyers domestiques, circulation automobile...
La réalisation de plans d'urbanisme judicieux, où l'hygiéniste doit intervenir, permet bien souvent de limiter les émissions des zones dangereuses et de promouvoir des espaces verts, dont le rôle bénéfique contre la pollution chimique et bactérienne de l'air, et contre le bruit, est reconnu. Le remplacement des véhicules à moteur thermique par d’autres utilisant l’électricité s’inscrit aussi dans ce sens, mais la production énergétique ainsi que celle des batteries nécessaires devront également réduire la pollution qui leur est liée.
Le risque de contamination par des substances chimiques ou par des bactéries nécessite une surveillance constante, afin d'assurer une protection sanitaire des aliments. L’importance de la fixation de normes sanitaires et de leur respect est indéniable. La surveillance de la radioactivité s’impose également dans de rares cas, particulièrement à la suite d’un accident nucléaire, comme ceux de Tchernobyl (1986) ou de Fukushima (2011). L'évacuation et le traitement des déchets de toutes natures, humains ou industriels, doivent être codifiés et les règles élémentaires d'hygiène appliquées, qui concernent notamment la préservation de la qualité de l'eau menacée par ces rejets, l'assainissement, la destruction ou la revalorisation des résidus.
D'autres nuisances dont la prise en compte relève de l’hygiène se rencontrent avec acuité dans les cités modernes : le bruit par exemple, quelle que soit son origine – circulation, aéroports, industries ou habitants –, et qu’il est urgent de réduire. Une telle réduction diminuerait sensiblement la fatigue et la tension psychique, améliorant le repos, évitant aux individus d'être soumis à des « stress » quotidiens. L'entassement, le surpeuplement sont aussi générateurs d'insalubrité, et il existe des taudis neufs aussi malsains que les îlots insalubres ou bidonvilles qui persistent, créant ainsi des foyers où la situation sanitaire reste inquiétante.
L'hôpital est une petite ville dans la ville, où l'on rencontre tous les problèmes de santé publique que l'on vient d'évoquer, auxquels il faut ajouter l’exposition aux rayonnements utilisés en diagnostic et en clinique, alors même que ce lieu est un « carrefour » où se croisent de nombreux individus. En raison de la présence de sujets fragilisés, les conséquences en termes de pathologies sont plus visibles, comme dans la surinfection hospitalière, aujourd’hui désignée comme infection « liée aux soins » ou « nosocomiale ». L'hygiène hospitalière est en charge de ces problèmes. Elle ne cesse de se développer alors que la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques, en particulier dans les services de soins intensifs, a un fort impact sur la mortalité des malades infectés. Des comités locaux de lutte contre l'infection nosocomiale (CLIN) – coordonnés au niveau régional par les CPias (comités de prévention des infections liées aux soins) – et des équipes d’hygiène ont été instaurés dans les hôpitaux pour participer à l'amélioration des conditions d'hospitalisation. Ces comités doivent également être consultés pour la construction, l’aménagement et l’équipement des locaux hospitaliers. Bien des mesures que l'hygiéniste préconise au sein de la collectivité hospitalière sont applicables avec profit à la cité ou à la région : lavage des mains, port du masque, nettoyage et désinfection des locaux et matériels, ventilation adéquate, séparation des flux de circulation... La notion de développement durable a vite percolé au sein des hôpitaux dont le fonctionnement – voire la conception, pour les nouveaux – doit intégrer les principes de cette dynamique : limitation et élimination adéquate des déchets, recyclage et filtration de l’air, limitation de l’usage inutile de désinfectants chimiques sur certains sols…
L’extension d’autres fléaux – accidents du travail, de la circulation, domestiques ou encore dus aux produits chimiques ou ionisants… – est une rançon directe de la civilisation et de l'industrialisation. Les causes en sont multiples, mais, bien souvent, il faut en rechercher dans les conditions de travail, les erreurs de manipulation ou le manque de formation. Dans les entreprises, les services de médecine du personnel en collaboration avec le comité d’hygiène et des conditions de travail (CHSCT) prennent en compte la prévention de ces problèmes et l’adaptation de l’opérateur et de son poste de travail. Il est possible de réduire par l'éducation sanitaire et la médecine préventive les taux de mortalité/morbidité importants attribuables à ces causes ; la prévention des séquelles de ces accidents qui grèvent lourdement le budget national s'avère une opération rentable ; les médecins et hygiénistes du travail ont une place prépondérante dans cette politique de prévention. Il est à noter que, dans certains pays européens comme l’Allemagne, ce sont des hygiénistes du travail qui interviennent dans les entreprises, les médecins généralistes assurant le suivi médical des individus.
La rénovation méthodologique de l’hygiène
Dans le dernier quart du xxe siècle, les notions mathématiques de probabilité, d'incertitude, d’erreur et de biais, présentes depuis des décennies dans les sciences dites « dures », ont gagné la santé publique. L'inefficacité de certains programmes d’actions pourtant mûrement réfléchis (telle la lutte contre le paludisme) ou, au contraire, l'efficacité inattendue d'autres programmes sont venues mettre en cause le paradigme de certitude et d'explication que la santé publique s'était construit. L'épidémiologie moderne est née de la nécessité de gérer l’incertitude en intégrant l'usage des probabilités. Elle permet ainsi à l'expérience d'acquérir un caractère scientifique diminuant la variabilité inhérente aux données qu’elle traite. L'action sanitaire fondée sur des données probantes fait aussi partie de ce paradigme.
La logique scientifique s'appuie sur le réel et sur les faits. Elle ne peut être fondée sur l’opinion, l'interprétation personnelle ou l'expérience aléatoire du professionnel isolé. En s'appuyant sur l’expérience collective validée et la synthèse critique des connaissances, elle se détourne de la hiérarchie gérontocratique issue de la pseudo-compétence associée à l’opinion d'un leader ou sur l'expérience personnelle cumulée pendant toute une vie. Ainsi a-t-on assisté à l’avènement de la démarche d’évaluation du risque sanitaire, maintenant bien codifiée à l’échelle internationale, permettant à l’hygiéniste de proposer, en termes de probabilité de maladies ou autres situations néfastes pour la santé, des valeurs et des mesures concrètes associées à des données chiffrées.
L’exemple de l’amiante – l’exposition à l’amiante est responsable de diverses pathologies pulmonaires dont les cancers de la plèvre – éclaire bien la nature et l’ampleur des enjeux. Le coût humain est estimé en 2000 à encore plusieurs dizaines de milliers de décès dans les prochaines décennies chez des personnes ayant été exposées en France. Le coût économique comprend par ailleurs celui lié au déflocage des bâtiments (pour la plupart, floqués à l’amiante dans les années 1960-1970). Le bénéfice pour la société de l’utilisation de ce matériau était lié à ses propriétés isolantes (isolation thermique, freins...). Fallait-il interdire l’amiante ou en prôner une utilisation contrôlée, et dans ce dernier cas, quelle norme choisir ? La prise en compte de ce type de question a posteriori aidera-t-elle à une véritable évaluation des risques pour éviter que des catastrophes similaires se reproduisent ?
D’autres exemples illustrent cette problématique : risque cancérogène lié aux dioxines et effluents gazeux des usines d’incinération ; risque cancérogène, mutagène et perturbateur endocrinien lié à certaines molécules telles que les pesticides et leurs résidus ; risque lié aux champs électromagnétiques (téléphones mobiles, réseaux WiFi, lignes à haute tension) ; effets sur la santé respiratoire et choix des carburants ; décontamination des sites pollués (jusqu’à quelles concentrations ?)...
Il s’agit à chaque fois de peser les effets sanitaires et les coûts économiques, les bénéfices et les désavantages pour la société. Cela nécessite, afin de mieux définir les priorités et de rechercher le meilleur rapport coût/efficacité, de se doter d’une méthodologie scientifique élaborée. C’est l’objet de l’évaluation quantitative des risques, qui comporte trois phases :
– la production de données scientifiques (risk investigation), « Quels sont les déterminants des effets sur la santé liés à la situation locale ? » ;
– l’évaluation des risques (riskassessment), « Quelles sont la probabilité et la sévérité des effets sur la santé de l’homme ? » ;
– la gestion des risques (risk management), « Quels risques sont inacceptables et comment les prendre en compte ? ».
Le processus est itératif : chaque phase informe la suivante et réciproquement. La méthodologie de l’évaluation des risques doit comporter quatre étapes consécutives :
– l’identification des dangers (des produits, micro-organismes et conditions physiques pouvant avoir un effet néfaste sur la santé) ;
– l’évaluation des expositions (quantification des expositions aux dangers qui en résulte, sous certaines conditions d’émission) ;
– l’évaluation des conséquences (quantification de la relation entre les expositions aux dangers et les conséquences pour la santé et l’environnement) ;
– l’estimation des risques (estimation de la probabilité, du moment de la survenue, de la nature et de la grandeur des conséquences défavorables).
L’hygiéniste a donc une mission d'expertise, et le décideur (de facto le gestionnaire de risque) prendra ses décisions soit au titre de la prévention (mesures proportionnées au niveau de risque acceptable pour la population), soit au titre du principe de précaution si les connaissances scientifiques sont insuffisantes.
Il appartient à l'hygiéniste d'essayer de prévoir, par des études prospectives, ce qui pourrait nuire à la santé de l'homme en particulier dans le cadre du changement climatique attendu et riche en risques potentiels. Le champ d'action qui s'ouvre à l'hygiène est immense, et son action doit s'exercer sur de multiples plans, mais seule l'éducation sanitaire permettra de promouvoir les mesures qu'elle préconise en fonction des causes décelées. Il faut lutter à armes égales contre les nuisances qui entourent l'homme et qui lui sont parfois imposées dans un but purement commercial et à ses dépens. L'information, la publicité, l'informatique doivent concourir à la prévention de la santé, en prenant garde de ne pas s'associer à des revendications publiques ou à des actes démagogiques ne permettant pas une action continue. Très souvent, une législation sanitaire orientée vers la prévention – et non la répression – permettra à l'hygiéniste de mener à bien la lourde tâche qu'il a entreprise. Il doit contribuer à l'élaboration de ces lois qui permettent de limiter les problèmes sans les rendre chroniques. Sans oublier pour autant les grands défis qui se posent à nous avec de plus en plus d'acuité et sur lesquels, semble-t-il, devra surtout porter l'effort des hygiénistes dans un avenir prochain : la progression sociale des pays en développement, l'amélioration des hôpitaux et des maisons de retraite, l'adaptation sociale des individus face à une technologie évoluant très vite, l'hygiène mentale ou plutôt la protection de la santé mentale pour éviter des manifestations pathologiques dans un contexte d’inadéquation au milieu sont parmi les défis les plus aigus.
Mais il faut aussi donner une place de choix à la lutte contre les fléaux qui affectent, en matière d'environnement, notre planète et auxquels on devra appliquer des solutions élaborées et non plus des mesures palliatives, parcellaires et insuffisantes. Dans ce cadre, la succession de saisons de pluies insuffisantes conduit à une situation de sécheresse des sols, de non-renouvellement des nappes phréatiques et d’insuffisance des ressources en eau pour les divers besoins de la population, de l’agriculture, des loisirs et de l’industrie dont nous constatons la réalité prégnante dans nos vies et leurs conséquences économiques. Il nous faut donc nous adapter très vite et l’hygiéniste a là aussi un rôle majeur quand il apparaît maintenant indispensable de limiter l’usage de l’eau « potable » à la boisson, la cuisine et l’hygiène corporelle et de réutiliser, après traitement adéquat éventuel, les eaux de pluie, les eaux grises et les eaux usées pour des usages domestiques (chasse d’eau des toilettes), le lavage des sols et voiries, l’irrigation agricole voire la recharge des nappes. Le risque sanitaire associé doit être maîtrisé par des mesures techniques encadrées par des normes de qualité et un contrôle des installations. Des pays asiatiques ou moyen-orientaux exposés aux pénuries d’eau et possédant un habitat dense avec des immeubles de grande hauteur, comme le Japon, Hong Kong et les Émirats arabes unis, ont déjà abordé ces problématiques et mis en place des solutions techniques telles qu’un double réseau d’eau dans les immeubles collectifs – l’un distribuant l’eau potable, l’autre pour l’évacuation des excréta des toilettes. Si cela existe également en France, comme à Paris ou à Nice, avec un réseau d’eau épurée réservé au nettoyage de la voirie, des véhicules municipaux et à l’arrosage des espaces verts, cette solution n’est pas encore effective pour les appartements en raison des erreurs de branchement qui feraient courir un risque excessif aux habitants. Dans quelques maisons individuelles, un récupérateur d’eau de pluie est utilisé pour les toilettes en interconnexion avec le réseau d’eau de distribution publique.
De même, la collecte des déchets doit être largement améliorée avec un tri préalable et le recyclage de tout ce qui peut connaître une nouvelle utilisation. La période de la mise en décharge indifférenciée (avec les risques sanitaires associés) est terminée, mais celle de la collecte spécifique connaît un lent développement… L’exemple de la réutilisation des déchets organiques ménagers pour le compostage illustre parfaitement les difficultés : la collecte chez les « gros producteurs » (restaurants, cantines, etc.) est relativement aisée ; la production du compost dans des maisons individuelles avec jardin revient à la mode ; mais la majorité des foyers vivant en appartement ne peuvent trouver de solution dans une cuisine où la présence d’un bac à compost exposerait à des risques sanitaires (par exemple, celui de la légionellose).
Historiquement, l’hygiène a été le principal moteur dans l’augmentation de l’espérance de vie des populations bien qu’avec des inconstances dans la mise en œuvre des mesures nécessaires. Ainsi, après de grands précurseurs grecs, romains et arabes, on a assisté à l’abandon des « saines » pratiques au Moyen Âge, avant leur remise au goût du jour à partir du siècle des Lumières, favorisée par le développement d’une approche désormais scientifique de l’hygiène. Celle-ci s’est accélérée au fur et à mesure que le progrès et la civilisation industrielle ont contribué à l’exode rural pour la création des villes et leurs « miasmes » nécessitant la prise d’un certain nombre de mesures : élimination des déchets et des eaux usées ; création d’un réseau d’adduction d’eau potable et d’hôpitaux salubres ; règles de production, distribution et consommation d’une alimentation saine, avec en particulier le respect de la chaîne du froid dès la fin du xixe siècle. Il a fallu simultanément créer des « normes » et les faire respecter par les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs. L’ensemble de ces réglementations est de plus en plus mal toléré par une partie de la population qui manifeste parfois violemment contre ces normes, accusées d’« étouffer socialement et économiquement » la vie des citoyens. Les gouvernements sont ainsi de plus en plus poussés à devoir simplifier ce « maquis administratif » au sein duquel des règles d’hygiène risquent d’être éliminées car « défavorisant », dans un contexte de libre-échange, les citoyens des pays les plus réglementés. Cette tendance ferait courir le risque d’une nouvelle régression sanitaire.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Philippe HARTEMANN : professeur honoraire de santé publique, université de Lorraine, faculté de médecine de Nancy
- Maurice MAISONNET : professeur honoraire d'hygiène, de médecine préventive et de santé publique à la faculté de médecine de Rouen, chef du service d'hygiène du CHU de Rouen
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
ACNÉ
- Écrit par Corinne TUTIN
- 3 313 mots
- 4 médias
La première est de conseiller aux acnéiques de senettoyer la peau avec un gel adapté ou un pain sans savon, de ne pas recourir à des produits de maquillage ou crèmes hydratantes comédogènes, et d’éviter aussi les gommages de peau. Plus marqué par l’actualité de 2020-2021, l’usage de masques pour... -
ASTHME ET IMMUNITÉ INNÉE
- Écrit par Gabriel GACHELIN
- 2 490 mots
- 1 média
...rôle du microbiome. Du côté de l’hygiénisme, cette étude démontre le rôle positif d’un monde microbien que l’on cherche généralement à éliminer au nom de l’hygiène. La tendance opiniâtre de l’hygiénisme, depuis la découverte des microbes, est en effet de diaboliser les micro-organismes et de les tuer pour... -
CHOLÉRA
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Henri-Hubert MOLLARET
- 2 883 mots
- 2 médias
La prophylaxie individuelle repose surtout sur les mesures d'hygiène visant à supprimer tout risque d'ingestion de vibrions : stérilisation de l'eau, du lait, traitement antiseptique des crudités, cuisson prolongée des aliments, etc. La prophylaxie générale en zone d'endémie repose sur... -
DÉCHETS
- Écrit par Jean GOUHIER
- 9 299 mots
- 5 médias
Dans la campagne du temps jadis, on expulse et disperse ses rejets sans graves dommages pour le voisinage.À la ville, le rejet familial rejoint la rue : épluchures, humeurs et odeurs variées des vases de nuit, déjections animales, litières diverses, boues fétides du sol piétiné par les hommes et les... - Afficher les 28 références
Voir aussi
- VACCINS & SÉRUMS
- COMPOST
- ÉGOUT
- LOGEMENT POLITIQUE DU
- TRAVAIL DES ENFANTS
- CHIMIQUES SUBSTANCES, écotoxicologie
- PROFESSIONNELLES MALADIES
- ASSURANCES SOCIALES
- RAMAZZINI BERNARDINI (1633-1714)
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- HÔPITAL
- NEW HARMONY
- NUISANCES
- ÉVALUATION
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- FRANK JOHANN PETER (1745-1821)
- RISQUES SANITAIRES
- SANTÉ DANS LE MONDE
- CANICULE
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- POLITIQUE SANITAIRE
- URBANISATION
- GRANDE-BRETAGNE, histoire : XVIIIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914
- ESPÉRANCE DE VIE
- ÉPIDÉMIES
- ROME, l'Empire romain
- MÉDECINE HISTOIRE DE LA
- CONDITIONS DE TRAVAIL
- POLITIQUE SOCIALE
- MÉDECINE ARABE
- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE
- EAU POTABLE
- SCIENCES HISTOIRE DES