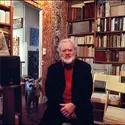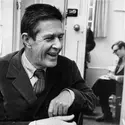XENAKIS IANNIS (1922-2001)
Article modifié le
Un pythagoricien
En 1955, Xenakis s'était livré à une critique lucide de la musique sérielle. Selon lui, la démarche des disciples de l'école de Vienne ne pouvait pas aboutir à une véritable rénovation des matériaux sonores, n'apportait pas, en ce qui concerne la « forme », de solutions radicalement nouvelles, et, en un mot, était déjà la victime d'un inéluctable académisme. Il tente donc, et réussit, une synthèse entre le monde de la logique et celui de l'émotion artistique. Bien au-delà des sectateurs du « nombre d'or », qui ne voient que des relations arithmétiques primaires, il jette une passerelle entre l'image abstraite d'un modèle mathématique et l'application de ce modèle sur le monde sonore. En 1954, pendant qu'il travaillait à agencer les surfaces courbes du pavillon Philips, il eut l'idée que les lignes droites, dont le déplacement engendrait lesdites surfaces, pouvaient, si elles étaient projetées sur la surface plane du papier à musique, y figurer des glissandi de violons ou d'autres instruments. Ainsi naquit Metastasis, pour 60 musiciens, créé le 16 octobre 1955 au festival de Donaueschingen sous la direction de Hans Rosbaud. Pour obtenir les résultats sonores qu'il souhaite et qui sont toujours animés de la palpitation d'une multitude de hauteurs et de durées différentes formant des sortes de nuages acoustiques (Xenakis les compare à des galaxies sonores), il était normal qu'il eût recours au calcul des probabilités. Dans Pithoprakta (créé le 8 mars 1957 lors du festival Musica Viva de Munich sous la direction d’Hermann Scherchen), pour quarante-six instruments à cordes, deux trombones et percussions, chaque élément, chaque note, qu'elle soit jouée avec l'archet ou en pizzicato, est assimilée à une molécule extrêmement mobile, telle la molécule d'un gaz contenu à l'intérieur d'une enceinte à une température et sous une pression données. C'est l'application aux sons de la formule de Maxwell-Boltzmann. Mais, théoriquement, c'est à partir d'un nombre suffisamment grand d'événements désordonnés, imprévisibles, que le calcul des probabilités permet d'obtenir des sortes de certitude portant non sur les détails, mais sur l'ensemble. Introduire dans cette « certitude » statistique certaines perturbations qui l'animent est une méthode intéressante que Xenakis emploie notamment dans Achoripsis, pour 21 musiciens (créé le 20 juillet 1958 au Teatro Colón de Buenos Aires sous la direction de Scherchen) et dans la série des ST/4, ST/10 et ST/48 ; ces derniers, écrits respectivement pour quatre, dix et quarante-huit instruments, sont calculés à l'aide d'un ordinateur I.B.M. (7090). Un peu après Claude et Betty Shannon, il propose pour ces musiques l'expression « musique stochastique » (en ignorant que d'autres l'avaient fait dans un esprit d'ailleurs sensiblement différent). Avec Duel, pour 56 musiciens divisés en deux orchestres (1959) et Stratégie, pour 82 musiciens divisés en deux orchestres (1962), c'est à partir de procédés inspirés par la théorie des jeux de John von Neumann et Oskar Morgenstern qu'il oppose deux chefs d'orchestre dont chacun imagine sa « tactique » musicale en fonction de celle de l'autre. Sans oublier que tous ces éléments sonores constituant les blocs, les nuages, les « galaxies » sont aussi, d'un autre point de vue, des « ensembles » de notes, il introduit dans sa méthode de composition les méthodes de l'algèbre des ensembles et donne ainsi sa première œuvre pour piano seul, Herma (1961). Mais Xenakis n'oublie pas qu'il fut architecte, et l'espace le fascine. L'espace sonore, d'abord, dans Terretektorh, pour 88 musiciens éparpillés dans le public (créé le 3 avril 1966 au festival de Royan sous la direction de Scherchen), puis, à l'aide d'une construction de câbles métalliques qui n'est pas sans rappeler celle du pavillon Philips, les espaces plastiques et sonores dont il tente de faire l'alliance dans le Polytope de Montréal en 1967 et le Polytope de Cluny (ce dernier utilisant des rayons lasers et des lampes à éclats) à Paris en 1972.
Toujours à la recherche d'une adéquation entre l'organisation de l'espace et celle du temps, il réalise, en 1977, un « diatope », La Légende d'Eer, pour l'inauguration, le 11 février 1978, du Centre Georges-Pompidou, à Paris, dont la perfection dépasse celle des précédents Polytopes. La coordination entre les effets visuels (rayons lasers et lampes à éclats) ne nécessitait pas moins, pour un spectacle de quarante-six minutes, qu'un programme d'ordinateur de 140 500 000 instructions binaires. À côté de ces grandes fresques, nécessitant le concours d'un grand orchestre ou/et des moyens électroniques plus ou moins complexes, Xenakis ne dédaigne pas de revenir à une certaine ascèse en écrivant pour des instruments solistes. Après Herma, pour piano (déjà cité), c'est le violoncelle qui est sollicité dans Nomos alpha, utilisant la théorie des groupes (1966), puis le violon dans Mikka « S » (1976), et le clavecin dans Khoaï (1976), un percussionniste dans Psappha (1976 ; version électronique en 1996), à nouveau un piano dans Mists, utilisant la théorie des cribles (1980), de nouveau le clavecin, mais, cette fois, amplifié dans Naama (1984), un trombone dans Keren (1986), encore le piano dans à r. (Hommage à Ravel) [1987]. Auparavant, en 1981, il avait su merveilleusement exploiter les possibilités du clavecin (mélodiques, harmoniques et percussives) en l'alliant à des instruments à percussion dans Komboï.
En 1991, Xenakis renoue avec la composition aléatoire en réalisant Gendy 3, « musique de synthèse stochastique de sons à l'ordinateur », au C.E.M.A.Mu. (Centre d'études de mathématique et d'automatique musicales) à Paris. Il a fourni quelques informations à l'ordinateur ; celui-ci a produit une œuvre complète et le compositeur n'a conservé que ce qu'il aimait. Il est évidemment difficile de parler de forme pour une telle pièce, qui se présente comme une suite d'enchaînements brusques et inattendus. Xenakis compose en 1994 une seconde œuvre à l'aide du programme Gendy, S. 709. Il a exploré dans ces deux pièces toutes les possibilités de synthèse sonore qu'offre ce programme, des sons très simples au bruit blanc en passant par des sons riches allant presque jusqu'au bruit.
Les années 1994-1997 marquent un tournant dans la vie de Xenakis. À bien des égards, cette époque est en totale rupture non seulement avec la précédente mais aussi avec toute la production antérieure du compositeur. Elle voit éclore des pièces comme Sea Nymphs, pour chœur mixte, sur des phonèmes extraits de La Tempête de Shakespeare (1994), Ergma, pour quatuor à cordes (1994), Voile, pour 20 instruments à cordes (1995), Ioolkos, pour 89 musiciens (1995), ou encore Sea-Change, pour 88 musiciens (1997). Dans ces œuvres, généralement courtes et d'un seul tenant, Xenakis, rongé par la maladie, manifeste plus d'intériorité. L'écriture est épurée, les rythmes plus simples, avec une combinatoire de quelques valeurs seulement. Tous les artifices sonores qu'il a inventés sont définitivement abandonnés.
En 1998, le huitième festival de musique contemporaine de Radio-France, Présences 1998, rend hommage au compositeur en présentant une vingtaine de pièces qui retracent l'ensemble de sa carrière. C'est en 1998 également qu'il reçoit le Kyoto Prize, qui récompense des créateurs et des scientifiques majeurs, toutes disciplines confondues. Et Xenakis est bien un créateur qui se trouve au confluent des sciences et de l'art, lui qui a déclaré : « Une œuvre de musique obéit au même enchaînement qui préside à la formation d'une étoile ou à la création d'une cellule vivante. Grâce à elle, on se sent près de la création du monde et de l'origine de la vie » (in F.-B. Mâche, « Entretien avec Iannis Xenakis », in La Revue musicale, 1978).
Il ne faut en effet pas oublier que Xenakis est aussi un théoricien qui avait, dès 1963, dans son ouvrage Musiques formelles, déjà parfaitement exposé sa pensée. C'est en poursuivant les recherches dévolues au C.E.M.A.Mu. que Xenakis conçoit, en 1975, une machine dont la conception est révolutionnaire : l'U.P.I.C. (Unité polyagogique informatique du C.E.M.A.Mu.). Cette machine permet à chacun d'obtenir les éléments sonores de son choix à partir du dessin qu'il en fait sur une table spéciale qui permet l'entrée en ordinateur de toutes les données. L'idée est généreuse puisqu'elle tend à mettre à la portée de tous les moyens de réaliser concrètement des intentions musicales (ou sonores) sans avoir à passer par l'apprentissage du solfège ou de l'écriture. Ainsi, disait Xenakis, « tout le monde pourra devenir compositeur » ; ce à quoi Messiaen rétorquait malicieusement : « Mais est-ce que tout le monde sera musicien ? ». D'un point de vue purement esthétique, l'U.P.I.C. a démontré d'une manière expérimentale la corrélation qui peut exister entre une représentation plastique (le dessin exécuté par l'utilisateur de la machine) et les événements sonores symbolisés par cette représentation.
L'œuvre de Xenakis n'est pas seulement une illustration de ce qu'on peut appeler l'efficacité des modèles mathématiques en esthétique. Un aspect important doit être souligné : celui de l'unité et de la cohérence de son œuvre. En effet, si les moyens (modèles mathématiques) qu'il utilise sont nombreux et variés, les œuvres, elles, sont bien marquées par la seule personnalité de leur auteur. On peut ainsi vérifier que l'originalité d'un compositeur est toujours présente quelles que soient les techniques employées parce qu'elle transcende toujours les dites techniques.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Juliette GARRIGUES : musicologue, analyste, cheffe de chœur diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, chargée de cours à Columbia University, New York (États-Unis)
- Michel PHILIPPOT : professeur de composition au Conservatoire national supérieur de musique de Paris
Classification
Autres références
-
ACOUSMATIQUE MUSIQUE
- Écrit par François BAYLE
- 7 825 mots
- 5 médias
1958. Exposition universelle à Bruxelles. Le pavillon Philips, dessiné par Iannis Xenakis, présentait le Poème électronique de Varèse précédé de Concret PH de Xenakis sur trois voies distribuées sur quinze canaux de quatre cent cinquante haut-parleurs répartis sur les surfaces gauches en voile... -
ALÉATOIRE MUSIQUE
- Écrit par Juliette GARRIGUES
- 1 302 mots
- 4 médias
L'aléatoire tient une place singulière dans l'œuvre deIannis Xenakis. Ce compositeur-mathématicien sait que, loin de relever du hasard, les phénomènes naturels comme la pluie, la grêle, la neige, les nuages, le vent, les bruits et mouvements de foules sont en fait régis par la loi des grands nombres.... -
ARCHITECTURE & MUSIQUE
- Écrit par Daniel CHARLES
- 7 428 mots
- 1 média
Or c'est presque dans les mêmes termes que l'architecte et compositeurIannis Xenakis s'insurge, en 1958-1959, contre la stagnation qu'il croit devoir constater dans le domaine de la peinture et de la sculpture : « Deux arts, écrit-il, qui, tout en utilisant les effets de la lumière au contact... -
COMPOSITION MUSICALE
- Écrit par Michel PHILIPPOT
- 6 848 mots
- 2 médias
...consiste à appliquer à des phénomènes sonores des règles ou lois empruntées aux mathématiques ou à la physique ; ainsi, des formes inédites peuvent surgir ; le principal représentant de cette méthode est Iannis Xenakis. Plus récemment, enfin, sont apparues les musiques dites spectrales ; dans ces dernières,... - Afficher les 15 références
Voir aussi