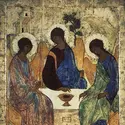ICONOSTASE
Article modifié le
Pour les contemporains, l'iconostase évoque cet imposant dressoir d'images saintes qui, dans les communautés orthodoxes de souche gréco-byzantine, isole le fidèle de l'espace sacré par excellence, le sanctuaire. Dans l'usage originel, eikonostasion définissait le support, sur pied ou en console, d'une icône privilégiée, disposée en avant de l'entrée du chœur. Le meuble existe du reste toujours avec la même affectation, et le même nom. L'élargissement de l'acception — d'un reposoir d'icône à une muraille d'images — est venu de Russie, dans le sillage de la mutation qu'il implique.
L'église paléochrétienne ne connaît, entre la nef et le sanctuaire, qu'une clôture assez basse. Celle-ci, dans sa version la plus élaborée, consiste en un chancel, tantôt plein, tantôt à claire-voie (réelle ou simulée), qui vient à hauteur de poitrine. Ses panneaux ou ses interstices sont ponctués par des colonnettes réunies au sommet par une architrave. La paire de colonnettes centrales délimite l'encadrement d'un portillon à deux vantaux, les « portes royales » ou « saintes », réservées au célébrant. Assez précocement, deux autres entrées furent ménagées, l'une sur la droite pour le diacre, l'autre sur la gauche pour les clercs inférieurs. Bref, l'ensemble constitue une alternance de panneaux et de vides entre colonnettes. Un rideau enfin est prévu pour aveugler le sanctuaire au moment le plus solennel de la liturgie (ce rideau est demeuré la seule clôture de chœur des églises arméniennes). Les éléments pleins, chancel et entablement, peuvent être relevés de motifs décoratifs ou de représentations de personnages sacrés en buste. Ce dispositif architectural a reçu, dès l'Antiquité, des noms variés : templon, diastyles, treillage ou chancel, voile et, beaucoup plus tard, iconostase.
Cette description permet d'imaginer grossièrement la configuration du templon de la Sainte-Sophie de 563. À cette époque, le templon, parfois de marbre ou de pierre, à l'occasion rehaussé d'argent comme à Sainte-Sophie, était le plus souvent en bois ou en maçonnerie.
Au xie et au xiie siècle, le templon aéré et muet commence à se transformer en une iconostase opaque et parlante. Ce changement impose les deux ou trois constantes du futur décor. L'Annonciation, fréquemment représentée sur l'arc qui surplombe l'entrée du sanctuaire, émigre sur les vantaux des portes royales, la Vierge à droite, Gabriel à gauche. Progrès beaucoup plus décisif, la composition dite de la Déisis (« supplication » de Marie et du Prodrome au Christ qu'ils flanquent), dont la place courante était sur l'arc d'entrée de l'abside, vient couronner le templon en son centre. Bientôt, la Déisis s'agrégera le groupe des fêtes, déjà attesté comme autonome ; six fêtes sont représentées de part et d'autre : la Nativité de la Vierge, sa Présentation, l'Annonciation, la Naissance de Jésus, sa rencontre avec Syméon, son Baptême, la Transfiguration, les Rameaux, l'Ascension, la Pentecôte, la Dormition de la Vierge, l'Exaltation de la Croix. Peu à peu, des images peintes sur les piliers entre lesquels s'insère le templon se recentrent sur la clôture du chœur, de même que des icônes mobiles, exposées chacune sur son « iconostase » individuelle. C'est ainsi que finalement trouvent place : à la droite des portes royales, le Christ et le titulaire de l'église ; à gauche, la Mère de Dieu et un saint en particulier honneur, le Prodrome ou encore saint Nicolas.
À cette phase du développement de l'iconostase, les membrures du templon demeurent relativement distinctes. La planche continue sur laquelle sont distribuées les scènes des fêtes autour de la Déisis est suspendue à l'architrave et les personnages isolés sont figurés à mi-corps. D'autres formules sont possibles : peinture sur entablement profilé des templa en maçonnerie ; sculpture, en revanche, quand le matériau est plus noble. De cette époque n'ont survécu que des fragments. Un point reste acquis : cette formule empreinte de sobriété est en vigueur jusqu'à la chute de Byzance (1453), malgré l'invasion sporadique de ce canevas encore harmonieux par des sujets parasites — cycles de saints —, sous la pression de dévotions locales.
Le passage irréversible du templon à l'iconostase se situe en Russie à la charnière du xive et du xve siècle. L'abondance du bois favorise le développement d'architectures géantes sur lesquelles de grands artistes dressent des personnages ou des scènes de dimensions jamais imaginées avant eux. Ainsi en fut-il de l'iconostase de l'Annonciation du Kremlin, à laquelle travaillèrent, dans la première décennie du xve siècle, Théophane le Grec et Andreï Roublev. L'invasion de thèmes libres se confirme sans jamais annuler les grandes constantes. Le sanctuaire enfin est pratiquement muré.
La nouvelle version, le gigantisme en moins, affectera toute l'orthodoxie gréco-slave, notamment grâce au relais des monastères de l'Athos. Cette évolution s'accompagne d'ailleurs d'un étalage de richesse, d'une sophistication baroque du travail du bois, sous l'influence austro-hongroise, d'une prolifération de sujets périphériques.
Des manuels de peinture aussi bien que de la statistique on peut désormais induire l'illustration idéale d'une iconostase « classique ». Celle-ci comporte quatre ou cinq registres : en bas, outre l'Annonciation des portes saintes, les quatre personnages déjà mentionnés ; au-dessus, les apôtres disposés de part et d'autre de la Déisis ; plus haut, les grandes fêtes ; au quatrième niveau, les prophètes ; enfin, dominant le tout, la scène du crucifiement.
On grève souvent le dispositif de l'iconostase de toutes sortes de significations historiques ou symboliques. Retenons que l'iconostase n'est pas, comme le disent encore certains ouvrages, un mémorial de la victoire des images en 843 ; elle s'est affirmée beaucoup plus tard. Elle est une exploitation didactique (consistant à raconter le cycle du salut selon ses temps forts) d'un élément architectural qui avait lui-même sa valeur sacrée, celle-ci étant plus abstraite.
Plutôt que de s'égarer dans le déchiffrement de symbolismes a posteriori, il conviendrait d'explorer les ressorts spirituels effectifs de la transformation du templon. La réflexion des penseurs orthodoxes contemporains est prometteuse à cet égard. Ils conviennent que l'iconostase s'est hypertrophiée, que, partant d'une illustration élémentaire (la Déisis, l'Annonciation, la représentation du Christ et celle de sa Mère) favorable au recueillement, elle a dégénéré en un facteur de dispersion. Ils déplorent plus encore qu'elle ait « transposé entre clercs et laïcs la tension entre l'Église et le monde » (P. Evdokimov) et contrarié l'unanimité de la prière eucharistique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean GOUILLARD : docteur ès lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)
Classification
Média
Autres références
-
AUTELS
- Écrit par Louis LÉVY
- 3 693 mots
- 1 média
...tombé en désuétude au cours des siècles derniers. Enfin, on l'isole du reste de l'église par une clôture dont le développement a produit les jubés et les iconostases. À la limite, ces séparations masquent complètement l'autel aux yeux des fidèles, comme c'est le cas dans les Églises orientales au moment... -
BYZANCE - Les arts
- Écrit par Catherine JOLIVET-LÉVY et Jean-Pierre SODINI
- 13 540 mots
- 10 médias
...seconde moitié du xe s.], à Hosios Loukas) ou ioniques à imposte (voir les remplois byzantins à Saint-Marc de Venise). En revanche, le templon (ou iconostase), c'est-à-dire la clôture haute séparant les fidèles du sanctuaire, se développe largement. Beaucoup de ses éléments (plaques de parapet, supports,... -
ICÔNE
- Écrit par Olivier CLÉMENT et Catherine JOLIVET-LÉVY
- 4 806 mots
- 3 médias
...(d'abord en marbre ou en matériaux précieux, puis en bois), qui sépare la nef, où se tiennent les fidèles, du chœur, réservé au clergé. Sa transformation en iconostase va commencer à l'époque de la dynastie macédonienne. C'est alors qu'apparaissent, au xe siècle, les icônes d'épistyle placées... -
JÉSUS ou JÉSUS-CHRIST
- Écrit par Joseph DORÉ , Pierre GEOLTRAIN et Jean-Claude MARCADÉ
- 21 175 mots
- 26 médias
À partir du « Christ en majesté » de la Déisis qui surmonte l'iconostase, cette barrière couverte de rangées d'icônes séparant les fidèles du sanctuaire qui se consolide de façon spécifique en Russie moscovite du xive siècle au xvie siècle, on en est arrivé à sa figuration...
Voir aussi