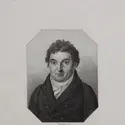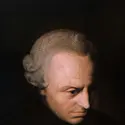IDÉALISME ALLEMAND
Article modifié le
Un gouffre entre l'homme et la nature
L'aventure singulière de l'idéalisme allemand se préparait de longue date, mais c'est bien Kant qui l'a véritablement engagée, en rompant avec la métaphysique traditionnelle. Le dogmatisme de Leibniz et de Wolff, se targuant d'une connaissance exhaustive de l'absolu, ne lui parut plus offrir les défenses théoriques suffisantes contre ce qu'il tenait pour les principaux dangers : il a cru sauver l'essentiel en procédant à une critique méthodique des pouvoirs de la raison humaine.
À l'encontre de l'idéalisme subjectif, il a maintenu l'existence d'une réalité indépendante de la connaissance que nous élaborons, et extérieure à elle ; l'existence des choses en soi, distinctes des « choses pour nous », et dont la connaissance en tant que telles nous est inaccessible. Contre le matérialisme, il a soutenu que nous connaissons seulement les choses pour nous, telles que les choses en soi apparaissent dans notre conscience humaine, dans les conditions que leur imposent les formes de notre sensibilité et les catégories de notre entendement : en les réduisant, donc, à de simples « phénomènes ».
De cette manière, Kant croyait sauvegarder à la fois une objectivité des phénomènes (les mêmes pour tous les hommes) qui fonde la science, et une liberté de l'action humaine, condition sine qua non de la moralité : « La doctrine de la moralité peut garder sa place et la physique la sienne, ce qui n'aurait pas lieu si la critique ne nous avait d'abord appris notre ignorance inévitable à l'égard des choses en soi et n'avait restreint tout ce que nous pouvons connaître » (Préface de la deuxième édition de la « Critique de la raison pure »).
Le projet kantien est bien de soustraire l'essentiel de l'homme à la nécessité et à la causalité naturelles. Car, « si les phénomènes sont des choses en soi, la liberté est impossible à sauver. La nature est la cause intégrale et en soi suffisamment déterminante de tout événement, et la condition de chacun est toujours renfermée uniquement dans la série des phénomènes qui sont nécessairement soumis, avec leurs effets, à la loi de la nature. Si au contraire les phénomènes ne sont tenus pour rien de plus que ce qu'ils sont en effet, c'est-à-dire non pour des choses en soi, mais pour de simples représentations qui s'enchaînent suivant des lois empiriques, ils doivent eux-mêmes avoir encore des fondements qui ne sont pas empiriques ». Dès lors, comment cette liberté peut-elle agir dans le monde réel, éventuellement d'une manière morale ? Kant a mis en évidence la difficulté : « Bien qu'un gouffre qu'on ne saurait embrasser du regard existe entre le domaine du concept de la nature, en tant que sensible, et le domaine du concept de liberté, en tant que suprasensible, de sorte que du premier au second (donc au moyen théorique de la raison) aucun passage n'est possible, tout comme s'il s'agissait d'autant de mondes différents, dont le premier ne peut avoir aucune influence sur le second, cependant ce dernier doit avoir une influence sur celui-là... » (Critique de la faculté de juger, 1790).
Mais comment qualifier de « gouffre » ce dont, d'une rive supposée, on n'aperçoit pas l'autre rive ? Ne faut-il pas en faire le tour, même précairement, d'un seul regard ? Et si l'on réussit à voir l'autre rive, elle devient « pour nous » et subit ainsi sa déchéance en phénomène... Kant a dû consentir à des efforts théoriques extraordinairement complexes pour surmonter les difficultés nombreuses du dualisme qu'il avait institué. La principale naît de l'inconnaissabilité de la « chose en soi ».
Les disciples de Kant, séduits par bien des aspects de sa doctrine, n'ont pu supporter longtemps cette thèse. C'est Fichte qui a fait sauter cet obstacle à l'impérialisme du moi comme sujet pensant et à la haute puissance de la liberté. Il a refusé toute extériorité radicale, étrangère au sujet, en voulant que l'extériorité elle-même soit « posée » par ce sujet. Il s'est ainsi rapproché de l'idéalisme subjectif, peut-être dangereusement, sans toutefois le rejoindre entièrement. Car il ne se rallie nullement au sensualisme empirique de Berkeley ou de Hume. La subjectivité dont il se fait l'apologiste revêt un autre sens. Elle est celle d'un sujet intellectuel, volontaire, absolument actif : l'activité radicale du sujet pensant.
Schelling tentera de restituer à la nature ses prérogatives. Fichte ne pouvait faire dériver de l'activité du sujet, telle qu'il la concevait, qu'un monde extérieur tout à fait abstrait : « En transférant au moi l'explication de toutes choses, Fichte croyait échapper aux difficultés que l'esprit philosophique trouve à expliquer le monde dans l'hypothèse de l'existence objective des choses ; mais alors il devait se sentir d'autant plus obligé à montrer en détail comment avec le seul „Je suis“, le „monde extérieur“ se trouve posé pour chacun avec toutes ses déterminations aussi bien nécessaires que contingentes » (Contribution à l'histoire de la philosophie moderne). Mais la nature ne bénéficiait pas de cet usage, chez Fichte. Elle ne servait que de vis-à-vis et de repoussoir au moi : « On dirait que Fichte ne percevait pas de différences dans la nature extérieure. La nature entière se réduit pour lui à l'idée abstraite, purement limitative du non-moi, de l'objet complètement vide où il n'y a rien à percevoir, sauf justement son opposition au sujet » (ibid.). Il s'agira pour Schelling de reconnaître la nature en tant que telle, sans désavouer l'idéalisme, de restaurer « l'unité de la nature et de l'homme » : autrement dit de franchir le « gouffre » évoqué par Kant.
Hegel y consentira à son tour. La philosophie de Fichte appelait, par opposition, « une philosophie dans laquelle la nature serait réconciliée (versöhnt) avec l'homme, après avoir été si malmenée dans les systèmes de Kant et de Fichte : alors la raison s'accorderait (übereinstimmen) avec la nature ». Il fallait qu'un grand esprit eût le génie de ramasser toutes les idées variées et parfois discordantes de cette tendance philosophique exceptionnellement foisonnante pour en faire, par le jeu d'une dialectique subtile – méthode qu'il savait régénérer et développer –, quelque chose comme un organisme intellectuel unique, intérieurement vivant, extérieurement cohérent, apparemment complet et universellement explicatif. Hegel vint au bon moment et se présenta lui-même, non sans une outrecuidance que l'on ne remarque pas aussitôt, tant elle se dissimule habilement derrière un savoir encyclopédique mis en œuvre par une intelligence dominatrice et passionnée, comme le résultat de toute cette pensée allemande, destinée dès l'origine, selon lui, à élever finalement son système sur le pavois.
Il voulait présenter toutes les tendances, opposées entre elles, tous les épisodes, successivement surmontés, comme relevant de la vie intérieure de l'Esprit universel – par là même présupposé – et ne laissant donc rien de radicalement extérieur. Idéalisme en lui-même sans concession, mais minutieusement articulé, qui assure le triomphe réel de l'Idée, et en même temps, sans le négliger, tant s'en faut, réduit le réel, tel qu'on l'entend habituellement, à une sorte d'illusion. Hegel ne se laisse pas plus tenter par l'indécision, à la fin de sa vie, qu'au moment du Premier Programme de sa jeunesse. Il ne s'effraie pas de le proclamer : « L'objectivité est en quelque sorte une enveloppe sous laquelle le concept se tient caché [...]. C'est dans cette illusion que nous vivons, et en même temps elle est le seul facteur agissant sur lequel repose l'intérêt dans le monde. L'Idée en son processus se crée elle-même cette illusion, s'oppose un Autre et son agir consiste à supprimer cette illusion. C'est seulement de cette erreur que surgit la vérité et en elle réside la réconciliation avec l'erreur et avec la finité. L'être autre, en tant que supprimé (ou l'erreur), est lui-même un moment nécessaire de la vérité, qui n'est qu'en tant qu'elle se fait son propre résultat » (Encyclopédie des sciences philosophiques). Rien n'est oublié de ce qui s'est succédé dans le temps, rien n'est perdu de ce qui s'est dispersé dans l'espace, mais tout est idéel. L'idéalisme allemand procède sans trembler au sacrifice de la victime expiatoire : la réalité du sensible, de l'empirique, du « réifié ». Il expose l'Idéal à l'admiration de ses adeptes et, fatalement, aux sarcasmes de ses adversaires.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jacques d' HONDT : professeur émérite à l'université de Poitiers
Classification
Autres références
-
DIEU - Problématique philosophique
- Écrit par Jacques COLETTE
- 5 678 mots
Schelling posera à nouveau et de manière radicale la question de l'origine de la raison.Walter Schulz a montré comment le système de la subjectivité conduit ici à son achèvement la philosophie de l'idéalisme allemand. Assuré de pouvoir exercer sa puissance sur les êtres de ce monde, l'esprit... -
FICHTE JOHANN GOTTLIEB (1762-1814)
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Alexis PHILONENKO
- 8 865 mots
- 1 média
...que la philosophie de Fichte ait été en partie méconnue et en partie défigurée par des commentateurs prestigieux : Jacobi, Hegel et surtout Schelling. L'étude de Fichte contraint à renoncer à l'idée traditionnelle de la continuité de l'idéalisme allemand : sa philosophie ne s'insère... -
HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH (1770-1831)
- Écrit par Jacques d' HONDT et Yves SUAUDEAU
- 11 855 mots
- 1 média
Hegel situe lui-même sa philosophie dans la tradition idéaliste, en assimilant habilement à celle-ci, ou en récupérant à son profit, tout ce qui dans l'histoire de la pensée a fait mine de s'en séparer ou de la contrarier : matérialisme, « réalisme », empirisme, « naturalisme... -
KANT EMMANUEL (1724-1804)
- Écrit par Louis GUILLERMIT
- 13 376 mots
- 1 média
Ce nom de métaphysique formulait une prétention à acquérir la connaissance d'objets qui se situent au-delà de la nature, dont l'expérience sensible permet à la physique de faire la science : cet être de tous les êtres et qui en est la première cause ou Dieu, cette substance incorruptible... - Afficher les 8 références
Voir aussi