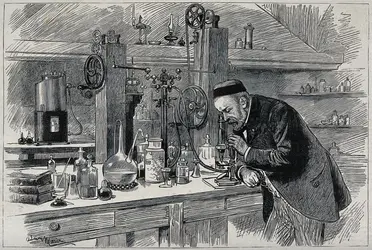IMMUNOLOGIE
Article modifié le
La notion de système immunitaire
Le fonctionnement et le maintien de l'intégrité (homéostasie) de nombreux systèmes physiologiques vitaux, nerveux, immunitaire, endocrinien, etc., et, plus généralement, des organismes eux-mêmes chez les animaux pluricellulaires (Métazoaires), mettent en jeu des ensembles cellulaires et moléculaires de complexité variable intégrés et régulés. Il s'agit de véritables circuits de communications intercellulaires et d'interactions moléculaires très élaborés et interconnectés au sein de chaque système et entre différents systèmes de l'organisme régis par une dynamique de type cybernétique. Ces réseaux biologiques de transfert d'information impliquent l'émission, la réception, la transmission et l'amplification de signaux de nature physique et (ou) chimique par l'intermédiaire d'une série d'effecteurs cellulaires et de médiateurs moléculaires (transmetteurs), spécifiques et non spécifiques des systèmes concernés.
Dans le cas du système immunitaire (S.I.), les signaux, les effecteurs et les médiateurs impliqués dans son ontogenèse et son fonctionnement sont exclusivement chimiques. L'opérateur fondamental du S.I., ou si l'on préfère l'agent qui en déclenche le programme d'action majeur, c'est-à-dire la réaction immunitaire, est l'entité moléculaire désignée par le terme générique d' antigène dont une définition précise est donnée plus loin. Cette réaction est un processus complexe dont l'étape initiale est la captation (fixation) de l'antigène par des cellules spécialisées capables de le reconnaître sélectivement (sans ambiguïté) grâce à des structures moléculaires appropriées fonctionnant comme des antennes spécifiques de l'antigène à la surface de ces cellules. Cette captation est suivie d'une cascade d'événements impliquant notamment la multiplication des cellules réceptrices et la production par celles-ci d'effecteurs moléculaires (produits de la réaction) dont la propriété est de se combiner spécifiquement avec l'antigène qui en a suscité la synthèse.
La réaction immunitaire permet à l'organisme de reconnaître tout antigène parmi les millions d'antigènes potentiels qui viendrait à pénétrer dans le « milieu intérieur » (au sens de Claude Bernard) et contre lesquels il pourra réagir en vue de préserver son intégrité, en particulier contre l'agression des micro-organismes infectieux ( immunité acquise ou spécifique par opposition à l'immunité naturelle ou non spécifique de l'antigène, cf. infection).
Les effecteurs cellulaires et moléculaires de la réaction immunitaire et de la reconnaissance des antigènes (cf. immunité) sont nettement plus complexes et diversifiés chez les organismes appartenant au subphylum des Vertébrés, tout particulièrement chez les Mammifères, que ceux des autres phylums (embranchements) des Métazoaires.
Chez ces organismes, les cellules qui reconnaissent les antigènes et élaborent les produits de la réaction immunitaire sont constituées par la population de leucocytes mononucléés appelés lymphocytes B et T. Les récepteurs de l'antigène présents à la surface de ces deux types de lymphocytes sont respectivement les immunoglobulines (Ig) et les récepteurs T (TcR pour T cell receptor). Les Ig sont des glycoprotéines, dont la forme soluble sécrétée par des plasmocytes (lymphocytes B différenciées) constitue les anticorps. Les récepteurs T sont constitués par deux chaînes polypeptidiques distinctes (hétérodimères) dont deux variétés α β et γ δ sont connues, étroitement associées à un ensemble d'au moins quatre protéines distinctes constituant le complexe moléculaire CD3 nécessaire au fonctionnement correct des TcR.
Sur le plan fonctionnel de leur interaction avec les récepteurs lymphocytaires, chaque molécule d'antigène se comporte comme un ensemble (mosaïque) de motifs structuraux de dimensions limitées, distincts les uns des autres, parfois identiques (motifs répétitifs) ou partiellement similaires. Ces motifs appelés déterminants (sites) antigéniques ou épitopes selon la terminologie proposée par l'immunologiste Niels Jerne diffèrent en totalité ou en partie d'un antigène à l'autre. Cette différence épitopique constitue le fondement du concept de spécificité antigénique. Le nombre de structures moléculaires épitopiques (ensemble des épitopes concevables) est pratiquement illimité. On admet, et cela est établi, que le S.I. des Vertébrés est capable de reconnaître dans les conditions appropriées n'importe quelle configuration moléculaire (épitope) comprise entre 0,5 nm (5 Å) et 3,4 nm (34 Å).
Chaque épitope d'un antigène est reconnu séparément par un récepteur lymphocytaire spécifique de cet épitope, c'est-à-dire possédant, au niveau du domaine V (partie variable) de la chaîne polypeptidique du récepteur approprié (Ig ou TcR), une configuration moléculaire stéréospécifiquement complémentaire de celle de l'épitope. Cette reconnaissance réciproque permet la formation d'un complexe épitope-récepteur ayant une constante d'association (affinité thermodynamique) suffisante pour en assurer la stabilité. Ce processus nécessite dans la plupart des cas la coopération d'autres populations leucocytaires (cf. infra), tout particulièrement les macrophages tissulaires et leurs formes sanguines les monocytes, qui constituent le système phagocytaire mononucléé appelé antérieurement système réticulo-endothélial (cf. phagocytose). Les récepteurs T, mais non les Ig, ne reconnaissent les épitopes qu'à la condition que ces derniers soient associés à des molécules présentes à la surface de cellules « présentatrices » de l'antigène codées par des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité (cf. immunité ). Grâce à la réaction immunitaire spécifique vis-à-vis d'agresseurs externes ou internes (propres à l'individu), ceux-ci seront neutralisés puis éliminés consécutivement à l'interaction des épitopes constitutifs de leurs antigènes avec les anticorps et/ou avec les récepteurs T spécifiques de ces épitopes.
Un lymphocyte donné n'exprime qu'un type de récepteur (Ig ou TcR) spécifique d'un seul épitope. Il en existe environ 105 par lymphocyte B ou T au repos (avant activation par l'antigène). Cette spécificité unique génétiquement programmée et indépendante du contact avec les antigènes sera la même (domaine V identique) pour tous les lymphocytes B ou T d'un même clone, mais différente d'un clone à l'autre, un clone étant un ensemble de cellules identiques descendantes d'une même cellule initiale. De ce fait, il existe autant de clones B et T différents que de sites antigéniques potentiels (au moins 108 structures épitopiques distinctes). Le terme de répertoire B ou T désigne l'ensemble des molécules d'immunoglobulines ou de récepteurs T qu'un organisme est capable d'exprimer à un moment donné à la surface de ses lymphocytes. Ce concept est à la base de la théorie de la sélection clonale formulée en 1956 par M. F. Burnett et maintes fois vérifiée expérimentalement. Elle est actuellement le fondement des théories du fonctionnement du système immunitaire, notamment le phénomène de la tolérance immunitaire, du réseau idiotypique et de la génération de la diversité des anticorps et des récepteurs T.
Les progrès réalisés depuis les années quatre-vingt dans la compréhension des mécanismes de la reconnaissance des antigènes et plus largement de la réaction immunitaire et des opérateurs majeurs du S.I. (Ig, TcR, antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité) ainsi que de leur déterminisme génétique résultent des apports technologiques et conceptuels considérables de l'immunologie, de la biologie cellulaire et de la génétique moléculaire. Les grands jalons de ces progrès ont été notamment la maîtrise des techniques de culture et de clonage des immunocytes (lymphocytes, monocytes) et de leurs lignées immortalisées, l'obtention d'hybridomes et la production d'anticorps monoclonaux, le tri cellulaire par cytométrie en flux, la découverte et la compréhension – qui est loin d'être complète – des fonctions des cytokines, véritables hormones de communication, et d'action du S.I., émises par certaines cellules immunitaires mais aussi non immunitaires, et reçues par d'autres.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Joseph ALOUF : membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie, professeur honoraire à l'Institut Pasteur, Paris, directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., professeur à l'Institut Pasteur de Lille
- Pierre GRABAR : membre de l'Académie de médecine, directeur honoraire de l'Institut de recherche sur le cancer du C.N.R.S, Villejuif, professeur honoraire à l'Institut Pasteur
Classification
Médias
Autres références
-
ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ
- Écrit par Bernard HALPERN , Georges HALPERN , Salah MECHERI et Jean-Pierre REVILLARD
- 12 577 mots
- 2 médias
La notion d'allergie a trait au phénomène paradoxal de la nocivité de certaines réactions immunitaires. La paternité de ce concept (apparu en 1906) revient au médecin viennois Clemens von Pirquet. Il cherchait notamment à expliquer par cette « réactivité altérée » (traduction des termes grecs réunis...
-
ANIMAUX MODÈLES, biologie
- Écrit par Gabriel GACHELIN et Emmanuelle SIDOT
- 9 550 mots
- 8 médias
...différences présentes dans la plupart des molécules qui les composent et peuvent les rendre fonctionnellement différentes d'une espèce à une autre. Ainsi, l'immunologie repose très largement sur les résultats obtenus par étude du système immunitaire des souris. La masse de connaissances acquises peut servir... -
ANTICORPS ET IMMUNITÉ HUMORALE
- Écrit par Gabriel GACHELIN
- 203 mots
En 1888, à Paris, Émile Roux et Alexandre Yersin démontraient que le pouvoir pathogène du bacille diphtérique était dû à une toxine plutôt qu'à la bactérie elle-même. Cette observation fut rapidement étendue au cas du tétanos. Il fallut deux ans à Emil Von Behring à Berlin...
-
ANTICORPS MONOCLONAUX
- Écrit par Michel MAUGRAS et Jean-Luc TEILLAUD
- 2 138 mots
Les anticorps, ou immunoglobines, sont des protéines sécrétées par une famille de cellules, les lymphocytes, dont la principale propriété est de reconnaître le « non-soi ». Les substances chimiques reconnues comme étrangères, qu'elles soient des associations de molécules ou des molécules,...
- Afficher les 85 références
Voir aussi
- SÉROTHÉRAPIE
- OPSONISATION
- GROUPES SANGUINS
- ALLERGÈNE
- IMMUNOTHÉRAPIE
- GLOBULINES SÉRIQUES
- COMPLÉMENT, immunologie
- PRÉCIPITATION, chimie
- IMMUNITÉ ADAPTATIVE ou IMMUNITÉ SPÉCIFIQUE, biologie
- IMMUNITAIRE SYSTÈME
- TOXINES
- ANATOXINE
- ANTICORPS
- ANTILYMPHOCYTAIRE SÉRUM
- REJET DE GREFFE
- CLONE
- HAPTÈNE
- AGGLUTINATION, immunologie
- ANAPHYLAXIE
- ARTHUS PHÉNOMÈNE D'
- BESREDKA ALEXANDRE (1870-1940)
- IMMUNOGLOBULINES
- IMMUN-SÉRUM ou ANTISÉRUM
- LYMPHOCYTES
- RÉACTION IMMUNITAIRE
- COMPLEXE MAJEUR D'HISTOCOMPATIBILITÉ (CMH)
- ÉPITOPES ou DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES
- RÉCEPTEUR DES LYMPHOCYTES T
- MÉDECINE HISTOIRE DE LA
- RECONNAISSANCE, immunologie
- PIRQUET CLEMENS PETER VON CESENATICO (1874-1929)
- WASSERMANN AUGUST VON (1866-1925)
- IMMUNISATION
- IMMUNOGÉNÉTIQUE
- DÉFENSE IMMUNITAIRE
- LYMPHOCYTES B
- LYMPHOCYTES T
- RÉCEPTEUR, biochimie
- ADJUVANTS, biologie et médecine
- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA