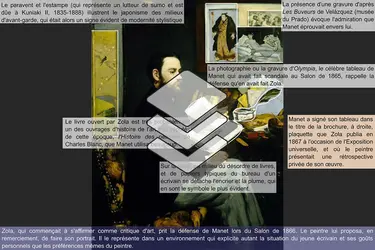IMPRESSIONNISME
Article modifié le
L'œil impressionniste
Un art tel que l'impressionnisme s'oppose totalement aux conceptions qui ont tendu à faire de l'art une tentative de définition, d'organisation et de restructuration du monde par l'intellect. Pour l'impressionnisme, l'art n'est en rien cosa mentale, rien ne diverge plus que lui de toute aspiration à un classicisme. C'est un art éminemment matérialiste, conforme en cela à une époque de scientisme et d'évolutionnisme, et Laforgue va au fond des choses en intitulant la première de ses notes d'esthétique : Origine physiologique de l'impressionnisme. Toute la volonté cosmique, s'incarnant dans l'organisme humain, aboutit à l'œil. Et à l'œil le plus subtil qui ait jamais pu se former à l'exercice le plus raffiné de son pouvoir de perception, l'œil impressionniste. « L'œil, une main », disait souvent Manet, selon ce que rapporte Mallarmé dans un de ses médaillons. Cette formule d'une fulgurante concision, si elle convient à l'art de Manet, résumerait encore plus justement la promptitude de ce que fut, pour les impressionnistes, le trajet de la perception au geste pictural. En fait ce trajet se contracte en immédiateté. Opération instantanée, exclusivement physique, contenue toute en de la matière.
Certes, cette perception se complète de sensation et de tous les effets d'ordre émotionnel que comporte le terme impression. Impression, soleil levant, tel est le titre d'un des tableaux que Claude Monet présente en 1874 au premier salon du groupe des jeunes artistes qui va devenir la nouvelle école. On en tirera l'étiquette sous laquelle ils consentiront à se ranger. « Impression, s'exclame un des joyeux lurons de la presse boulevardière qui tant se tordirent de rire à cette exposition, impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans... » En effet, les formes diffuses et les tonalités exquises perçues par l'œil impressionniste et aussitôt transcrites ne laissent point de répandre dans l'esprit du spectateur un sentiment lui-même vague, où l'on ne peut s'empêcher de reconnaître un plaisir, un plaisir d'ordre poétique. Et le critique d'art en question se déclarait lui-même « impressionné », tout en s'esclaffant à l'idée que pareil accident ait pu lui arriver. Sans doute ne concevait-il point que la peinture pût produire une émotion. Mais l'important en l'affaire, c'est que les impressionnistes, à leur première manifestation, ont imposé une certaine analyse, très précise, du phénomène pictural et admis que celui-ci aboutissait à produire dans la conscience du spectateur un effet de caractère affectif. Seulement le point de départ de l'opération est strictement physiologique. L'auteur de l'opération s'est tout entier concentré dans son organe optique.
Cette attitude matérialiste avait été préparée par le réalisme, celui de Courbet, celui aussi de l'école de paysagistes qui s'était développée depuis le xviiie siècle et qui pratiquait la peinture sur le motif, la peinture de plein air. Non sans raison, Raymond Cogniat, dans son ouvrage, Les Impressionnistes, insiste sur l'invention du tube de couleur qui, dès avant le milieu du xixe siècle, permit à l'artiste de sortir de son atelier sans avoir à traîner un encombrant équipement, et d'affronter la nature jusqu'à la fin de son œuvre. À la lumière de l'atelier se substitue la lumière universelle ; les ombres, les lueurs blafardes, les contre-jours bitumeux, tous les éclairages d'école s'abolissent, le regard du peintre comme celui du spectateur entrent dans le paradis de la peinture claire.
Dès lors, toute la géographie de la France se représente en images. La campagne des environs de Paris, la forêt de Fontainebleau sont illustrées par des hommes fuyant la ville, cherchant, isolés ou entre camarades, les recueillements de la solitude. Corot est le type parfait de ces amants de la nature, un continuel promeneur, qui, dans toutes les villes, toutes les campagnes de la province, découvre un coin capable de produire une impression sur le spectateur, non seulement objective, mais subjective, puisque, déjà, sur l'artiste lui-même le paysage en a produit une – une impression que, dans certains titres de ses tableaux, il appellera souvenir. Mais pour ce qui est des impressionnistes, une région aura leurs faveurs, une région humide, à la lumière mouillée et sans cesse changeante, l'Île-de-France, la vallée de la Seine, les côtes normandes. Deux précurseurs importants sont à évoquer ici : le hollandais Johan Barthold Jongkind (1819-1891), peintre très original, à la capricieuse écriture souvent japonisante et dont la carrière fantasque et tragique débuta sur les rivages de la Manche. Et Eugène Boudin (1824-1898), né à Honfleur, dont Baudelaire loua les ciels immenses et mouvants, dont le lyrisme s'exalte en proportion inverse de la dimension menue, gracieuse et drolatique des personnages qui animent ses plages. Il rencontra au Havre le jeune Claude Monet et l'initia à la peinture. Argenteuil et ses bords de Seine resteront un des hauts lieux de l'impressionnisme à ses débuts, avec les séjours qu'y firent, travaillant en commun, Manet, Monet et Renoir. Tout près de là, autre haut lieu : Pontoise. L'atmosphère de cette vallée et des plages normandes se prolonge en Angleterre. On sait les étroits rapports de Delacroix avec l'Angleterre, son amitié avec Bonington, tout ce qui rapproche son art de coloriste de celui de Constable pour qui le vert – la couleur même de la nature – n'est pas une teinte abstraite ni uniforme, mais une modulation infinie. Pendant la guerre de 1870, Monet et Pissarro, fuyant devant l'avance allemande, se réfugient à Londres, s'enchantent de sa lumière, de ses brouillards, des peintres anglais. Turner les intéresse, mais ils se sont défendus d'avoir subi son influence, ainsi qu'on l'a dit. Et, pourtant, les historiens doivent voir en Turner, objectivement, un grand annonciateur de l'impressionnisme – peut-être moins de sa technique que de son esprit et de sa poésie. Il avait, certes, un œil de coloriste, et de puissant coloriste ; plus encore un œil de visionnaire. Et ses images sont éclairées d'une lumière chimérique, mêlant en un vertigineux chaos les éléments déchaînés. À ceux-ci se sont joints, dans une célèbre toile, Pluie, vapeur et vitesse (1844), les démons industriels du siècle. Les Gare Saint-Lazare de Monet traiteront le même thème. Ainsi la sensibilité des poètes les plus raffinés ne fait-elle aucune différence entre la poésie des forces naturelles et la poésie, celle-ci toute neuve, insolite, méconnue, inconcevable, du progrès technique moderne. C'est que l'œil au degré d'acuité où l'ont porté l'impressionnisme et ses initiateurs n'a cure de choisir des sujets, de les choisir de préférence nobles et poétiques, mais s'applique, en toute équanimité, aux multiples aspects du spectacle universel.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean CASSOU : écrivain
Classification
Médias
Autres références
-
CLAUDE MONET ET L'IMPRESSIONNISME - (repères chronologiques)
- Écrit par Barthélémy JOBERT
- 554 mots
1862-1863 Monet, à Paris, se lie avec Bazille, Renoir et sans doute Sisley qui fréquentent comme lui l'atelier de Gleyre : c'est un des groupes d'artistes à l'origine du mouvement impressionniste.
1865 Monet commence Le Déjeuner sur l'herbe (fragments au musée d'Orsay),...
-
LES ÉCRIVAINS DEVANT L'IMPRESSIONNISME, Denys Riout - Fiche de lecture
- Écrit par Jacinto LAGEIRA
- 1 216 mots
Si les principaux peintres à qui l'on doit la naissance de la peinture moderne en France – Paul Cézanne, Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley – commencent à renouveler la pratique et l'esthétique picturale au début des...
-
ART (Aspects culturels) - L'objet culturel
- Écrit par Jean-Louis FERRIER
- 6 295 mots
- 6 médias
...l'antique. La nature, mon ami, c'est très bien comme élément d'étude, mais ça n'offre pas d'intérêt », enseignait encore Gleyre à Claude Monet. L' impressionnisme a été, au contraire, le premier grand mouvement pictural à rompre avec les « sujets nobles » dont on pensait jusqu'alors qu'ils étaient... -
ATELIER, art
- Écrit par Marie-José MONDZAIN-BAUDINET
- 5 947 mots
- 9 médias
...travail est prolétarien. L'artiste trouve une nouvelle matière qui lui est propre au sein du grand atelier naturel où il se réfugie : c'est la lumière. La lumière est « matière première » de l'impressionnisme ; contre l'espace de l'appropriation et de l'accumulation se crée une esthétique du fugitif,... -
BARBIZON ÉCOLE DE
- Écrit par Jacques de CASO
- 3 471 mots
- 7 médias
...fait, Corot continuait à travailler d'après nature, peu fidèle aux limites géographiques de Barbizon, au moment (1863) où les jeunes peintres de paysage, Monet, Sisley, Bazille et Renoir – qui allaient créer l'impressionnisme – venaient peindre en forêt de Fontainebleau. Dans la dernière phase de son style,... -
BAZILLE FRÉDÉRIC (1841-1870)
- Écrit par Alain MADELEINE-PERDRILLAT
- 2 465 mots
- 5 médias
Un peintre qui eut la chance de rencontrer très tôt Monet et Renoir, et de travailler avec eux, la chance de voir son talent vite reconnu par Émile Zola et par de bons critiques comme Edmond Duranty et Zacharie Astruc, la chance aussi de n'avoir jamais été dans le besoin ; mais qui eut le malheur...
- Afficher les 77 références
Voir aussi