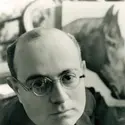INDIVIDU & SOCIÉTÉ
Article modifié le
Désir et sujet
L'ordre biologique est à définir à partir de la symbolisation qu'il rend possible – symbolisation qui l'annule lui-même et le transpose. Ce n'est donc pas dans le discours du positivisme qu'il doit être traduit, mais dans un discours où il recevra son statut de manque. Ainsi compris, l'ordre biologique a un destin comparable à celui qu'a, dans la théorie psychanalytique, la pulsion. Celle-ci, dont Freud dit qu'elle est un concept limite entre le psychique et le somatique, ne se trouve dans le système psychique que par ce qu'elle délègue d'elle-même à des « représentants », qui sont des signifiants soumis aux lois de l'inconscient. L'individuation, le devenir- sujet de l'animal-homme sont à rechercher là, dans ce lieu du passage, ou de la conversion, d'un domaine à un autre et de la soumission de l'un à la législation de l'autre : le lieu du désir.
Mais le désir, pour être au cœur de la psychanalyse, n'en a pas moins une archéologie philosophique qu'il faut évoquer et dans laquelle Hegel occupe une place dominante.
La philosophie classique – celle qui naît au moment où la science déclare que l'univers est infini et qu'il est constitué d'éléments simples unis par des lois mathématiques – fait apparaître une notion nouvelle : la notion de sujet. Ce sujet, qui semble devoir s'enrichir métaphysiquement de tout ce dont la nature s'est appauvrie lorsqu'elle a cessé d'être cosmos pour devenirres extensa, est défini comme liberté et il ne s'atteint, dans la pureté de sa subjectivité et la certitude de son être, qu'au prix d'une ascèse qui l'épure de tous les oripeaux du monde (aussi bien ceux du corps biologique que ceux du corps social), cette ascèse dont parle Descartes dans les Méditations métaphysiques.
Certes, il y aurait erreur à identifier, tel qu'il est chez Descartes ou chez Kant, ce sujet philosophique avec l'homme concret. Mais, par une sorte de logique inéluctable, le cogito cartésien ou le sujet transcendantal kantien s'étoffera et s'incarnera jusqu'à devenir cet individu défini par sa séparation d'avec la société, sa séparation d'avec autrui, propriétaire privé de son soi, cet individu bourgeois qui, fier de son quant-à-soi métaphysique, voit dans le monde social un lieu où des volontés libres se croisent et s'accordent ou s'opposent – ce que Hegel appellera, dans les Principes de la philosophie du droit, « l'athéisme du monde moral ».
L'itinéraire philosophique de cette notion montre à l'évidence que partir du sujet constitué abolit toute possibilité de donner consistance au monde social. En fait, les définitions réalistes de l'individu (que ce soit le réalisme biologique ou le réalisme du sujet-entité) interdisent de saisir ce qui semble devoir l'être : l'inséparabilité et l'irréductibilité de ces deux ordres symboliques que sont le sujet individuel et la société. Une telle question nous renvoie peut-être à celle de l'origine du symbolisme, c'est-à-dire à l'une de ces questions d'origine, qui sont de fausses questions, semblables à celles que Kant imputait à la métaphysique : des questions inéluctables et illégitimes.
Avec Hegel s'impose la nécessité de découvrir, dans l'être même de l'homme, l'inscription de l'Autre et de montrer que le sujet conscient-de-soi ne peut advenir que dans le champ du collectif.
Il y a quelque chose de paradoxal à enfermer le sujet dans une conscience-de-soi solitaire puisque, en effet, cette dernière ne peut logiquement être telle que parce qu'elle se saisit dans sa différence avec une autre conscience-de-soi, semblable et également singulière. C'est ce qu'établit la section A du chapitre iv de la Phénoménologie de l'Esprit, intitulée « Autonomie et dépendance de la conscience-de-soi : Maîtrise et servitude ». Alexandre Kojève dans son Introduction à la lecture de Hegel en donne ce commentaire : « La conscience de soi est en soi et pour soi quand et parce qu'elle est en soi et pour soi pour une autre conscience de soi ; c'est-à-dire qu'elle n'est qu'en tant qu'être reconnu. »
La conscience-de-soi n'existe comme moi qu'à se voir dans une autre conscience-de-soi. N'est-ce pas dire qu'elle se donne dans un jeu de miroir dont fait état le texte célèbre de Jacques Lacan sur « le stade du miroir », texte qui ne saurait être lu qu'à cette lumière et non à celle de la psychologie ?
Mais, sans entrer dans le détail de la démarche hégélienne, contentons-nous de retenir de celle-ci ce qui préfigure une œuvre qui a poussé sur un autre terreau, l'œuvre de Freud, ce que Kojève résume ainsi : « Le désir humain doit porter sur un autre désir [...] Pour qu'il y ait désir humain, il faut donc qu'il y ait tout d'abord une pluralité de désirs (animaux) [...] C'est pourquoi la réalité humaine ne peut être que sociale. Mais, pour que le troupeau devienne une société, la seule multiplicité des désirs ne suffit pas. Il faut encore que les désirs de chacun des membres du troupeau portent (ou puissent porter) sur les désirs des autres membres [...] Le désir humain diffère donc du désir animal (constituant un être naturel seulement vivant et n'ayant qu'un sentiment de sa vie) par le fait qu'il porte non pas sur un objet réel, « positif », donné, mais sur un autre désir. »
On retrouve chez Freud cette analyse du désir, mais à l'intérieur d'une recherche scientifique qui veut nouer deux exigences : d'une part, mettre à jour les structures universelles qui organisent la relation entre l'individu et la société ; d'autre part, acquérir des instruments permettant d'étudier une culture dans sa particularité, ainsi que les procédures d'acculturation par lesquelles cette culture inscrit l'individu dans son ordre.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André AKOUN : professeur émérite, université de Paris-V-Sorbonne
Classification
Autres références
-
ADAPTATION - Adaptation sociale
- Écrit par Raymond BOUDON
- 2 258 mots
- 1 média
Le concept d'adaptation sociale va de pair avec celui d' intégration sociale. L'adaptation décrit les mécanismes par lesquels un individu se rend apte à appartenir à un groupe. L'intégration, ceux par lesquels le groupe admet un nouveau membre. L'adaptation insiste sur les changements...
-
ADLER MAX (1873-1937)
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 648 mots
Longtemps occulté par la prépondérance de l'idéologie bolchevique, le rôle de Max Adler, l'un des principaux représentants de l'austro-marxisme, s'éclaire d'une importance accrue à mesure qu'on redécouvre les tendances anti-autoritaires apparues dans l'évolution de la doctrine marxiste....
-
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
Par des voies multiples, Adorno parvient au même diagnosticquant à l'individu : en proie à une standardisation sans précédent, la société moderne procède à une liquidation du moi. Mais de par la souffrance qui l'affecte – le moment somatique –, de par le tourment qu'elle éprouve face... -
AGRESSION (psychologie sociale)
- Écrit par Laurent BÈGUE
- 902 mots
L’agression est définie comme un comportement qui vise à blesser intentionnellement un individu motivé à se soustraire à ce traitement. Les recherches conduites sur les formes et fonctions du comportement agressif ont mobilisé des méthodologies extrêmement variées (statistiques publiques judiciaires...
- Afficher les 151 références
Voir aussi