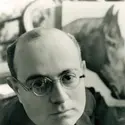INDIVIDU
Article modifié le
Biologie et collectivité : l'analogie
La métaphore biologique
La critique n'est pas à faire de la démarche hégélienne, si du moins par critique on entend réfutation systématique et scientifique ; mais on peut décrire les procédés de construction philosophique qui permettent à Hegel de faire de l'individuation le ressort d'une similitude entre une totalité organique et une totalité sociale. Cela ne lui est nullement spécifique. Il faudrait pouvoir citer intégralement l'analyse que Georges Canguilhem fait de l'utilisation des modèles sociaux en biologie : c'est la physiologie générale, et plus particulièrement l'usage qu'en fait Claude Bernard, qui règle les relations du tout et de la partie et rend possible l'expérimentation selon la théorie cellulaire. De ce point de vue, Hegel apparaît comme l'un de ces « premiers philosophes qui ont rêvé la théorie cellulaire », au moins en ce qui concerne les analogies réelles entre la façon dont il pense la matière et l'organisme et la façon dont il engendre la société. Canguilhem montre très clairement que la cellule transforme la partie de l'organisme, d'instrumentale qu'elle était dans les modèles technologiques aristotélicien ou cartésien, en individu. Du même coup, elle se trouve liée aux autres cellules par une relation d'intégration : « La physiologie générale, en ramenant à l'échelle de la cellule l'étude de toutes les fonctions, rend compte du fait que la structure de l'organisme total est subordonnée aux fonctions de la partie. Fait de cellules, l'organisme est fait pour les cellules, pour des parties qui sont elles-mêmes des touts de moindre complication. L'utilisation d'un modèle économique et politique a fourni aux biologistes du xixe siècle le moyen de comprendre ce que l'utilisation d'un modèle technologique n'avait pas permis auparavant. La relation des parties au tout est une relation d'intégration – et ce dernier concept a fait fortune en physiologie nerveuse – dont la fin est la partie, car la partie ce n'est plus désormais une pièce ou un instrument, c'est un individu. » On peut faire deux remarques encore à ce sujet. Tout d'abord, il faut constater la réversibilité des modèles et admettre que les modèles organiques retrouvent leur origine sociale par le détour de la métaphore de la naturalité ; ainsi le Parti communiste français a-t-il repris le terme de « cellule » pour qualifier l'élément de base de son organisation. L'utilisation est ici la même que dans la physiologie ; elle tend à lier les individus à l'élément central de façon organique, pour assurer une parfaite coordination des membres de ce tout : les cellules devaient d'abord s'appeler alvéoles, ce qui confirme le caractère « naturel » de l'analogie et de la métaphore. Une seconde remarque introduit à Leibniz : la cellule s'appelait antérieurement monade, note Canguilhem, qui ajoute : « L'influence indirecte mais réelle de la philosophie leibnizienne sur les premiers philosophes et biologistes romantiques qui ont rêvé la théorie cellulaire nous autorise à dire de la cellule ce que Leibniz dit de la monade, elle est pars totalis. Elle n'est pas un instrument, un outil, elle est un individu, un sujet de fonctions. »
C'est presque dans les mêmes termes que Leibniz lui-même définit la substance individuelle, ou plutôt la façon de construire cette notion : « La nature d'une substance individuelle ou d'un être complet est d'avoir une notion si accomplie qu'elle soit suffisante à comprendre et à en faire déduire tous les prédicats du sujet à qui cette notion est attribuée. » Il faut remarquer que l'individu n'est pas ici séparable de sa complétude : celle-ci relève de la totalité indéfinie de tous les possibles qui lui peuvent être attribués ; du même coup est engendrée la notion de la monade comme élément séparé, mais représentatif de tout l'univers. L'originalité de la conception leibnizienne est donc de lier l'individualité à la fois à l'isolement qui la constitue d'office et aux relations qui la définissent par rapport à toute totalité. C'est ainsi que Michel Serres peut écrire très justement que « l'individu est le profil de l'universel ».
L'individu comme loi de l'universel
Sur ce point, le saut conceptuel est fait : l'individu ne s'oppose pas à la collectivité, au groupe, mais à l'universel ; et, à dire vrai, il ne s'y oppose pas, il l'exprime – dans la mesure où l'expression introduit et la similitude et la distance. Certes, l'individu a quelque rapport à l'« universel » dans la pensée hégélienne : mais ce terme y prend une signification trop spécifique pour être retenue dans une mise en parallèle avec tout autre auteur et sans correction sémantique. Dans le système de Leibniz, on entendra universel au sens où ce terme se distingue du général qui caractérise une collection d'éléments, au sens où il ne souffre pas d'exception. Si l'individu exprime l'universel entendu selon cette signification, on comprend que Leibniz conçoive une jurisprudence à l'échelle de l'univers : tous ses projets philosophiques et éthiques se ressentent de cette idéologie universaliste. Ainsi veut-il traduire le Pater en toutes langues, créer une langue universelle, une grammaire rationnelle accessible à tous, écrire une Grande Encyclopédie. C'est qu'il pense, en ce point et par le filtre de l'individu, que la monade naît de la conjonction de l'universel, comme exigence normative sur tous les plans, et de l'infinie diversité ; cette conjonction se retrouve dans le principe de raison suffisante, qui réunit le principe de continuité – selon lequel les êtres s'organisent dans leur spécificité et sans qu'il y ait de faille dans la progression qui les unit – et le principe des « indiscernables », véritable principe d'individualité.
Reste l'individuation : c'est là qu'intervient la combinatoire, modèle mathématique pour la métaphysique leibnizienne. Le passage de la monade à tel ou tel état – la suite de ces états formant ce qu'on appelle communément un individu – se fait selon le principe du meilleur, qui rassemble les possibles pouvant coexister. L'individu est donc toujours dans l'état le meilleur, compte tenu des possibles dont son destin était gros ; on voit par là comment s'agence la théodicée et comment s'annule l'idée de mal. Il ne saurait exister de différence entre le destin des parties et celui du tout ; donc, rien n'est sacrifié. C'est si vrai que les états défavorables ou crépusculaires, tels le sommeil ou la mort, sont décrits comme des involutions dans la succession monadique ; l'accident fait partie de la norme, et l'individu fait la loi.
C'est ce dernier point qui permet à Michel Serres de renverser la problématique habituelle à la détermination de l'individu, et dont on a vu un modèle parfait avec la systématique hégélienne : au lieu que l'individu soit l'élément particulier d'une totalité donnée au principe comme fondamentale et causale, Leibniz part de l'individu pour déduire l'ensemble des cas dont il relève. Cet ensemble constitue une série, et l'ensemble des séries peut légitimement être appelé Dieu, un dieu mathématicien qui calcule : Dum Deus calculat et cogitationem exercet, fit mundus... « Il faut dire un mot, écrit Serres, de l'échantillonnage comme tel et indiquer, tout d'abord, qu'il s'agit là d'une traduction méthodique de ce point de doctrine qu'on pourrait nommer la philosophie pluraliste de l'exemple... L'exemple, chez lui, c'est l'individu ; non l'individué scolastiquement défini, mais l'individu historique, dénommé, existant et charnel, ici et maintenant. L'individu, existant et connaissant, enveloppe la caractéristique inscrite en lui. Ainsi est-il une table. » Table d'individus, le système de Leibniz regorge de ces exemples mythiques où s'exerce une imagination métaphysique : Alexandre défini par son heccéité alexandrine ; Sextus Tarquin à qui un malicieux caprice du philosophe fait visiter tous ses destins possibles jusqu'à ce qu'il convienne que le sien, non encore accompli pourtant, est le meilleur qui soit pour son individualité, puisqu'elle est déterminée par là même ; César devant le petit fleuve symbole des faux choix ; tous paradigmatiques, mais d'eux-mêmes. Rien ne peut mieux poser et mettre en question l'individualité que ce système où l'individu est exemplaire et cependant irréductible.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Catherine CLÉMENT : ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de l'Université
Classification
Autres références
-
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
...universalité non violente qui sache faire droit à la différenciation ? Soucieux de donner au non-identique réparation de la violence que le sujet lui a faite, Adorno revient sur le rejet hégélien de l'individu, « trop petit en face du général », et ouvre du même coup la possibilité d'une rencontre entre... -
CONSENSUS
- Écrit par André AKOUN
- 2 724 mots
Il n'en va pas de même lorsque la société est divisée et que surgit en son seinune nouvelle catégorie socio-historique : l'individu. C'est cette société que Durkheim caractérise comme société de la solidarité organique et qui comporte le risque d'une anomie dissolvante parce que, encourageant l'individu... -
CRAINTE ET TREMBLEMENT, Søren Kierkegaard - Fiche de lecture
- Écrit par Francis WYBRANDS
- 802 mots
- 1 média
...institutions comme seule mesure de ce qui nous fait homme et homme singulier, tel est le thème qui aiguillonnera toute la recherche passionnée du penseur. Le rapport à l'absolu ne souffre aucun compromis avec les exigences du monde ; souffrance et paradoxe, traversée de l'absurde seront donc le prix... -
ÉCONOMIE (Histoire de la pensée économique) - Économie des conventions
- Écrit par Philippe BATIFOULIER
- 1 525 mots
...dans la situation. Comme il n'y a pas qu'une seule façon de juger mais plusieurs, on ne peut plus se contenter d'une définition univoque et réductrice de l'individu, cantonné à un statut de calculateur opportuniste. Cette conception de l'individu, développée par les approches standards en économie... - Afficher les 31 références
Voir aussi