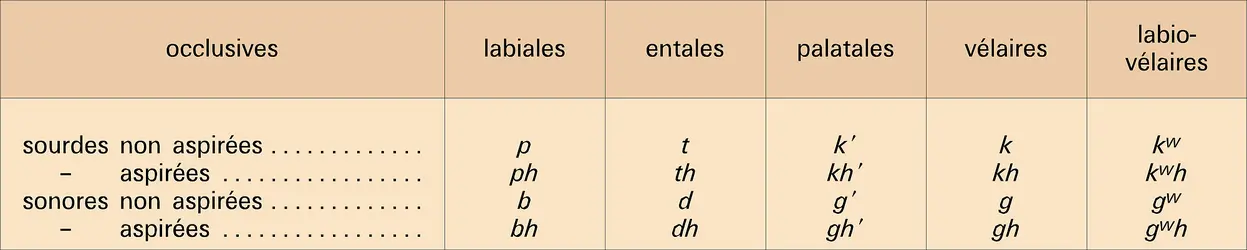- 1. Premiers travaux
- 2. Les langues de départ
- 3. Les difficultés dues aux langues celtiques
- 4. Saussure et la théorie laryngaliste
- 5. Le tokharien et le hittite
- 6. Phonétique et phonologie
- 7. Principaux caractères morphologiques et syntaxiques
- 8. Nouveaux procédés d'analyse et de comparaison
- 9. Bibliographie
INDO-EUROPÉEN
Article modifié le
Principaux caractères morphologiques et syntaxiques
Le caractère essentiel de la morphologie consistait en un système flexionnel très riche – où les mots étaient fléchis, à l'exception des mots-outils, invariables – et en une distinction précise entre le verbe et le nom. Chaque mot indo-européen fléchi se composait d'au moins deux morphèmes : la racine et la désinence. Entre ces éléments pouvaient se greffer un ou plusieurs suffixes. Chacun de ces morphèmes se présentait sous une des formes suivantes : avec une voyelle *ě, c'est-à-dire au degré plein ou normal, avec une voyelle *ǒ, forme appelée au degré fléchi ou sans voyelle, d'où le nom de degré zéro. On distingue en outre un degré plein allongé (*ē) et un degré fléchi allongé (*ō). Ces variations vocaliques quantitatives et qualitatives portent le nom d'alternances. Nombre de ces alternances se retrouvent dans des langues historiques, ainsi dans le grec ancien πέιθ-ομαι, « je crois », degré plein, π́ε-ποιθ-α, au degré fléchi et ̂επ́ε-πιθ-μεν au degré zéro.
La désinence, morphème terminal, était exprimée matériellement ou non ; dans ce dernier cas, on parle de désinence zéro. C'est ce morphème qui indiquait le rôle du mot dans la proposition, bien plus que la place, qui n'avait le plus souvent qu'une valeur stylistique, à l'exception toutefois de la position en tête de phrase réservée à un mot accentogène et de la seconde place où se trouvaient de préférence les clitiques. Si l'on compare l'indo-européen à des langues agglutinantes, on constate que les désinences cumulent plusieurs fonctions, ce qui est encore le cas dans les langues de cette famille qui ont conservé un système flexionnel à l'époque historique. Ainsi, le -ă de latin lupă indique à la fois qu'il s'agit d'un féminin, d'un singulier et d'un nominatif-vocatif ; il en est de même pour le système verbal où *eimi signifie l'idée d'« aller », appliquée, de manière durative et présente, à une première personne du singulier.
L'indo-européen connaissait huit cas : nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, locatif, ablatif, instrumental ; trois nombres : singulier, duel, pluriel ; et trois genres grammaticaux : neutre, masculin, féminin, évolution d'une étape antérieure où l'animé s'opposait à l'inanimé. Le système flexionnel verbal est aussi riche, bien que, dans les formes personnelles, il n'y ait pas de distinction de genres comme c'est le cas par exemple en sémitique ; par contre, il comportait également trois nombres et trois personnes. L'opposition temporelle se marquait par l'usage de désinences différenciées : pour le présent, on utilisait les désinences primaires ; pour le passé, les désinences secondaires. Si l'action verbale s'accomplissait hors du sujet et que ce dernier ne se sentait pas directement concerné par celle-ci, on employait l'actif, dans le cas inverse le moyen ; c'est ce qu'on appelle la diathèse, qui était marquée explicitement par des désinences particulières. D'autre part, le sujet parlant pouvait envisager le procès soit comme se déroulant réellement, soit comme une réalité dont on attend ou dont on veut la réalisation, soit enfin comme une chose qui est simplement possible même si on la souhaite. Ces trois modalités étaient exprimées de manière morphologique, respectivement au mode indicatif, au subjonctif et à l'optatif. Enfin, il existait différents aspects – duratif, aoristique, perfectif, désidératif et causatif – marqués par des modifications morphologiques ou par des distinctions lexicales. Ainsi, le verbe « être » était rendu par la racine *es- au duratif et au perfectif, tandis qu'à l'aoriste on utilisait le thème *bhewə-. Par contre, le même thème *leik w, « laisser », servait au duratif sous la forme *léikw-e-, et sous la forme *likw-é- à l'aoriste.
Les suffixes étaient très nombreux en indo-européen, et la formation des mots par dérivation un procédé courant. Cependant l'analyse formelle et sémantique de ces morphèmes demeure une des grandes questions laissées sans réponse. Certains suffixes, simples ou complexes, sont d'analyse relativement aisée ; par exemple on distingue un suffixe *-men- formant des noms d'action neutres ou masculins, un suffixe *-went- avec le sens de « pourvu de », un suffixe *-ter- ou *-tel-, d'après les langues, formant des noms d'agent, etc. L'analyse formelle devient très facile si l'on suit Benveniste, pour qui tout suffixe se compose de la voyelle alternante *ě suivie d'un phonème consonantique, d'où il découle qu'un suffixe *-ter- doit en réalité être analysé en suffixe *-et- au degré zéro, soit *-t-+ suffixe *-er-au degré plein, c'est-à-dire *t + *er > *-ter-. Une telle analyse, pour séduisante qu'elle demeure, ne s'appuie néanmoins sur aucun argument sémantique et reste donc arbitraire.
Le noyau du mot est constitué par la racine. La majorité de ces dernières sont construites sur le schéma C1 ě C2, où C1 et C2 représentent des phonèmes consonantiques ou sonantiques. Il subsistait toutefois un certain nombre de racines présentant deux particularités : elles échappaient au jeu normal des alternances vocaliques et semblaient déficientes du fait de l'absence apparente d'un des deux phonèmes consonantiques. Grâce aux hypothèses de Saussure et à la découverte du hittite, quelques auteurs, dont É. Benveniste et J. Kuryłowicz, purent proposer une théorie ramenant au même schéma ces racines qui paraissaient s'en écarter. Ainsi la racine *ed-« manger » est reconstruite en *ə1ed-, *ə1od, *ə2d-, représentant respectivement le degré plein, le degré fléchi et le degré zéro à une époque antérieure. La laryngale, notée conventionnellement *ə1, se serait amuïe devant une voyelle et aurait modifié, le cas échéant, le timbre de cette voyelle, d'où le passage de *o à *e, tandis qu'au degré zéro la même laryngale se serait vocalisée en *e. Ces règles permettent de ramener ce type de racine au schéma classique tout en expliquant leur structure particulière et l'absence d'alternance vocalique.
Néanmoins, ces dernières années, l'application systématique de ces règles de reconstruction morphologique a été remise en cause. Il apparaît en effet que le recours à un seul schéma radical reconstruit entraînerait des conséquences inadmissibles pour la protolangue, si du moins on attribue à cette dernière les propriétés des langues attestées.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Guy JUCQUOIS : docteur en philosophie et lettres, professeur ordinaire à l'université de Louvain
Classification
Média
Autres références
-
INDO-EUROPÉENS (archéologie)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 5 146 mots
- 1 média
À partir du début du xixe siècle, la plupart des linguistes ont expliqué les ressemblances entre les différentes langues indo-européennes par l'existence d'une langue unique préhistorique (Ursprache en allemand), existence qui impliquait elle-même la présence d'un peuple la parlant...
-
ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Langue
- Écrit par Paul VALENTIN
- 4 345 mots
- 3 médias
...: les occupants antérieurs, de qui nous ne savons rien, sinon qu'ils étaient agriculteurs, et des conquérants venus, peut-être, du sud-est de l'Europe. Ces derniers avaient imposé leur langue, issue de l'aire dialectale indo-européenne, c'est-à-dire ressemblant par un certain nombre de traits au latin,... -
ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Langue
- Écrit par Guy Jean FORGUE et Hans KURATH
- 6 360 mots
- 3 médias
L'anglais est une langue germanique qui, par sa structure, appartient à la catégorie des langues indo-européennes. Il est étroitement apparenté au frison, au hollandais, au bas allemand qui, avec le haut allemand, constituent le groupe occidental des langues germaniques.
Importé dans les...
-
ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 678 mots
- 2 médias
À un niveau plus large encore, la science allemande s'est illustrée, durant tout le xixe siècle, dans la définition et le traitement du problème « indo-européen » (en allemand, indo-germanisch). La reconnaissance, au début du xixe siècle, d'une parenté linguistique entre la plupart... -
ARYENS
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 1 028 mots
Francisé en « aryen », le terme sanskrit ārya (avestique, airya) signifie « excellent, honorable, noble ». Ainsi se désignent, avec la morgue coutumière des conquérants, les populations de langue indo-européenne qui, vers la fin du IIIe millénaire avant l'ère chrétienne,...
- Afficher les 28 références
Voir aussi
- INDO-EUROPÉENS, peuple
- ALBANAIS, langue
- FAMILLE LINGUISTIQUE
- PROTOLANGUE
- ANATOLIENNES LANGUES
- SONANTE CONSONNE
- IRLANDAISES LANGUE & LITTÉRATURE
- SEMI-VOYELLE
- OSSÈTES LANGUE & LITTÉRATURE
- PERSAN, langue
- VOYELLE
- CONSONNE
- GLOTTALES CONSONNES
- LARYNGALES CONSONNES
- LANGUES ÉVOLUTION DES
- PHONÉTIQUE HISTORIQUE
- LATINE LANGUE
- GREC ANCIEN, langue
- GERMANIQUES LANGUES
- RACINE, linguistique
- ARMÉNIEN, langue
- CELTIQUES LANGUES
- AKKADIEN ou ACCADIEN, langue
- VERBAL SYSTÈME, linguistique
- PROCÈS, linguistique
- GRAMMAIRE COMPARÉE
- GAÉLIQUES ou GOÏDÉLIQUES LANGUES
- INDO-ARYENNES LANGUES ET LITTÉRATURES
- SLAVES LANGUES
- TOKHARIEN
- BALTES LANGUES
- SANSKRITE ou SANSCRITE LANGUE
- INDO-IRANIENNES LANGUES
- ITALIQUES LANGUES
- HITTITE, langue
- IRANIENNES LANGUES