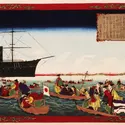MILITAIRE INDUSTRIE
Article modifié le
Si on peut sans peine repérer les prémices de l'industrie militaire avec les débuts des manufactures de l'époque moderne, au xvie siècle, c'est surtout à l'ère industrielle, au xixe siècle, qu'elle prend une réelle ampleur au sein même des grandes puissances occidentales. Les impératifs de défense, portés par les notions de préservation des institutions et du territoire national, combinés aux intérêts économiques et aux ambitions géostratégiques, ont déterminé sa consolidation. Ces industries reflètent donc, pour une grande part, les conceptions de défense des États, au regard de la situation internationale et des orientations données en matière de politique étrangère. Ainsi, un gouvernement, inscrit dans une logique de guerre expansionniste, puis totale, comme l'Allemagne du IIIe Reich, a-t-il misé sur le dynamisme extrême d'une industrie militaire surdimensionnée, le plus souvent d'ailleurs aux dépens d'autres secteurs économiques. Qu'elle soit légitimée par certains économistes comme Keynes pour son rôle dans la relance et l'accroissement de la consommation, ou blâmée par d'autres, notamment dans les années 1970 et 1980, par son absorption de fonds qui pourraient être consacrés aux secteurs de la santé ou de l'éducation, l'industrie militaire est une pièce maîtresse sur le plan de la stricte nécessité d'une politique de défense pour l'État.
Il s'agira donc, ici, de relater le développement du concept d'industrie militaire et, par ce biais, de faire apparaître ses liens intrinsèques avec les logiques de défense et de prévention, de dissuasion et de coercition. Le secteur de l'industrie militaire témoigne d'une perpétuelle mutation, au gré des évolutions technologiques. Tributaire des budgets alloués aux politiques de défense de chaque État, il revêt une dimension économique et financière certaine en raison des liens avérés qu'il entretient avec les pouvoirs en place. On comprend ainsi les connexions qui peuvent être établies entre pouvoir politique et lobbies de l'industrie de l'armement.
Le reflet d'un potentiel de puissance
L'intégration dans le concept de défense
L'idée même d'un potentiel de puissance militaire n'est pas récente. Elle est omniprésente depuis plusieurs siècles, à des degrés divers. Les États, au fur et à mesure qu'ils forgent et ancrent leur influence, doivent nécessairement disposer d'une industrie militaire ; une industrie qui s'est peu à peu élaborée avec la « manufacturisation » du travail puis la production de pièces standardisées. Des mutations conceptuelles qui ont ensuite bénéficié d'une division du travail propice à un accroissement conséquent de la productivité. Au xxe siècle, l'industrie militaire s'est largement complexifiée avec l'adoption d'un large panel de systèmes d'armes, des plus conventionnelles aux plus sophistiquées, englobant notamment le nucléaire, les secteurs chimiques et bactériologiques.
Toute la période de la guerre froide est illustrée par des processus de militarisation extensifs autant qu'intensifs, qui ont alimenté une course aux armements effrénée. Il fallut attendre les étapes d'un certain dégel entre l'U.R.S.S. et les États-Unis pour que des accords soient adoptés (négociations et accords S.A.L.T. (Strategic Arms Limitation Talks ; 1969-1972), S.A.L.T. II (juin 1979) – bien que jamais entré en vigueur –, S.T.A.R.T. (Strategic Arms Reduction Treaty ; signé en 1991 et ratifié en 1993).
Avec la fin de l'ère soviétique, l'idée que la paix semblait à nouveau de mise gagna les capitales occidentales. Les politiques de défense optèrent alors pour des baisses budgétaires et un ralentissement – certes relatif – de la production d'armes. Le début des années 1990 a vu en effet les dépenses mondiales en politiques de défense et d'armement passer au-dessous de la barre des 1 000 milliards de dollars. Pour autant, il serait illusoire de croire que le nombre de crises et conflits, même de portée limitée – conflits de faible ou basse intensité –, se sont faits moins fréquents. Depuis 1945, on dénombre près de 200 conflits intra-étatiques, dont plus de la moitié ont éclaté depuis 1989. Ce qui permet de dresser une moyenne de deux à trois nouveaux conflits chaque année entre 1945 et 1989, contre une moyenne annuelle de sept depuis 1989.
Le début du xxie siècle est dominé par la logique d'hyperpuissance américaine. Les relations internationales sont encore déterminées principalement par les puissances occidentales, avec désormais comme première préoccupation la lutte contre le terrorisme. Ces puissances, et les États-Unis en particulier, ont donc élaboré des politiques de sécurité intérieure nécessitant à la fois des effectifs mais aussi des facteurs technologiques permettant une meilleure sécurisation de leur territoire, avec l'idée sous-jacente – véritable obsession aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001 – de garantir la « sanctuarisation » du territoire national. Qu'elle soit intégrée dans un maillage industriel privé, public ou mixte, l'industrie de défense dépend inévitablement du budget qui lui est alloué par les pouvoirs publics, en fonction des orientations annuelles validées par le pouvoir législatif.
Une nouvelle phase s'est donc ouverte pour l'industrie militaire, dans un contexte de lutte contre un terrorisme polymorphe, à l'instar des organisations terroristes islamistes, se réclamant ou non de la nébuleuse Al-Qaida. Les moyens militaires ou paramilitaires s'inscrivent dans une typologie présentant quatre ensembles, outre les moyens conventionnels : les moyens de nature nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (N.R.B.C.). Certes, leur maîtrise n'est pas à la portée de tous les États. Mais l'acquisition des techniques et la maîtrise des précautions d'emploi de telles armes restent l'objectif de nombre de pays dits émergents.
Le poids du complexe militaro-industriel
Le terme « complexe » a été proposé pour traduire, et parfois dénoncer, les multiples passerelles et correspondances établies entre certains postes de hauts responsables militaires et ceux occupés dans les grandes firmes de production d'armes. Mais le concept de complexe militaro-industriel repose aussi sur les véritables synergies qui existent entre acteurs publics et privés, laboratoires civils et militaires, pôles de réflexion et de recherche stratégique, et entreprises de production et de vente. Aux États-Unis, outre les entreprises les plus liées au Department of Defense (DoD) – Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, BAE Systems, United Technologies Corporation, L-3 Communications, Computer Sciences Corporation –, on pense évidemment à d'autres sociétés focalisées sur l'aéronautique et l'espace (McDonnell Douglas, Lockheed Aircraft, Northrop), mais aussi à celles qui sont spécialisées dans les systèmes électroniques et missiliers (Hughes Aircraft, Raytheon et Martin Marietta, Loral, Westinghouse, Unisys, Texas Instruments...), dont les activités sont concentrées en Californie, au Texas et en Floride.
Le complexe militaro-industriel est donc bien réel. Aux États-Unis, son imbrication avec les milieux politiques, renforcée de ce qu'on appelle communément les think tanks (« groupes de réflexion »), remonte aux années 1960. Face aux lobbies de poids du complexe militaro-industriel, la présidence est effectivement tenue de répondre aux attentes de réseaux d'influence qui, en bien des cas, ont financé les campagnes électorales. Le général Dwight Eisenhower (1890-1969), président des États-Unis de 1952 à 1960, fut le premier responsable politique à mettre en garde contre l'influence démesurée du complexe militaro-industriel sur le pouvoir exécutif, à l'occasion du discours prononcé le 29 janvier 1961 pour la fin de son mandat présidentiel. Plus récemment, le vice-président Richard Cheney, en poste de 2001 à 2008, fut le symbole de cette collusion entre l'exécutif, le lobby pétrolier et le complexe militaro-industriel.
En France, la politique de dissuasion nucléaire voulue et mise en place par le général de Gaulle a contribué tout autant à l'édification d'un nouveau complexe militaro-industriel, puisque le nucléaire militaire devait se décliner pour satisfaire les trois armées (Terre, Air, Marine), d'où la mise au point de moyens militaires considérables. Quoique plus discret dans l'Hexagone qu'aux États-Unis ou en Russie, le complexe français entretient lui aussi de solides réseaux d'influence, nombre de généraux ou d'officiers supérieurs, une fois à la retraite, basculant dans les groupes de l'industrie diversifiée de l'armement et de ses dérivés (E.A.D.S., Thales...), avec comme interlocuteur officiel la Délégation générale pour l'armement (D.G.A.), maître d'ouvrage des programmes d'armement français. Responsable de la conception, de l'acquisition et de l'évaluation des systèmes d'armes, la D.G.A. conduisait 80 programmes d'armement en 2007 et assurait près de 10 milliards d'euros de commandes annuelles à l'industrie spécialisée. Premier investisseur de l'État français, elle est le premier acteur de la recherche de défense en Europe, soit 35 p. 100 des capacités européennes de recherche et technologie de défense avec plus de 700 millions d'euros de contrats d'études notifiés chaque année. La D.G.A. promeut ainsi un volume de contrats qui représente officiellement plus de 60 p. 100 de l'activité de l'industrie française de l'armement, en favorisant le partenariat entre les secteurs public et privé, sans négliger pour autant les programmes d'armement en coopération européenne qui représentent 25 p. 100 de ses engagements. Forte de 18 100 agents, la D.G.A. dispose de 26 centres en France et compte des représentants dans vingt pays.
Par ses liens soigneusement tissés et entretenus avec la haute administration et les ministères, le complexe militaro-industriel préserve sa suprématie par le lancement et le financement de programmes qui répondent au besoin de commandes desdites industries. Mais il n'en demeure pas moins que lesdites commandes sont liées, dans le cas français notamment et européen en général, à des impératifs répondant rigoureusement aux besoins de défense ; besoins qui, compte tenu de la perpétuelle évolution des menaces, doivent être sans cesse adaptés.
Par ailleurs, les demandes à l'exportation font que l'influence des différents complexes militaro-industriels dépassent allègrement les frontières nationales, au point même de se lancer dans une concurrence effrénée. Ainsi, paradoxalement, alors que les pays occidentaux s'inscrivent dans une même logique de politique internationale, via notamment l'O.T.A.N., la concurrence reste entière en matière de conquête de marchés à l'étranger. Elle s'observe ainsi auprès de divers pays du continent africain, et notamment au Maghreb. Les politiques d'armement et d'équipement du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye sont au cœur de vives joutes internationales pour la signature de contrats aux enjeux économiques et financiers considérables. De même, les pays du Moyen-Orient – précisément les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite – constituent des partenaires et clients que chacun tente de s'approprier. L'Irak fut ainsi un partenaire de choix pour la France dans les années 1970 et 1980, mais aussi pour les États-Unis. Les industries et la défense américaines s'inscrivent donc toujours comme concurrentes de leurs homologues européennes, elles-mêmes trop divisées. Il manque en effet une réelle Europe de la défense qui soit prolongée par une politique d'industrie militaire homogène. Il y a le plus souvent des réalisations de partenariat simple, comme en témoigne, la longue – et fastidieuse – réalisation du Tigre d'Eurocopter (EC-665), hélicoptère de combat franco-allemand. Le programme est officialisé en 1987, le premier prototype ne vole qu'au milieu de l'année 1991, pour n'être conçu en série qu'à partir du printemps de 2002. Le premier Tigre ne fut livré à l'École franco-allemande de l'aviation légère de l'armée de terre (A.L.A.T). qu'en avril 2005, pour n'être soumis à une expérimentation opérationnelle qu'en 2007.
D'où les espoirs placés dans l'Agence européenne de défense (A.E.D.) créée en juillet 2004, instrument de la politique étrangère et de sécurité commune (P.E.S.C.), qui a pour mission de favoriser le développement des capacités militaires de l'Union européenne et d'accélérer, de la sorte, la mise en place d'une politique européenne de sécurité et de défense (P.E.S.D.), composante militaire de la P.E.S.C. Le but étant aussi de faire émerger un véritable marché européen de l'armement afin de limiter la part des importations en équipements de défense qui, en Europe, étaient encore de 30 p. 100 en 2005.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pascal LE PAUTREMAT : docteur en histoire, enseignant en histoire et géographie, en géopolitique et défense intérieure
Classification
Autres références
-
JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire
- Écrit par Paul AKAMATSU , Vadime ELISSEEFF , Encyclopædia Universalis , Valérie NIQUET et Céline PAJON
- 44 411 mots
- 52 médias
...renforçant la surveillance des activités maritimes et aériennes de la Chine et d’y répondre, le cas échéant. Dans cette perspective, Tōkyō fait l’acquisition d’avions de chasse et de patrouille, de nouveaux sous-marins et d’énormes destroyers porte-aéronefs, de radars et drones, tout en développant une... -
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- Écrit par Pierre PAPON
- 9 229 mots
- 6 médias
...comme la France ont donc mis en œuvre des programmes de recherche dans les secteurs du nucléaire, de l'industrie aérospatiale, des télécommunications. La dimension militaire de cet enjeu stratégique est évidemment essentielle, la défense d'un État moderne reposant de plus en plus sur des techniques...
Voir aussi
- RUSSIE FÉDÉRATION DE
- FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
- DISSUASION NUCLÉAIRE
- AÉROSPATIALE INDUSTRIE
- AÉRONAUTIQUE INDUSTRIE
- POUVOIR POLITIQUE
- GUERRE CIVILE
- RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
- NAVIGATION PAR SATELLITE SYSTÈMES DE
- EUROPE, politique et économie
- MILITAIRES ÉQUIPEMENTS
- CHINE, économie
- NAVIRES DE GUERRE
- MILITARO-INDUSTRIEL COMPLEXE
- DGA (Délégation générale pour l'armement)
- AED (Agence européenne de défense)
- TRAFIC D'ARMES
- EXPORTATIONS
- DÉPENSES PUBLIQUES
- FRANCE, économie
- FRANCE, droit et institutions
- SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie
- URSS, vie politique et économique
- DÉFENSE ÉCONOMIE DE LA
- MISSILES BALISTIQUES
- DASSAULT
- SATELLITES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
- TECHNOLOGIE SPATIALE
- COOPÉRATION INTERNATIONALE, espace
- SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE
- SATELLITES DE NAVIGATION ET DE POSITIONNEMENT
- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
- ROUTES MARITIMES
- COMMERCE DES ARMES
- NAVIGATION SYSTÈMES DE
- SATELLITES MILITAIRES