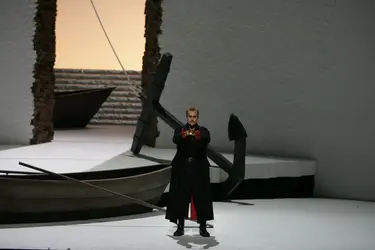- 1. Grandeur et décadence du cinéma muet italien (1896-1929)
- 2. Le cinéma italien pendant l'époque fasciste (1922-1945)
- 3. Le néo-réalisme et les années d'après-guerre (1945-1959)
- 4. L'âge d'or du cinéma italien (1960-1980)
- 5. Le temps présent, entre mémoire et oubli
- 6. Un cinéma dans l’expectative
- 7. Bibliographie
ITALIE Le cinéma
Article modifié le
Le temps présent, entre mémoire et oubli
Au cours des décennies de 1980 et 1990, le cinéma italien a connu une phase aiguë de déclin suivie d'une nette reprise à partir des années 2000. Peu à peu s'était installée l'idée d'une cinématographie affaiblie et dont le renouvellement ne se faisait pas. Il est vrai qu'au répertoire des auteurs incontestés on ne peut noter qu'une seule révélation, celle de Nanni Moretti à partir de 1976, avec la surprise que constitua Io sono un autarchico (Je suis un autarcique), film à tout petit budget tourné en super-8. Moretti allait par la suite confirmer l'originalité de son talent (Palombella rossa, 1989 ; Caro diario[Journal intime], 1994), remportant la palme d'or au festival de Cannes en 2001 avec La stanza del figlio (La Chambre du fils) et devenant une figure emblématique de la résistance au berlusconisme (Il caimano[Le Caïman], 2006). À ses côtés, Gianni Amelio apparaît comme l'autre figure dominante du cinéma italien (Così ridevano[Mon frère]– Lion d'or à Venise –, 1998 ; Le chiavi di casa[Les Clefs de la maison], 2004 ; La stella che non c'è[L'Étoile imaginaire], 2006 ; Le Premier Homme, 2011).
Du point de vue quantitatif, le cinéma italien ne s'est jamais effondré. Si jusqu'en 1976 il se tournait plus de deux cents films par an, la baisse n'a pas dépassé le seuil d'une centaine de films. Depuis le début des années 2000, on assiste à une consolidation économique et à une reprise qualitative qui se traduit par la confirmation d'anciens talents (Ermanno Olmi, Marco Bellocchio) et par l'émergence de jeunes cinéastes qui n'hésitent pas à affronter les maux de la société italienne. Signe tangible de cette nouvelle vigueur, les prix du jury remportés au festival de Cannes en 2008 par Matteo Garrone (Gomorra, d'après le livre de Roberto Saviano) et Paolo Sorrentino (Il divo, portrait sans fard d'un « monument » de l'histoire politique italienne, Giulio Andreotti). De fait, beaucoup de cinéastes se présentent comme les héritiers lointains d'un néoréalisme auquel ils continuent à se référer, tout comme au cinéma politique des années 1960. Ainsi, dans le droit fil des œuvres de Francesco Rosi ou d'Elio Petri, subsiste en Italie une forte tendance à un cinéma de témoignage socio-politique. Le pays a toujours offert un terrain d'observation exceptionnel, à la mesure de l'ampleur des difficultés auxquelles il était confronté : instabilité gouvernementale récurrente, stratégie de la tension à partir de la fin des années 1960, clientélisme et malversation, auxquels sont venus s'ajouter la dérive autoritaire du berlusconisme, la xénophobie et la volonté de partition de la Ligue du Nord, l'affaiblissement d'une gauche divisée. À ces maux, il faut ajouter la puissance de la mafia – dont on découvre qu'elle pousse ses ramifications jusqu'au sein même de l'appareil d'État –, et la corruption née de l'imbrication entre milieux politiques, économiques et financiers. L'omniprésence de la criminalité organisée a fourni au cinéma un grand nombre de sujets pour des films tournés à Naples, Palerme ou Bari (Tano da morire, 1997, de Roberta Torre ; I cento passi, 2000, de Marco Tullio Giordana ; Le conseguenze dell'amore, 2004, de Paolo Sorrentino ; Galantuomini, 2008, d'Edoardo Winspeare ; La siciliana ribelle, 2009, de Marco Amenta ; Fortapàsc, 2009, de Marco Risi).
C'est à partir de 2003 que s'est manifestée la nette reprise du discours sur la société italienne : avec La meglio gioventù (Nos Meilleures Années), Marco Tullio Giordana présente l'histoire récente du pays, comme l'avait fait avant lui Dino Risi avec Une vie difficile ou Ettore Scola avec Nous nous sommes tant aimés. D'autres[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean A. GILI : professeur émérite, université professeur émérite, université Paris I-Panthéon Sorbonne
Classification
Médias