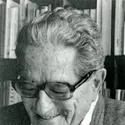JEU Jeu et rationalité
Article modifié le
La théorie « globale » et les apories rationalistes
Le « réel » et l'« imaginaire »
À travers leur critique de la conception rationaliste du jeu, conception où s'opposent jeu et sérieux, loisir et travail, jeu et réel, etc., les tenants de la théorie « globale » du jeu prétendent faire la critique de tout dualisme dans les différents champs des études anthropologiques. Celui qu'ils attaquent le plus directement à travers leur théorie du jeu, c'est le dualisme qui consiste – en littérature, dans les arts, en politique, en histoire – à opposer le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire à prétendre qu'il existe une réalité objective indépendante de l'interprétation dont les hommes la colorent selon les vœux – inconscients, bien entendu – de la culture à laquelle ils appartiennent. Ainsi, on a pu dire (J. Derrida, S. Moscovici) qu'il n'existe pas une nature qui serait universellement la même dans le temps et l'espace, mais que cette nature change, qu'elle n'est pas la même d'une culture à l'autre. Parler de « réalisme » serait donc un non-sens, car il n'y a jamais un réel dont on s'écarterait plus ou moins. Tout réel est imprégné d'imaginaire. Aucun phénomène anthropologique ne saurait alors être interprété comme un signifiant-imaginaire flottant, variable, qui coïnciderait plus ou moins fidèlement avec un signifiant-réel, fixe et stable.
Dans le cas de l'étude d'une œuvre d'art, par exemple, qui se veut fondée anthropologiquement, le travail critique ne consiste donc pas à mesurer et à noter le prétendu écart, ou la prétendue déviation, entre l'œuvre, prise comme « morceau d'imaginaire », et le « réel » (la réalité psychologique, sociologique, historique ou autre) à partir duquel ladite œuvre aurait été produite. Une telle mesure permettrait au critique de se prononcer sur le degré de réalisme, d'irréalisme, de fantastique, de grotesque, de naturalisme, qui affecte cette œuvre. En fait, il n'en est rien, puisque le réel n'est pas ce fond neutre et objectif sur lequel se détacherait et se mesurerait l'imaginaire, pas plus que le gratuit ne se mesure par rapport à l'utile, étant donné que l'un ne vient pas avant l'autre. L'imaginaire n'est pas un superflu noble, c'est-à-dire l'inessentiel essentiel qui sauve l'homme de la bestialité, le gratuit qui « rachète » l'homme et le civilise. L'imaginaire est la condition même de toute civilisation, primitive ou industrielle.
Ainsi, puisque toute réalité est prise dans le jeu imaginaire des concepts qui servent à la nommer et à l'expliquer, cet autre dualisme subjectivité/objectivité est inopérant dans toute étude anthropologique. En effet, l'observateur ne saurait atteindre à une objectivité totale, car il reste, à un degré ou un autre, prisonnier de sa propre culture, de ses propres mythes. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il reste entièrement subjectif. C'est ce mouvement de bascule entre subjectivité et objectivité que Claude Lévi-Strauss nous a appris à reconnaître (voir l'ouverture des Mythologiques) et qui fait que, dans l'étude des hommes, de leurs comportements, de leurs croyances, de leurs actions, il existe toujours une part d'incertitude interprétative, une part de jeu (au sens où l'on dit qu'une porte « joue ») qui ne saurait être comblée ou supprimée pour la simple raison qu'il s'agit là d'une entreprise de communication, et que dans toute communication, que ce soit entre individus ou entre groupes, il existe une part de malentendu, une part de jeu.
Pour donner au jeu son plein sens, ceux qui voient dans le jeu la condition par excellence de toute culture, de toute humanité, le définissent de la façon la plus large possible : « il y a du jeu ; ça joue », disent-ils. Le jeu n'a pas de sujet. Ou, si l'on veut, le vrai sujet du jeu, c'est le hasard ; hasard cosmique, hasard biologique. Le jeu s'exprime par le chaos et la possibilité de l'organiser.
Le jeu de la communication
Pour ce qui est des hommes – et qu'il s'agisse du jeu solitaire, du jeu à deux, à plusieurs, ou en masse –, l'objet du jeu, c'est le sujet, toujours ailleurs, toujours fuyant. Il serait faux de voir ici une dialectique entre le Sujet et l'Autre qui seraient autonomes. Dans le jeu stratégique de la communication, chaque sujet change de rôle avec ses interlocuteurs : je, tu, il, se renvoient l'un à l'autre, sans fin. Le sujet est donc composé-décomposé. Comme il est pris dans le mouvement centripète-centrifuge, sa voix lui vient (et lui revient) toujours d'ailleurs. Il est à lui-même son propre enjeu.
Le jeu est communication et la communication jeu : à la fois rapport, passage, échange, transfert et ce qui est rapporté, passé, échangé, transféré. Ainsi, la possibilité du jeu et de la communication de deux ou plusieurs éléments liés et pourtant distincts – « et », « ou » et leurs contraires « ni... ni » – offre l'alternative aléatoire nécessaire au jeu ; ces conjonctions marquent l'articulation par où se glisse le hasard, et les lois de la communication. La circulation des biens, des personnes, du langage y sont soumis. Le jeu ne saurait donc se laisser circonscrire à un type particulier d'activité. Il n'est pas non plus un mode particulier d'appréhension du « réel », puisqu'il est une nature, notre nature. En d'autres termes, la nature de la culture est d'être jouée. La réalité naturelle-culturelle est ludique. Aucune transcendance n'en fixe le sens. Elle est à la fois assemblage, construction, choix, sélection, prévision... et hasard. Elle ne copie rien, n'imite rien. Rien ne lui est antérieur, postérieur, extérieur. La réalité ne se rattache donc ni à un sens premier (tragique), ni à un sens dernier (utopique). Son jeu consiste à coordonner nature et culture, et à les disloquer.
Tout se forme et se déforme, s'ouvre et se ferme au jeu. Le jeu manifeste la tension et la torsion de l'espace dans le temps. Spirale, dont les différents plans-moments ne se laissent pas isoler. Distincts, ils communiquent sans qu'on puisse leur attribuer à chacun des limites qui leur seraient propres. La communication est jeu diachronique-synchronique s'exprimant à travers, et malgré, le malentendu qui la forme et la déforme.
Du point de vue de la théorie « globale », on peut reprocher aux « rationalistes » d'avoir ramené le jeu à celui qui se joue à l'intérieur de limites déterminant l'espace et le temps ludiques. C'était ne retenir du jeu que les apparences en oubliant que les règles du jeu tracent, en même temps et dans un même mouvement, les limites d'un dedans et d'un dehors, d'un ici et d'un ailleurs, se définissant l'un par rapport à l'autre.
Le jeu implique (et explique) le hors-jeu. La loi, le hors-la-loi. Chaque culture invente ses propres lois, détermine les limites d'un dedans et d'un dehors, et par là découpe son propre champ de symbolisation. Mais le jeu est aussi franchissement et affranchissement des limites de la loi : à la violence de la loi fait écho la loi de la violence. Leur jeu est l'enjeu de toute civilisation.
En déterminant les limites de l'ordre et du désordre, du permissible et de l'interdit, du naturel et du monstrueux, la loi constitue la charnière qui maintient unis les bords de la faille originelle. Point de suture, césure, métaphore de l'origine, elle tient lieu d'origine. Elle exprime le détour originel, l'écart impliqué (et implicite) dans toute articulation, et par là même l'ouverture et la fermeture du langage.
La loi délimite donc l'espace (lieu et non-lieu) de toute communication. Mais le jeu de la communication porte en lui-même sa propre dis-location, car la règle du jeu c'est le temps, le temps qui est aussi la règle du dérèglement.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jacques EHRMANN
: licencié ès lettres, Ph. D.,
associate professor , Yale University, Connecticut, États-Unis
Classification
Autres références
-
ART (Aspects esthétiques) - La contemplation esthétique
- Écrit par Didier DELEULE
- 3 636 mots
...à la faveur du plaisir préliminaire que procure la forme elle-même, il engendre, par la levée des répressions et des refoulements, un plaisir nouveau ; de même, le jeu vise en réalité à réaliser un désir sur le mode hallucinatoire, tout comme le rêve cherche, de son côté, à remplir un vœu. La création... -
AXELOS KOSTAS (1924-2010)
- Écrit par Francis WYBRANDS
- 841 mots
- 1 média
Par sa vie et sa pensée Kostas Axelos, né à Athènes le 26 juin 1924, n'a cessé d'interroger les horizons du monde, son déploiement et ses métamorphoses. Les thèses qu'il soutient à Paris, en 1959, sont consacrées respectivement à l'aurore poétique et énigmatique de la ...
-
BRADLEY FRANCIS HERBERT (1846-1924)
- Écrit par Jean WAHL
- 3 616 mots
Parmi toutes les idées que passe ici en revue Bradley, nous pouvons insister sur les pages où il parle du jeu et du sérieux. D'Héraclite à quelques disciples de Husserl et de Heidegger en passant par Nietzsche, l'idée de jeu a conservé une grande importance. Selon Bradley, le jeu implique un sens du... -
CARTES À JOUER
- Écrit par René ALLEAU
- 2 535 mots
L'Antiquité gréco-romaine a ignoré les cartes. Il semble bien que ce jeu ait été d'abord transmis aux Italiens par une famille d'émigrés arméniens. Le mot vient du latin charta, « feuille de papier, papier », dérivé du grec khartês, « feuille de papyrus ». Le mot ancien...
- Afficher les 47 références
Voir aussi