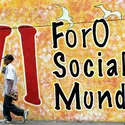JUSTICE Justice politique
Article modifié le
Fonctions et signification de la justice politique
Tout pouvoir cherche à se pérenniser : l'opposition est plus supportée que délibérément respectée. Lorsque, selon l'évaluation faite par les dominants, une opposition dépasse les limites qui lui sont implicitement (et non légalement) reconnues, la répression frappe. La médiation juridictionnelle conforte la légitimité du pouvoir, alors que le recours à de simples mesures administratives fait courir le risque du discrédit tout en auréolant les victimes. En effet, la justice par sa solennité et son ritualisme conserve une part du sacré qui dans l'histoire s'identifiait à l'autorité politique : la « légitimité longue » du droit est plus efficace que la « légitimité courte » du politique.
Sous la IVe République, condamner en correctionnel des militants communistes pour « atteinte à la défense nationale » mais poursuivis pour de simples actes de propagandes anticolonialistes, a une portée « pédagogique » que ne peut avoir une mesure strictement politique (tribunal de Marseille, 4 janvier 1950, ministère de la Défense nationale c. P. Emmanuelli et A. Preziasi, directeurs du journal La Provence nouvelle). Lorsque des militants africains partisans de l'indépendance de leur pays encore colonisé sont condamnés à l'issue d'affrontement avec les forces de l'ordre par une cour d'assises (voir par exemple, en 1950, devant la cour d'assises d'Abidjan, les procès de l'affaire de Kouenougla [40 condamnations] ou celui des incidents de Treichville), la justice consacre la légitimité de la colonisation. Il en est de même avec les appelés condamnés pour avoir refusé de participer aux opérations militaires en Algérie (en 1958, par exemple, 15 jeunes soldats, dont Alban Liechti, totalisèrent 30 ans de prison pour avoir dénoncé la torture et la répression collective pratiquée en Algérie, quatre ans avant la proclamation de l'indépendance). La cause de l'Algérie française est ainsi valorisée par la justice.
Le relais juridictionnel s'apparente à une intervention extérieure aux conflits en cours et présente tous les aspects formels d'une défense de la légalité. Les auteurs de l'infraction politique sanctionnée sont assimilés aux yeux de l'opinion à des délinquants ordinaires. Le pouvoir recherche ainsi, et obtient souvent, la déconsidération de l'adversaire et de sa cause.
Lorsque les gouvernants optent pour la répression directe, la justice n'a plus pour fonction que de la dissimuler, soit en laissant sans réponse les plaintes déposées par les citoyens (plusieurs centaines ont été ignorées à l'issue des violences policières de Charonne en 1960 à Paris), soit en niant la responsabilité de l'État (comme ce fut le cas pour les « disparitions » en Algérie, au Chili, en Argentine, etc.). Les affaires les plus délicates où se trouvent mêlés les services spéciaux de l'État ou d'un État étranger et le banditisme, comme les affaires Gladio (en Italie) ou du S.A.C. (en France) dans les années 1980, sont traitées par la justice en limitant les charges de l'accusation à certains individus, souvent simples exécutants, afin d'éviter la mise en cause des institutions parfois commanditaires. La justice n'est alors plus qu'une administration comme une autre, intégrée au pouvoir exécutif chargé de rendre un service politique aux gouvernants. Que la justice se comporte de façon insuffisamment maniable elle sera contournée par de nouvelles juridictions d'exception composées de juges de « confiance ».
C'est cependant le problème de la corruption qui est l'un des plus complexes que doit résoudre la justice lorsqu'elle met en cause des personnalités politiques et les milieux d'affaires. Un procès en corruption a certes une fonction « purificatrice » : il se veut la démonstration de la volonté d'un régime d'éliminer ce qui le souille. Il se produit dans certains cas que l'épurateur soit lui-même corrompu et n'épure que pour s'exonérer de ses propres responsabilités. Il risque cependant de révéler avec éclat le mépris du droit par les sommets de l'État et par les grands opérateurs économiques et plus généralement la faillite de la morale publique. La corruption, qui frappe l'ensemble des partis politiques à proportion de leurs pouvoirs réels et du nombre de leurs élus, jette un discrédit non seulement sur les partis et sur le politique en général, mais aussi sur le système politique et économique dans sa globalité. La justice peut alors – sans que cela soit son objectif – briser la fiction d'une élite vertueuse incarnant la volonté du peuple. Les « affaires » en France et dans d'autres États européens (Italie, Allemagne, Espagne, etc.) ont eu un tel retentissement que la justice (et particulièrement le juge d'instruction) a été accusée de manifester une volonté de puissance illégitime, incompatible avec la souveraineté du peuple et de ses représentants.
Il y a certes une certaine évolution de la culture politique des juges européens (formation universitaire moins positiviste, apparition du syndicalisme dans la magistrature, origine sociale plus diversifiée, etc.) qui conforte leur fonction de garant des droits et des libertés des citoyens et atténue la tradition de « domination douce » exercée au bénéfice des élites. Le comportement contemporain d'un certain nombre de magistrats français contraste ainsi avec l'attitude traditionnellement révérencieuse de la justice.
Cependant, le facteur essentiel de cette montée en puissance de la justice face aux autres pouvoirs résulte de la carence des contrôles dans l'ordre interne au sommet de l'État comme à celui des pouvoirs locaux. La plupart des contrôles publics ont été supprimés dans les échanges internationaux : les marchés financiers sont devenus libres. L'argent est libre d'aller et de venir, pendant que les enquêtes judiciaires restent confinées à l'intérieur des frontières. L'Europe des affaires, par exemple, devance de loin l'Europe judiciaire, qui n'est qu'en voie d'édification.
Dans l'ordre interne, les assemblées représentatives jouent un rôle très réduit. Le contrôle de légalité au niveau départemental s'exerce peu. Dans son arrêt Brasseur du 25 janvier 1991, le Conseil d'État a admis que le préfet n'est pas tenu de déférer au juge administratif les actes illégaux qu'il constate. Sur les quelque 5 millions d'actes par an transmis aux préfets par les collectivités locales, quelques centaines seulement sont déférées au juge administratif. Les directions de la Concurrence et de la Répression des fraudes ne parviennent que très partiellement à faire respecter la légalité économique. Se développe ainsi, aux marges du droit, une culture de l'arrangement et du contournement de la règle, stimulée par la logique économique libérale, encline par nature au moins-disant juridique.
La justice joue ainsi un rôle de substitut : elle est « l'effet bout de chaîne » qui révèle les carences du système. Elle n'est pas la cause de ses perversions. En contrepartie du déclin de l'État-providence, la justice réinvestit l'ensemble des secteurs de la société. L'un des plus hauts magistrats de France a pu, en réaction, déclarer en 1994 : « Il faut savoir, dans l'intérêt national, arrêter ce processus dévastateur en tournant la page d'une façon acceptée par l'opinion publique » (cité par Eva Joly dans son livre Notre Affaire à tous). Ainsi, la justice politique constitue dans son fonctionnement une épreuve de vérité pour le système socio-politique dans lequel elle fonctionne, mais aussi pour elle-même.
Les procès politiques font apparaître plus clairement que les procès de droit commun les carences de l'appareil judiciaire. La plupart des procédures de droit commun n'intéressent en rien la hiérarchie et l'autorité judiciaire peut donc se manifester en toute indépendance. Par contre, le tiers impartial devient perturbateur lorsqu'il intervient à l'encontre de la raison d'État ou de la logique économique. C'est alors que la question du statut des magistrats se pose : si le juge français n'a rien à craindre (principe de l'inamovibilité), il a tout à espérer (modalités de promotion). Les liaisons dangereuses des pouvoirs publics et privés et de la justice (par exemple, le pouvoir de juger de l'opportunité des poursuites exercé par le parquet) remettent en cause l'impartialité de la justice. Les moyens dont sont privés les juges d'instruction chargés de la criminalité financière sont significatifs de même que la possibilité de décider l'arrêt de l'enquête à un certain stade de l'instruction.
L'illustration la plus extrême de ces carences de la justice politique est l'exécution pure et simple de magistrats en charge des affaires les plus délicates, en Italie particulièrement où la faiblesse traditionnelle de l'État a rendu le processus plus violent qu'ailleurs et pour ainsi dire « chimiquement pur ». L'assassinat de certains magistrats est la preuve qu'une partie seulement de l'institution qu'il s'agit d'intimider représente une menace réelle pour la criminalité politico-financière.
Certes, la justice n'a pas pour fonction de refaire le monde. La justice politique fait apparaître cependant qu'elle est en difficulté lorsqu'elle veut simplement remplir la mission qui lui a été légalement confiée dès lors qu'elle pénètre dans le champ du politique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Robert CHARVIN : professeur agrégé de droit public à l'université de Nice
Classification
Médias
Autres références
-
JUSTICE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 431 mots
Bien que les enfants aient aisément recours à l’idée de justice en qualifiant souvent spontanément d’« injustes » tous les interdits qui font obstacle à leurs désirs, la notion de justice est l’une des plus complexes et des plus ambiguës qui soient.
Deux raisons principales expliquent...
-
ALTERMONDIALISME
- Écrit par Christophe AGUITON , Encyclopædia Universalis et Isabelle SOMMIER
- 6 806 mots
- 1 média
Dans le monde anglo-saxon, en revanche, s’est développée à partir de 2003, pour finir par s’imposer, l'expression« mouvement pour la justice globale » qui met l'accent sur deux de ses caractéristiques et innovations supposées : d'une part, sa dimension transnationale ; d'autre part, son cadrage... -
ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 11 140 mots
- 8 médias
...rapport à l'infini, mais l'infini est principe pour tout le reste, qu'il « enveloppe et gouverne ». Ce « gouvernement » s'exerce dans le sens de la « justice », c'est-à-dire de l'équilibre (ou « isonomie ») entre éléments antagonistes qui, soumis à une loi commune, tournent à l'avantage du Tout ce qui... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO
- 38 895 mots
- 19 médias
Mais il ne se contente pas de mesures symboliques :tout l'arsenal juridique qui protégeait les crimes commis durant la dictature est démantelé. Il décide d'une profonde réforme de la Cour suprême. La nomination des juges est désormais soumise au débat public. En outre, tous les juges... -
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
Le livre V est consacré tout entier à la vertu dejustice. Cette vertu, qui consiste à donner à chacun son dû, peut être, dans la tradition platonicienne, définie par référence à un ordre mathématique : ainsi la justice distributive (à chacun selon son mérite) s'exprime-t-elle dans une proportion.... - Afficher les 43 références
Voir aussi
- ANTICOMMUNISME
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- ANARCHISTES MOUVEMENTS
- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958
- HAUTE COUR DE JUSTICE
- CODE PÉNAL
- DROIT COMMUN
- COMPÉTENCE, droit
- EXCEPTION TRIBUNAUX D'
- DÉLIT POLITIQUE
- ÉPURATION POLITIQUE
- JUSTICE POLITIQUE
- POUVOIR POLITIQUE
- INFRACTIONS
- RESPONSABILITÉ PÉNALE
- SOCIOLOGIE POLITIQUE
- OPPOSITION POLITIQUE
- DÉFENSE DROITS DE LA
- EXÉCUTIF POUVOIR
- ANGLAIS DROIT
- RÉPRESSION
- RESPONSABILITÉ POLITIQUE
- FRANCE, droit et institutions
- POUVOIR & CONTRE-POUVOIR
- COLLOR DE MELLO FERNANDO (1949- )
- CORRUPTION
- SÛRETÉ MESURES DE, droit pénal