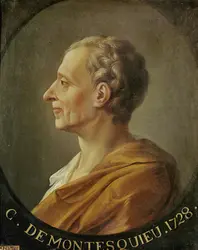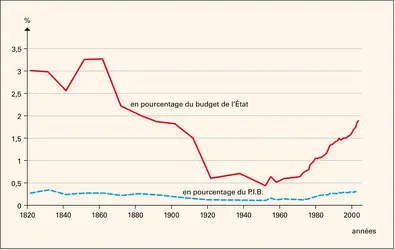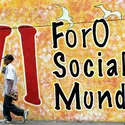JUSTICE Les institutions
Article modifié le
Architecture
La manière dont l'État cherche à faciliter aux plaideurs l'accès des tribunaux et à leur assurer des juges compétents et impartiaux varie beaucoup d'un pays à l'autre. Des facteurs multiples contribuent à cette diversité : les dimensions du pays, son caractère fédéral ou unitaire, son degré de civilisation et le rôle aussi qui est dévolu au droit parmi les procédés de régulation sociale, certaines traditions historiques, des données politiques ou économiques, voire religieuses, enfin la nature et la plus ou moins grande complexité des rapports qu'il y aura lieu de juger. L'organisation juridictionnelle française, qui nous paraît rationnelle parce que nous y sommes habitués, ne saurait convenir à tous les pays. Policée par l'ouvrage des ans, elle répond à un certain nombre d'exigences qu'illustre la façon dont les juridictions sont composées, spécialisées et hiérarchisées.
Composition des juridictions
Les juridictions, conçues comme organes investis du pouvoir juridictionnel, se composent de juges. Encore faut-il déterminer leur nombre et leur qualité.
Juger seul ou à plusieurs ?
Pour le nombre, le droit français consacre le principe de la collégialité. La collégialité des juridictions est le principe : la décision ne peut être rendue que si un certain nombre de juges, trois en général, ont assisté aux débats et participé au délibéré. Les avantages de ce système sont multiples. Tout d'abord, la collégialité garantit l'impartialité et la qualité de la justice : la délibération à plusieurs doit normalement permettre d'approfondir les difficultés, d'éclairer la réflexion, d'éviter les préjugés et les partis pris ; elle prolonge, en quelque sorte, la discussion contradictoire des termes du litige entre les parties. La collégialité concourt également à garantir l'indépendance de la justice puisque la responsabilité du jugement est partagée sous le sceau du secret le plus absolu, ce qui peut être précieux dans certains contentieux, comme le contentieux administratif qui, avec l'État, met en cause une partie particulièrement puissante. C'est pourquoi le droit français est attaché à l'anonymat de la sentence collégiale et à la prohibition des opinions dissidentes admises dans le système anglo-saxon : les juges sont ainsi protégés indirectement contre les menaces, les rancunes et les représailles. Pourtant, le système opposé de l'unicité n'est pas sans vertus. La juridiction à juge unique cultive assurément, chez les magistrats, le sens de la responsabilité et, en démultipliant l'activité juridictionnelle, allège les charges de l'appareil judiciaire, ce qui va nécessairement dans le sens des intérêts des justiciables (et de l'État !).
C'est vraisemblablement cette dernière considération, toute pragmatique, qui explique le développement contemporain de la juridiction à juge unique. En effet, si l'organisation juridictionnelle française a toujours fait cohabiter juridictions collégiales et juges uniques (des juges uniques, il en est de fort anciens, que ce soit en matière civile, avec le juge des référés, le juge-commissaire, le juge aux ordres, le juge de paix, puis le tribunal d'instance, ou en matière pénale, avec le juge d'instruction et le juge de simple police), la juridiction à juge unique s'est incontestablement accrue dans la période récente. Cet accroissement est avéré en matière civile, ainsi qu'en témoigne l'institution du juge des enfants (1945), du juge de l'expropriation (1958), du juge des tutelles (1964), du juge de l'exécution (1972-1991), du juge aux affaires matrimoniales (1975), remplacé par le juge aux affaires familiales (1993), sans parler de l'attribution croissante de pouvoirs juridictionnels propres aux chefs de juridiction, singulièrement au président du tribunal de grande instance. Le contentieux pénal n'a pas échappé à la tendance puisqu'a été institué, outre le juge des enfants, le juge de l'application des peines (1958) et organisé la compétence à juge unique du tribunal correctionnel pour un nombre importants de délits (1972-1995). Le contentieux administratif lui-même, qui passait pour être rétif à l'extension du « royaume du juge unique » (Roger Perrot), a fini par consacrer en son sein de nombreuses hypothèses de jugement à juge unique, ou par un juge statuant seul, comme le disent plus facilement les administrativistes : juridiction des référés (1955), pouvoir accordé aux chefs de juridiction de prononcer certaines décisions provisoires (1990), voire de trancher le litige sur le fond dans un nombre important de matières qui relevaient, jusque-là, de la formation collégiale de la juridiction (1995). Il est notable que les juges statuant comme juge unique sont, à de rares exceptions près, des juges de métier, ce qui conduit à un autre aspect de la composition des juridictions.
Juger : un métier ou un mandat ?
Deux conceptions sont envisageables quant à la qualité des juges. La justice peut être rendue par des juges professionnels, qui en font leur métier, ou par des juges occasionnels, qui en reçoivent le mandat pour un temps. Le système français repose sur la prééminence des juges de métier, mais fait une assez large place aux juges d'occasion pour des raisons qui tiennent à l'histoire et que renforcent souvent d'impérieux soucis d'économie budgétaire.
Plusieurs règles d'organisation judiciaire traduisent cette prééminence. D'abord, s'il arrive que les juges professionnels soient totalement exclus de la composition d'une juridiction d'exception (ainsi le tribunal de commerce), ils réapparaissent nécessairement en qualité de juges du recours exercé à l'encontre des décisions rendues par cette juridiction (cour d'appel ou Cour de cassation). Au demeurant, l'exclusion n'est parfois que partielle. Ainsi le conseil de prud'hommes ne comporte-t-il pas, en principe, de magistrat de carrière mais, lorsque les membres de cette juridiction paritaire ne parviennent pas à se départager, celle-ci se réunit sous la présidence d'un juge professionnel, appelé juge départiteur, qui est un magistrat du tribunal d'instance. Dans certains cas, il y a même échevinage, la juridiction étant composée de juges occasionnels mais présidée, d'emblée, par un juge professionnel qui en est membre permanent : ainsi les tribunaux des affaires de Sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les juridictions pour mineurs ou la cour d'assises.
D'une certaine manière, les modalités de recrutement illustrent également la distinction des magistrats de carrière et des juges temporaires. Pour les juges occasionnels, l'accès aux fonctions de judicature est le résultat, en général, d'une élection par les justiciables potentiels (tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux) ; ce n'est qu'exceptionnellement que l'accès aux fonctions judiciaires résulte d'une simple désignation (tribunal des affaires de Sécurité sociale, commission d'indemnisation des victimes d'infractions, tribunal pour enfants). En tout cas, le système du concours est exclu pour les juges non professionnels, de même que le système du tirage au sort, qui n'est pratiqué que pour le jury de la cour d'assises. En revanche, pour les magistrats de carrière, comme pour tous les autres fonctionnaires, l'accès à la magistrature se fait, en principe, sur concours (ou sur titres et épreuves dans des hypothèses particulières) ; ce n'est qu'accessoirement qu'un recrutement latéral sur titres demeure ouvert. Le système de la vénalité des charges, en vigueur sous l'Ancien Régime, a disparu, quant à lui, lors de la Révolution, et le système de l'élection, qui a pu être appliqué pendant le droit intermédiaire et qui est toujours en cours dans certains pays, a été abandonné depuis le Consulat.
En règle générale, les juges professionnels sont recrutés parmi des juristes qui choisiront à leur sortie de la faculté de droit de faire leur carrière au service de la justice. On trouve cependant, dans les pays de common law, un tout autre système : les juges des cours supérieures y sont choisis parmi des avocats, pourvus ou non d'un titre universitaire, pour lesquels cette nomination est un couronnement. Ce mode spécial de désignation des juges est à la fois la cause et l'effet de l'originalité qu'a présentée le développement historique du droit en Angleterre. À lui se rattache le fait que l'Angleterre n'ait connu nulle « réception » du droit romain, enseigné dans les universités. Par le caractère original du juge anglais peut s'expliquer aussi le fait que, en contraste avec le Continent, on ait admis en Angleterre le principe du juge unique ; l'admission de ce principe a été aussi favorisée, toutefois, par une autre considération, qui était, jusqu'à une époque récente, la participation d'un jury dans toutes les affaires, civiles ou criminelles, de quelque importance. Le mode anglais de désignation des juges a été admis de façon générale dans les autres pays de common law. Il a été profondément altéré cependant aux États-Unis, où, pour les juridictions des États, l'on s'est très largement rallié, au xixe siècle, au principe de l'élection des juges : ils continuent bien à être recrutés parmi les avocats, mais le critère déterminant leur choix a cessé d'être le succès professionnel.
Spécialisation des juridictions
Dès lors qu'un système juridictionnel compte plus d'un tribunal, il est nécessaire d'organiser entre elles les différentes juridictions. La diversité des litiges conduit à les spécialiser. C'est là une nécessité universelle dont témoigne, en France, l'existence du dualisme juridictionnel déjà présenté, car il fait partie des fondations du système français. Mais, à l'intérieur de chaque ordre de juridictions, la spécialisation est encore à l'œuvre qui peut conduire à de nouvelles subdivisions, à la manière d'une arborescence.
Juridictions de l'ordre judiciaire
Le constat est particulièrement net pour l'ordre judiciaire, où coexistent juridictions civiles et juridictions pénales.
L'organisation de la justice civile est relativement simple. En première instance, le tribunal de grande instance en est le pivot. Cette place particulière tient à sa qualité de juridiction de droit commun, ce qui n'exclut pas qu'il jouisse d'une compétence exclusive dans un nombre très important de matières (état des personnes, contentieux immobilier, procédures d'exécution...). Son ressort de référence est le département. Mais il peut y avoir plusieurs tribunaux de grande instance par département selon l'importance de la population, le volume de l'activité judiciaire et l'état des communications. On en comptait 181 en 2007. Autour du tribunal de grande instance, gravitent des juridictions d'exception qui connaissent, limitativement, des matières déterminées par la loi. Successeur des justices de paix, supprimées en 1958, le tribunal d'instance est le juge des petites affaires civiles (rapports de voisinage, contentieux des baux d'habitation, contentieux de la responsabilité pour les créances inférieures à 10 000 euros....). En règle générale, le ressort du tribunal d'instance s'étend sur plusieurs cantons et, le plus souvent, il prend l'arrondissement pour référence. Les tribunaux de commerce sont les juridictions les plus anciennes de l'organisation judiciaire française : leur origine remonte à la fin du Moyen Âge. Le tribunal de commerce est une juridiction corporative composée exclusivement de commerçants élus par leurs pairs. Il est compétent pour trancher les litiges du commerce définis, largement, comme les litiges entre commerçants, certes, mais comprenant aussi les litiges relatifs aux actes de commerce, alors même qu'ils ne seraient pas le fait d'un commerçant (par exemple une lettre de change), le contentieux des sociétés commerciales, la prévention et le traitement des difficultés des entreprises commerciales et artisanales (ce qu'on appelait autrefois les faillites, et aujourd'hui la défaillance économique...).
Le conseil de prud'hommes, dont l'origine remonte au début du xixe siècle, a pour fonction de régler par voie de conciliation et, à défaut, par voie de jugement les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ou d'apprentissage. On en compte aujourd'hui près de 270 (au moins un par ressort de tribunal de grande instance). Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire. Les conseillers prud'homaux sont des juges élus représentant, pour moitié, les employeurs, pour moitié, les salariés.
Deux autres juridictions d'exception, toutes deux échevinales et toutes deux créées au milieu du xxe siècle, complètent le tableau de la justice civile : les tribunaux des affaires de Sécurité sociale, compétents pour connaître du contentieux juridique de la Sécurité sociale (affiliation à un régime, paiement des cotisations, versement d'une prestation sociale), et les tribunaux paritaires des baux ruraux, institués, comme leur nom l'indique, afin de connaître des litiges relatifs aux baux ruraux entre propriétaires et fermiers, ou métayers.
L'organisation de la justice pénale est plus complexe. D'abord, trois sortes de juridictions de droit commun sont compétentes en première instance : les tribunaux de police, pour les contraventions, les tribunaux correctionnels, pour les délits, et les cours d'assises, pour les infractions les plus graves, appelées crimes. Jusqu’en 2000, seuls les jugements des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels étaient soumis, comme en matière civile, au contrôle des cours d'appel et à celui de la Cour de cassation. Les décisions des cours d'assises, caractérisées par le fait qu'un jury, composé de neuf citoyens tirés au sort, y collabore avec des juges de carrière, ne pouvaient être frappées que d'un pourvoi en cassation. Depuis la loi du 15 janvier 2000, ces décisions sont susceptibles d'appel devant une autre cour d'assise. En matière pénale, les juridictions d'exception sont fort nombreuses, appelées à juger les mineurs (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs), les militaires (tribunaux aux armées, tribunal des forces armées, tribunaux prévôtaux, en temps de paix, tribunaux militaires aux armées, tribunaux territoriaux des armées, Haut Tribunal des forces armées, en temps de guerre), les ministres (Cour de justice de la République) ou les marins (tribunaux maritimes commerciaux).
Cette distinction des juridictions pénales et des juridictions civiles ne doit toutefois pas faire perdre de vue les liaisons qui existent entre ces deux aspects de l'activité judiciaire, y compris d'un point de vue structurel puisque le tribunal de police n'est que le tribunal d'instance statuant en matière de simple police, le tribunal correctionnel est le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle et que la cour d'appel comporte une chambre des appels correctionnels à côté des chambres civiles. D'ailleurs, dans les petits tribunaux, où les personnels, peu nombreux, ne sont pas spécialisés, ce sont les mêmes magistrats qui tiennent, selon les jours, l'audience civile et l'audience pénale. Surtout, toutes ces juridictions, qu'elles soient civiles ou pénales, y compris quand elles n'ont pas, administrativement, leur équivalent dans l'autre ordre (la cour d'assises, par exemple), se rattachent, sans exception, à la Cour de cassation par l'intermédiaire du pourvoi en cassation. En outre, si les juridictions civiles ne peuvent jamais faire application du droit pénal – il y a alors matière à question préjudicielle –, il arrive que les tribunaux répressifs statuent sur des procès civils, « sur intérêts civils » dit-on, lorsque la victime d'une infraction pénale s'est constituée partie civile pour obtenir réparation des dommages causés par l'infraction. Le juge pénal fait alors application des règles du droit civil, même si la procédure suivie continue de relever du code de procédure pénale.
Juridictions de l'ordre administratif
Issue de la séparation des fonctions administratives et judiciaires, la juridiction administrative s'est constituée progressivement. Les ressemblances avec l'ordre judiciaire n'ont cessé de s'accuser, bien que subsistent encore d'irréductibles spécificités. L'ordre administratif, en tout cas, se présente lui aussi sous la forme d'un ensemble de juridictions hiérarchisées, dotées de compétences variables, de droit commun pour les unes, d'attribution pour les autres.
Héritiers adultérins des anciens conseils de préfecture institués par la loi du 28 pluviôse an VIII, les tribunaux administratifs ont été créés par décret du 30 septembre 1953. Ils sont au nombre de 36, dont 28 en France métropolitaine, ce qui leur confère un ressort étendu à plusieurs départements, sans épouser, pour autant, les limites des régions administratives. Outre ses missions consultatives, en particulier auprès du préfet, le tribunal administratif est, en premier ressort et à charge d'appel, juge de droit commun du contentieux administratif. Il connaît donc de tout litige administratif qui n'a pas été spécialement réservé par la loi à une juridiction administrative spécialisée.
Les juridictions administratives spécialisées sont les juridictions d'exception de l'ordre administratif ; elles relèvent directement du contrôle du Conseil d'État par la voie du pourvoi en cassation. Elles se comptent par dizaines, mais leur identification est difficile car elles ne se présentent pas forcément comme des juridictions. On relèvera tout spécialement, au nombre de ces juridictions, les formations disciplinaires d'un certain nombre d'institutions, depuis le Conseil supérieur de la magistrature jusqu'aux juridictions ordinales (médecins, architectes, par exemple, mais non pas les avocats, qui relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire) en passant par le Conseil supérieur de l'éducation nationale (statuant sur appel des décisions des sections disciplinaires des conseils d'université). Citons encore, sans souci d'exhaustivité, la Commission de recours des réfugiés, la Commission centrale d'aide sociale ou le Conseil des prises, qui statue sur la validité des prises maritimes. La composition et les structures de ces juridictions sont d'une hétérogénéité rebelle à toute classification. Un sort particulier doit être réservé aux juridictions financières : les 26 chambres régionales des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière et la Cour des comptes, créée en 1807, qui figure parmi les plus anciennes et les plus prestigieuses juridictions administratives spécialisées.
Hiérarchie des juridictions
Aucune hiérarchie n'existe dans l'interprétation des lois, c'est-à-dire dans l'art de dire le droit pour un cas particulier. Chaque juridiction est souveraine dans les limites de sa compétence. Mais les juridictions ne se situent pas toutes au même niveau dans l'organisation juridictionnelle. Cette organisation se présente en effet sous la forme d'une pyramide comportant trois étages : les juridictions de première instance, les juridictions d'appel et la Cour supérieure. Sans doute, de manière générale, la hiérarchie des juridictions garantit le justiciable contre les risques d'erreur et permet ainsi que soit rendue une bonne justice : les voies de recours sont un élément du droit au juge. Mais, plus finement considérée, elle repose sur l'articulation de deux sortes de voies de recours qui, si elles peuvent se cumuler, ne jouent pas le même rôle : l'appel, d'une part, qui met en œuvre le principe du double degré de juridiction et permet de rejuger les litiges, le pourvoi en cassation, d'autre part, dont la fonction, différente, est plutôt d'assurer la cohérence de l'ordre juridictionnel en permettant de juger les jugements.
L'appel : rejuger les litiges
La faculté d'appel est ancienne, mais son fondement a varié dans le temps. Sous l'Ancien Régime, l'appel répondait essentiellement à des préoccupations d'ordre politique. En raison de la diversité des ordres de juridictions (royales, seigneuriales, ecclésiastiques), une décision pouvait faire l'objet d'une multitude d'appels successifs. Le droit d'appel, au même titre, d'ailleurs, que le pouvoir d'évocation, avait pour fonction de favoriser, de proche en proche, l'attraction des procès dans la sphère immédiate de la puissance du roi ; l'appel était donc, avant tout, un instrument politique destiné à assurer la souveraineté de la justice royale. La Révolution, à cet égard, a opéré une rupture radicale. Le souci de séparer les pouvoirs ajouté à la volonté d'interdire tout rôle politique aux juges ont conduit le législateur à débarrasser l'appel de toute préoccupation de cet ordre au profit de considérations techniques : l'appel constitue une garantie de bonne justice. Pour cela, il suffit que le litige soit jugé deux fois : une multitude d'appels successifs ne se justifie plus et l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement qui en est frappé. Seulement, pour éviter la résurrection des parlements, dispersés en novembre 1789 par l'Assemblée, l'appel hiérarchique était abandonné au profit d'une procédure d'appel « circulaire ». Il a fallu attendre 1800 pour que l'appel redevienne une voie de recours hiérarchique, avec la création des tribunaux d'appels, devenus plus tard cours d'appel.
En matière civile, tout justiciable doit pouvoir bénéficier d'un second degré de juridiction s'il a succombé en première instance. Il s'agit bien d'un second degré : à la fois parce qu'il est le dernier et parce qu'il n'est possible d'y accéder qu'après avoir épuisé le premier. Ce principe, toutefois, n'a rien d'absolu. L'exclusion du second degré est fréquente. Elle peut résulter de la volonté du titulaire du droit d'appel, qui a la faculté, à certaines conditions, de renoncer à l'appel. La loi peut également interdire l'accès au second degré de juridiction en raison de la faible valeur du litige ou en considération de la nature particulière du contentieux (par exemple le contentieux électoral). L'appel est en principe exercé devant l'une des 35 cours d'appel qui sont juridictions de droit commun au second degré de juridiction. Ce n'est que dans de rares hypothèses que l'appel est porté devant une autre juridiction (devant la Cour nationale de l'incapacité dans le contentieux technique de la Sécurité sociale ou devant le tribunal de grande instance pour les décisions du juge des tutelles, par exemple).
Depuis l'introduction en 2000 d'une procédure d'appel circulaire pour les décisions de cours d’assises, les mêmes principes valent en matière pénale,. La procédure pénale organise, en amont du jugement criminel, une instruction préparatoire à deux degrés, faisant intervenir, en première instance, le juge d'instruction et, à l'échelon de la cour d'appel, la chambre de l'instruction. Le contentieux administratif tend aussi, inexorablement, à rapprocher la voie d'appel du régime qui est le sien dans le procès civil. Pendant longtemps, l'appel a été exclu en matière administrative en raison du fait que le Conseil d'État, juridiction administrative la plus haute, se prononçait lui-même comme juge du premier degré. Mais la réforme du contentieux administratif engagée par la loi du 31 décembre 1987, avec la création des cours administratives d'appel, aujourd'hui au nombre de huit, a sensiblement modifié les données du problème en faisant du Conseil d'État un juge de cassation plutôt qu'un juge du fond.
Le pourvoi en cassation : juger les jugements
Alors que le principe du double degré de juridiction permet au justiciable d'obtenir que le litige soit jugé, en droit et en fait, une deuxième fois, le recours en cassation lui offre la garantie que, en toute hypothèse, il pourra obtenir que soit vérifiée la conformité aux règles de droit de la décision prononcée par les juges du fond afin que, le cas échéant, elle soit annulée. Voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation n'est ouvert que dans les cas spécifiés par la loi pour faire censurer par la Cour de cassation et le Conseil d'État la non-conformité aux règles de droit des jugements rendus par les juridictions du fond, de première instance ou d'appel. Cour de cassation (créée par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII) et Conseil d'État (créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII-15 déc. 1799), l'une et l'autre unique en leur ordre et siégeant tous deux à Paris, sont composés de hauts magistrats arrivés au faîte de leur carrière.
En raison de la distinction du fait et du droit, le pourvoi n'ouvre pas un troisième degré de juridiction. Juge du droit, le juge de cassation ne peut être invité qu'à vérifier l'interprétation de la règle de droit et son application aux faits souverainement constatés par le juge du fond. Son rôle se borne à se prononcer sur la légalité du jugement attaqué et non pas sur le fond du procès. Ce n'est pas le litige qui lui est déféré, et il n'a donc pas à trancher une nouvelle fois comme le fait une juridiction d'appel, mais seulement la décision prononcée en premier et dernier ressort ou en appel. En conséquence, si le pourvoi apparaît justifié (la décision n'était pas conforme au droit), le juge de cassation ne peut pas, en principe, substituer sa décision à celle des juges du fond ; il ne peut que casser le jugement querellé et renvoyer l'affaire devant les juges du fond, auxquels il appartiendra de trancher le litige une nouvelle fois.
Au-delà de cette fonction juridictionnelle dans les cas dont elles sont saisies, les arrêts prononcés par ces hautes juridictions ont vocation à faire jurisprudence, non pas par raison d'autorité (ni arrêts de règlement, prohibés depuis la Révolution, ni précédents comme en common law), mais par l'autorité de leurs raisons. Assurer l'interprétation uniforme de la loi fait aussi partie des missions de la Cour de cassation et du Conseil d'État, mission régulatrice qu'impose le principe d'égalité des justiciables devant la loi.
Le système juridictionnel des autres pays
Le système français se retrouve dans un grand nombre de pays, avec certaines variantes. Les cours supérieures sont organisées différemment et ont souvent un autre rôle. Les cours d'appel peuvent être supprimées. Les juridictions d'exception établies ne sont pas les mêmes. Les tribunaux administratifs peuvent être intégrés dans la hiérarchie des juridictions ordinaires, ou encore ils peuvent disparaître ou voir leurs attributions réglées différemment. Une Cour de justice constitutionnelle peut être prévue, ce que n'est pas encore, en France, le Conseil constitutionnel, qui est cependant engagé, inexorablement, dans cette voie de la « juridictionnalisation ». Naguère, les pays socialistes s'inspiraient de principes analogues, sauf à rappeler que les contestations qui opposaient les unes aux autres les organisations économiques étatisées étaient soustraites à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour être réglées, au sein de l'administration, par les soins de commissions d'arbitrage public. Depuis la chute du Mur de Berlin, ces pays sont à la croisée des chemins, en train de se doter de nouvelles structures politiques, économiques et juridiques. Réminiscences historiques d'avant l'ère socialiste et influences étrangères à l'heure de la mondialisation entrent dans l'élaboration en cours de ces systèmes juridictionnels.
En Angleterre, l'organisation judiciaire est fondée sur de tout autres principes. Traditionnellement, la justice y est très concentrée au sein d'une cour supérieure unique, comportant un très petit nombre de juges. Cette cour possède une compétence générale qui s'étend à tous les types d'affaires (civiles, criminelles ou administratives) devant être jugées dans tout le pays. Une cour supérieure, cependant, ne peut satisfaire à sa tâche si elle doit, en fait, connaître elle-même de toutes les affaires. Dans la grande majorité des cas, elle se borne, en conséquence, à exercer un contrôle éminent sur la manière dont la justice est rendue par des juridictions « inférieures », aux aspects très variés. Une des caractéristiques des cours inférieures est que la justice y est souvent rendue par des non-juristes, qui continuent d'exercer leur métier en dehors de ce service rendu à la communauté. La justice criminelle, en particulier, est administrée de cette manière en Angleterre tandis que les affaires commerciales sont fréquemment confiées au jugement d'arbitres. Les structures traditionnelles en matière d'administration de la justice ont dû cependant être révisées pour s'adapter aux conditions de la société moderne. On a tendu à systématiser davantage l'organisation judiciaire en diversifiant le système de la cour supérieure (High Court et Court of Appeal), en organisant, notamment pour les affaires civiles, un réseau de County Courts et en créant, pour l'application de lois variées, un grand nombre de tribunaux de types divers (Magistrates' Courts). On a dû également se résigner à faire appel, de plus en plus, à des juges de profession. Le schéma d'organisation judiciaire anglais se retrouve, avec des variantes, dans les autres pays de common law. Aux États-Unis, il est, d'une façon très originale, compliqué par la coexistence de deux hiérarchies de juridictions, les unes juridictions des États, les autres juridictions fédérales. Les juridictions fédérales, quoique réparties dans toute l'étendue du pays, ont une activité bien moindre que les juridictions des États ; mais ce sont elles qui, couronnées par la Cour suprême des États-Unis, exercent une influence déterminante sur l'orientation du droit américain par l'interprétation qu'elles donnent à la Constitution des États-Unis.
Le système des recours, mis en place dans les différents pays, varie également. L'opposition principale, en la matière, est sans doute celle qui existe entre les pays de common law et les autres, liée à la distinction qui est faite dans les premiers entre cours supérieures et juridictions inférieures. Par exemple, c'est toujours un sujet d'étonnement profond, pour le juriste continental, d'apprendre que, outre-Manche, l'appel d'un jugement n'est possible qu'avec l'autorisation d'un juge qui peut être celui-là même qui a rendu la décision. Tout se passe, en fait, comme si, dans les pays de common law, l'application du droit était chose secondaire, lorsque l'on envisage les juridictions inférieures ; l'on ne peut attendre de juges qui le plus souvent ne sont pas des juristes une application sans faille du droit ; aussi bien l'important est-il, à ce niveau, que les juges agissent honnêtement et loyalement, qu'ils ne se rendent pas coupables de misconduct. À cette manière de voir s'oppose celle des autres pays, dans lesquels l'attention est centrée sur les règles de fond du droit beaucoup plus que sur la procédure. Cette tendance est traditionnelle dans les pays de la famille romano-germanique, mais elle s'y infléchit sous l'influence, notamment, du droit au procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, l'impartialité du juge et la loyauté de la procédure devenant d'impérieux critères du « bien juger » (Antoine Garapon), sinon du bon jugement.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Loïc CADIET : agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
JUSTICE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 431 mots
Bien que les enfants aient aisément recours à l’idée de justice en qualifiant souvent spontanément d’« injustes » tous les interdits qui font obstacle à leurs désirs, la notion de justice est l’une des plus complexes et des plus ambiguës qui soient.
Deux raisons principales expliquent...
-
ALTERMONDIALISME
- Écrit par Christophe AGUITON , Encyclopædia Universalis et Isabelle SOMMIER
- 6 806 mots
- 1 média
Dans le monde anglo-saxon, en revanche, s’est développée à partir de 2003, pour finir par s’imposer, l'expression« mouvement pour la justice globale » qui met l'accent sur deux de ses caractéristiques et innovations supposées : d'une part, sa dimension transnationale ; d'autre part, son cadrage... -
ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 11 140 mots
- 8 médias
...rapport à l'infini, mais l'infini est principe pour tout le reste, qu'il « enveloppe et gouverne ». Ce « gouvernement » s'exerce dans le sens de la « justice », c'est-à-dire de l'équilibre (ou « isonomie ») entre éléments antagonistes qui, soumis à une loi commune, tournent à l'avantage du Tout ce qui... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO
- 38 895 mots
- 19 médias
Mais il ne se contente pas de mesures symboliques :tout l'arsenal juridique qui protégeait les crimes commis durant la dictature est démantelé. Il décide d'une profonde réforme de la Cour suprême. La nomination des juges est désormais soumise au débat public. En outre, tous les juges... -
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
Le livre V est consacré tout entier à la vertu dejustice. Cette vertu, qui consiste à donner à chacun son dû, peut être, dans la tradition platonicienne, définie par référence à un ordre mathématique : ainsi la justice distributive (à chacun selon son mérite) s'exprime-t-elle dans une proportion.... - Afficher les 43 références
Voir aussi
- INSTITUTIONS EUROPÉENNES
- TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- JURIDICTIONS
- POURVOI EN CASSATION
- SOCIALISTE DROIT
- TRIBUNAUX JUDICIAIRES
- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958
- AIDE JURIDIQUE
- JUDICIAIRE POUVOIR
- JUGES
- TRIBUNAL DE COMMERCE
- COMMERCE, institutions françaises
- ÉTAT DE DROIT
- COMPÉTENCE, droit
- DROIT UNIFICATION DU
- EXCEPTION TRIBUNAUX D'
- COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, anc. COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA
- TRIBUNAL D'INSTANCE
- SERVICE PUBLIC
- FRANÇAIS ANCIEN DROIT
- ARBITRAGE INTERNATIONAL
- CONCILIATION
- ANGLAIS DROIT
- CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
- ADMINISTRATIF DROIT
- RECOURS
- COLLÉGIALITÉ, droit
- AIDE JURIDICTIONNELLE
- MÉDIATION
- JURY, droit pénal
- FRANCE, droit et institutions
- DROIT, histoire
- CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
- CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- APPEL, droit
- COUR D'APPEL
- ADMINISTRATIVES JURIDICTIONS
- ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE