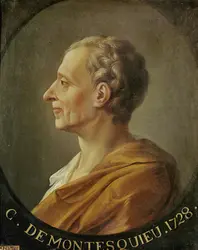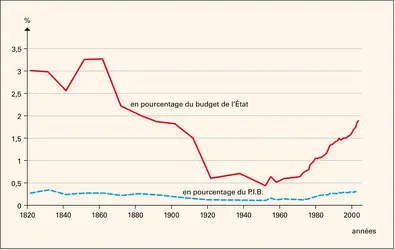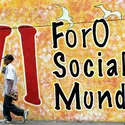JUSTICE Les institutions
Article modifié le
Tendances
Contre la thèse de l'identité de l'État et du droit, l'opinion tend à s'affirmer et s'affermir selon laquelle le droit existerait en dehors de l'État. De fait, le droit de l'État et, partant, la justice de l'État doivent faire face à deux sortes de concurrence : par le haut, en raison de la constitution progressive d'un ordre juridique supra-étatique, par le bas, en raison du développement des procédures de négociation contractuelle.
Internationalisation de la justice
Au-delà de la justice des États, une justice internationale se met progressivement en place là où la société internationale s'organise. Le développement de l'arbitrage international en matière commerciale illustre, à sa manière, cette justice extra-étatique spontanément mise en œuvre par la société des marchands, internationalisation et contractualisation de la justice combinant alors leurs effets. L'Organe de règlement des différends (O.R.D.), institué au sein de l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.) pour régler les litiges commerciaux entre États, en est un autre exemple dans l'ordre du droit international économique. Mais c'est sur le terrain plus traditionnel du droit international public que cette internationalisation de la justice a le plus acquis droit de cité, si l'on peut dire. Pourtant, cette « juridictionnalisation » des relations internationales ne va pas de soi car la justice est considérée par les États comme un attribut de leur souveraineté ; elle progresse, pourtant, au gré des conventions internationales. Il y a toutefois des degrés dans cette internationalisation (dans cette intégration ?) et l'on peut ainsi distinguer, selon un vocabulaire emprunté aux internationalistes, les juridictions à vocation universelle et les juridictions à vocation régionale.
Juridictions à vocation universelle
Les juridictions à vocation universelle ont vu le jour au lendemain de la Première Guerre mondiale. Cette origine signale leur mission : substituer le droit à la force dans la solution des conflits internationaux. La Cour permanente de justice internationale, mise en place, en 1922, par la Société des Nations, en fut la première manifestation. En 1945, l'Organisation des nations unies a succédé à la S.D.N. et la Cour internationale de justice à la Cour permanente de justice internationale. La faiblesse du droit international, dit-on, est l'absence de sanctions, qui en rend ineffectives les normes. De ce point de vue, la création par l'O.N.U., en 1993 et 1994, du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) marque un tournant dans la « juridictionnalisation » des relations internationales. Certes, ce n'était pas la première fois qu'une institution judiciaire internationale de ce type était mise en place. Si le souvenir s'est perdu du traité de Versailles, qui avait envisagé de créer un tribunal spécial pour juger l'empereur Guillaume II, en revanche, chacun garde en mémoire les procès de Nuremberg et de Tōkyō, qui permirent à des tribunaux militaires de juger les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais, avec la création de ces tribunaux pénaux internationaux, l'idée d'un « droit d'ingérence judiciaire » s'est renforcée, et le projet d'instituer une juridiction pénale internationale à vocation permanente s'en est trouvé grandement facilité. La multiplication des conflits régionaux et la recrudescence des crimes contre l'humanité qui les accompagnent a ainsi justifié la création en 1998 de la Cour pénale internationale, marquant un progrès décisif de la société internationale.
Juridictions à vocation régionale
Ce progrès est déjà plus perceptible à travers les juridictions à vocation régionale. À l'échelle planétaire, la France appartient à la région européenne et, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette région s'est organisée de deux manières.
En premier lieu, elle s'est d'abord constituée, sur les ruines de Nuremberg, en un Conseil de l'Europe au sein duquel a été élaborée la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur en 1953, la France ne l'ayant pour sa part ratifiée qu'en 1974. Sans doute cette convention est-elle directement applicable par les juridictions françaises, qui, aussi bien en matière civile que pénale, voire administrative, n'hésitent plus à en faire application. L'article 6 paragr. 1, notamment, qui consacre le droit des personnes à un procès équitable, est très souvent invoqué. Ce n'est pas à dire, toutefois, que la Convention européenne des droits de l'homme soit observée en toute hypothèse. Le respect en est alors assuré par la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg et qui peut être saisie par tout justiciable, après épuisement des voies de recours interne, afin de faire sanctionner le manquement, par un État signataire, aux droits consacrés par la Convention (art. 25). Cette sanction peut consister, pour le justiciable lésé, en une « satisfaction équitable » prenant la forme d'une indemnité mise à la charge de l'État défendeur (art. 50). La France a déjà fait l'objet, à plusieurs reprises, de condamnations de ce type (notamment à propos d'écoutes téléphoniques, de traitements inhumains ou dégradants commis par des fonctionnaires de police, de transsexualisme ou d'indemnisation des victimes de contaminations par transfusion sanguine).
La Communauté économique européenne qui, au fil des extensions et des approfondissements du mécanisme communautaire, est devenue Union européenne, témoigne, en second lieu, d'une intégration juridique et juridictionnelle plus poussée des États qui en sont membres. Hormis une Cour des comptes de la Communauté, chargée, pour l'essentiel, d'assurer le contrôle des comptes des institutions communautaires, ce système repose sur l'activité de deux juridictions. La principale est la Cour de justice des Communautés européennes, qui siège à Luxembourg. Outre ses missions consultatives, cette juridiction a surtout une fonction contentieuse qui la conduit, notamment, à connaître des questions qui lui sont posées à titre préjudiciel, au cours d'instances pendantes devant une juridiction nationale, sur l'interprétation des normes communautaires. Certes, la Cour de justice se contente de « dire pour droit » ; elle ne juge pas en fait. Mais les arrêts interprétatifs de la Cour de justice ont une autorité générale de chose jugée. Ils s'imposent, non seulement à la juridiction nationale saisie du litige qui y a donné lieu, mais plus largement à l'égard des parties à d'autres litiges devant n'importe quelle juridiction de l'ensemble des États membres. Cette compétence est essentielle car elle contribue puissamment à assurer la cohésion du droit communautaire et l'uniformisation de son interprétation par les juridictions nationales ; elle est donc un vigoureux facteur d'intégration. La Cour de justice est également juge des recours formés à l'encontre des décisions du tribunal de première instance des Communautés européenne, créé en 1988, qui jouit de compétences plus spécifiques.
Contractualisation de la justice
Pour autant, l'internationalisation de la justice ne doit pas abuser. Le « tout judiciaire » a vécu. L'époque est à la recherche de solutions amiables faites d'expertises, de conciliations, de médiations, conduisant à des transactions dont la vertu ne se limite d'ailleurs pas à la solution des litiges individuels : les conflits collectifs peuvent aussi se résoudre en transactions diverses. La loi consacre elle-même ces solutions et pas seulement en matière civile (conciliateur de justice, médiation judiciaire). Le contentieux pénal et le contentieux administratif, hauts lieux traditionnels d'une conception purement judiciaire, voire inquisitoire, du droit de la solution des litiges, n'échappent pas à la marée montante de la justice « alternative » (médiation pénale, par exemple). Cet engouement contemporain s'explique assurément par l'explosion de la demande judiciaire et l'encombrement des juridictions qui en résulte : les solutions alternatives sont autant de circuits de dérivation. Mais, dans la genèse du phénomène, l'essentiel touche plus aux structures mêmes de notre société et au système de droit qui en assure la régulation. Cette mutation est fréquemment interprétée comme le passage d'un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié ; on pourrait dire aussi d'une régulation de type autoritaire à une régulation de type conventionnel de la société, ce qu'un auteur a vulgarisé en parlant de la société contractuelle. Le déclin de la loi, qui a perdu en autorité ce qu'elle a gagné en quantité, abandonnerait ainsi à la volonté des acteurs économiques et sociaux de nouvelles plages de liberté, y compris le fait de trouver par eux-mêmes la solution de leurs différends.
Il est vrai que la justice douce, comme la médecine du même nom, présente des attraits. Il ne faut pas, pour autant, se laisser prendre au chant des sirènes. Il n'est pas certain, tout d'abord, que le mode de solution extrajudiciaire des litiges soit plus démocratique que le judiciaire. Les techniques alternatives ont elles aussi un coût qui peut conduire, là même où elles ont progressé de manière privilégiée, comme en Amérique du Nord, à un retour vers la solution judiciaire des litiges : le phénomène est constaté par exemple au Québec. D'autant que la solution amiable des litiges n'est pas nécessairement plus juste. Les modes de solution dits amiables posent en effet une question centrale qui est celle du respect des droits fondamentaux des parties, ce que l'on nomme droits de la défense dans les solutions judiciaires. Les modes alternatifs, comme l'arbitrage parfois, la conciliation et la médiation surtout, offrent peut-être l'avantage de la rapidité, celui d'être non contentieux, c'est-à-dire non violents et non formalistes. Mais les parties qui s'opposent ne sont pas forcément égales, n'ont pas forcément la même compétence technique ou la même puissance économique. Des garanties sont donc nécessaires pour prévenir ou corriger ces déséquilibres : ainsi, en amont, le respect de garanties minimales de procédure, comme le principe de la contradiction, et, en aval, le recours toujours possible au juge, seul garant de la juste distance nécessaire à l'œuvre de justice.
Dans ces conditions, si les solutions alternatives, spécialement les solutions conventionnelles, doivent être favorisées dans toute la mesure du possible, il n'est pas bon que leur développement se fasse indépendamment de l'institution judiciaire. Que ce soit dans le principe même de leur mise en œuvre ou, seulement, dans le contrôle de leur efficacité, les modes alternatifs de règlement des conflits ne sont concevables qu'articulés à la justice étatique. Tel est du reste déjà le cas en matière d'arbitrage, fut-il international, avec la procédure d'exequatur, qui confère force exécutoire à la sentence arbitrale. On ne saurait faire moins. Dans la conception du droit français, le règlement amiable des litiges ne doit pas plus exclure le recours au juge que le recours au juge ne doit exclure le règlement amiable.
Est-ce toujours justice que cette justice contractuelle ? On pourrait en douter, en l'absence d'un tiers impartial pour dire la part de chacun (suum cuique tribuere...). En vérité, l'intervention du tiers n'est que différée, le règlement amiable n'excluant pas le recours au juge, qui peut en renforcer l'autorité ou, au contraire, l'invalider. La boucle est ainsi fermée. Dans l'ordre de la solution des litiges, contrat et procès ne doivent pas s'exclure, mais se combiner. Un mauvais arrangement vaut peut-être mieux qu'un bon procès. Il est certain, en tout cas, qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Loïc CADIET : agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
JUSTICE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 431 mots
Bien que les enfants aient aisément recours à l’idée de justice en qualifiant souvent spontanément d’« injustes » tous les interdits qui font obstacle à leurs désirs, la notion de justice est l’une des plus complexes et des plus ambiguës qui soient.
Deux raisons principales expliquent...
-
ALTERMONDIALISME
- Écrit par Christophe AGUITON , Encyclopædia Universalis et Isabelle SOMMIER
- 6 806 mots
- 1 média
Dans le monde anglo-saxon, en revanche, s’est développée à partir de 2003, pour finir par s’imposer, l'expression« mouvement pour la justice globale » qui met l'accent sur deux de ses caractéristiques et innovations supposées : d'une part, sa dimension transnationale ; d'autre part, son cadrage... -
ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 11 140 mots
- 8 médias
...rapport à l'infini, mais l'infini est principe pour tout le reste, qu'il « enveloppe et gouverne ». Ce « gouvernement » s'exerce dans le sens de la « justice », c'est-à-dire de l'équilibre (ou « isonomie ») entre éléments antagonistes qui, soumis à une loi commune, tournent à l'avantage du Tout ce qui... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO
- 38 895 mots
- 19 médias
Mais il ne se contente pas de mesures symboliques :tout l'arsenal juridique qui protégeait les crimes commis durant la dictature est démantelé. Il décide d'une profonde réforme de la Cour suprême. La nomination des juges est désormais soumise au débat public. En outre, tous les juges... -
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
Le livre V est consacré tout entier à la vertu dejustice. Cette vertu, qui consiste à donner à chacun son dû, peut être, dans la tradition platonicienne, définie par référence à un ordre mathématique : ainsi la justice distributive (à chacun selon son mérite) s'exprime-t-elle dans une proportion.... - Afficher les 43 références
Voir aussi
- INSTITUTIONS EUROPÉENNES
- TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- JURIDICTIONS
- POURVOI EN CASSATION
- SOCIALISTE DROIT
- TRIBUNAUX JUDICIAIRES
- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958
- AIDE JURIDIQUE
- JUDICIAIRE POUVOIR
- JUGES
- TRIBUNAL DE COMMERCE
- COMMERCE, institutions françaises
- ÉTAT DE DROIT
- COMPÉTENCE, droit
- DROIT UNIFICATION DU
- EXCEPTION TRIBUNAUX D'
- COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, anc. COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA
- TRIBUNAL D'INSTANCE
- SERVICE PUBLIC
- FRANÇAIS ANCIEN DROIT
- ARBITRAGE INTERNATIONAL
- CONCILIATION
- ANGLAIS DROIT
- CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
- ADMINISTRATIF DROIT
- RECOURS
- COLLÉGIALITÉ, droit
- AIDE JURIDICTIONNELLE
- MÉDIATION
- JURY, droit pénal
- FRANCE, droit et institutions
- DROIT, histoire
- CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
- CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- APPEL, droit
- COUR D'APPEL
- ADMINISTRATIVES JURIDICTIONS
- ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE