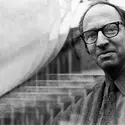JUSTIFICATION
Article modifié le
La doctrine chrétienne de la justification de l'homme par Dieu exprime à la fois l'exigence radicale que Dieu a envers l'homme et le salut radical que Dieu donne à cet homme qui ne répond pas à cette exigence. La justification maintient ainsi la justice de Dieu, qui n'a pas « pour métier de pardonner », ainsi qu'ironisait Voltaire, et elle annonce le retournement du jugement en grâce, quand Jésus-Christ meurt condamné, lui l'innocent, pour faire vivre les hommes, ses accusateurs coupables. Par sa formulation juridique abrupte, par son apparente immoralité, par le sérieux qu'elle établit dans les rapports mortellement conflictuels entre l'homme et Dieu, la doctrine de la justification est au cœur de toute la tradition théologique issue de la Bible.
La justification du pécheur consiste pour celle-ci en la description du rapport de grâce, d'une grâce active et créatrice, entre Dieu et l'homme. Être justifié, c'est être agréé par un amour qui abat l'orgueil et relève l'humilité. La justification s'oppose ainsi au légalisme, qui compte sur les mérites de l'obéissance, comme d'ailleurs au libertinisme, qui spécule sur l'inconscience ou l'impuissance de l'indulgence. La doctrine de la justification réapparaît au premier plan de la réflexion théologique dès que le christianisme risque de s'affadir en une morale de la vertu progressive ou de s'ériger en un jugement impénétrable. Augustin et Luther sont ici les deux plus grands noms de la tradition théologique occidentale. Aujourd'hui, où l'homme ne tremble plus pour son salut éternel, la doctrine de la non-justification de l'homme par lui-même garde toute son actualité, si l'on peut dire, sécularisée. Elle se manifeste, dans l'athéisme de Sartre par exemple, comme le refus de toute tentative pour justifier a priori ou a posteriori les risques de la liberté et comme une modeste invitation à agir, sans prétendre se sauver soi-même.
Les sources bibliques
Le sens classique du mot « juste » désigne celui qui accomplit les actes vertueux que lui indique sa raison délibérative et qui observe ainsi les lois établies et l'égalité souhaitable. « Nous appelons juste, dit Aristote, ce qui est susceptible de créer ou de sauvegarder, en totalité ou en partie, le bonheur de la communauté politique » (Éthique à Nicomaque, V, 13). Le juste connaît le bien et s'habitue à le pratiquer. Il trouve par là sa véritable nature, sa finalité et son équilibre. Il ne redoute rien d'autre que de ne pas vivre à hauteur de lui-même. Il habite dans une « lumière d'estime », qui lui épargne l'humiliation de soi comme la présomption. Il rend à chacun et à chaque chose ce qui lui est dû. Il conforme sa conduite à sa connaissance et sa connaissance au bien qui l'oriente. La justice dans une telle perspective apparaît bien comme la vertu des vertus, mais la justification n'a pas de place ici.
Pour comprendre comment le mot grec dikaiosunè (justice) a pu être traduit par justificatio, il faut recourir à un autre contexte, celui de l'Ancien Testament. Là se trouve l'idée fondamentale selon laquelle la justice n'est pas estime de soi, mais relation de l'homme à celui qui le juge, c'est-à-dire à Dieu. L'homme est soit trouvé injuste, soit déclaré juste. Le juste n'est plus ici l'homme vertueux ni l'homme transformé par une expérience initiatique, mais l'homme confronté à la barre d'un tribunal avec celui qui l'accuse (l'accusateur est un des noms du diable, du diabolos, du diviseur entre l'homme et Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament ; voir Job, i, 6-11 ; Zach., iii, 1 ; Apoc., xii, 10) comme avec celui qui le juge en juste juge : Dieu son créateur et son défenseur. Cette parabole juridique est essentielle pour comprendre la notion biblique de justification. Par juridique, il faut entendre ici non l'application impersonnelle de sentences statiques, mais l'atmosphère tendue et dramatique d'un procès vivant, où la conviction n'est pas faite d'emblée, où les vies sont à plaider, où le verdict, encore incertain, changera cependant tout, où, par suite, l'homme accepte de comparaître à la convocation judiciaire de Dieu, tout comme Dieu accepte de comparaître à la contestation protestataire de l'homme. Ainsi le Livre de Job raconte à la fois la justification par Dieu d'un homme, réputé coupable, et la mise en accusation par l'homme d'un Dieu, qui apparaît injuste. La justification est fondamentale pour l'homme de la Bible. Nul ne peut vivre s'il se sait réprouvé, désavoué par son Dieu, qui détourne sa face de lui. La relation avec Dieu fait l'obscurité de l'existence ou sa gloire. C'est en ce sens une relation d'amour intense, qui ne saurait s'affaiblir en indulgence, toujours signe d'indifférence secrète. Les institutions de l'Ancien Testament (sacrifices d'expiation, déclarations de pureté par le prêtre, actes symboliques des prophètes) sont marquées par cette dramatisation du rapport avec Dieu, que l'on peut offenser et courroucer comme un amant bafoué, mais que l'on recherche aussi comme celui dont la joie rendra le bonheur de vivre.
Dans le Nouveau Testament, la justification garde la même signification. Deux faits y rendent encore plus radicale la tension d'amour judiciaire entre Dieu et son peuple. Tout d'abord, Jésus-Christ manifeste le verdict de Dieu sur l'humanité. Ni les juifs religieux, avec leur obéissance à la loi, ni les païens non religieux, suivant la voie de leur conscience, n'accomplissent la justice à l'égard de Dieu, déclare Paul au début de l'Épître aux Romains. Le verdict est donc jugement sur l'humanité totale. Personne ne peut se justifier devant Dieu. Mais, second fait, « l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi » (Épître aux Romains, iii, 28), c'est-à-dire l'homme croit que Jésus-Christ lui fait cadeau d'une justice étrangère à sa possession. La foi reconnaît que le salut vient par la grâce et non par le mérite, par la réception et non par l'acquisition. La justice, qui vient de Dieu, c'est la justification du pécheur.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André DUMAS
: pasteur, président du journal
Réforme
Classification
Autres références
-
AUGUSTINISME
- Écrit par Michel MESLIN et Jeannine QUILLET
- 5 574 mots
C'est essentiellement autour du problème de lajustification que, au xvie siècle, se sont affrontés théologiens catholiques et réformés. Contre une Église qui leur paraît laxiste et corrompue, les réformateurs Luther, Calvin, Zwingli interprètent l'enseignement de l'apôtre Paul... -
GRÂCE
- Écrit par Georges CASALIS
- 4 086 mots
...par sa propre piété, de telle sorte que la fin de cette religion est la glorification aveugle et vaine du bien-pensant, Paul oppose le message radical de la justification par grâce, par le moyen de la foi( Eph., ii, 7-8) : la justification, c'est le rétablissement d'une relation véritable avec Dieu et... -
KUHN THOMAS (1922-1996)
- Écrit par Alexis BIENVENU
- 2 882 mots
- 1 média
D'abord,Kuhn récuse la distinction de principe entre contexte de justification et contexte de découverte, défendue explicitement par Hans Reichenbach dans Experience and Prediction, et caractéristique de l'empirisme logique en général. La description du fonctionnement de la science montre en... -
LUTHER MARTIN (1483-1546)
- Écrit par Martin BRECHT et Pierre BÜHLER
- 11 988 mots
- 5 médias
...principe théologique. Il faisait ressortir la contradiction existant avec les nombreuses prescriptions ecclésiastiques, qui réglementaient la vie religieuse. Le pape lui-même n'était pas autorisé à prescrire ce qui s'oppose à la Bible et à la doctrine de la justification par la foi, qui en... - Afficher les 10 références
Voir aussi