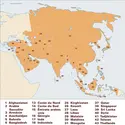KAZAKHSTAN
| Nom officiel | République du Kazakhstan |
| Chef de l'État et du gouvernement | Kassym-Jomart Tokaïev - depuis le 20 mars 2019 |
| Capitale | Astana |
| Langue officielle | Russe , Kazakh |
| Population |
20 330 104 habitants
(2023) |
| Superficie |
2 724 900 km²
|
Article modifié le
Histoire
La maîtrise des steppes
La taille immense et les paysages variés du Kazakhstan écartent la possibilité d'une culture préhistorique unifiée couvrant l'ensemble de la zone. La culture d'Andronovo de l'âge du bronze (iie millénaire avant notre ère) s'étendait sur une grande partie du pays actuel ; elle fut suivie d'une période de domination de peuples nomades, producteurs d'un « art animalier » et plus tard identifiés aux Scythes. On ne peut que spéculer sur les identités ethniques et linguistiques de ces populations ; qu'elles fussent turques ou non, on ne peut les relier directement aux Kazakhs.
Au cours des siècles, diverses parties du Kazakhstan furent incorporées dans différents empires. Sous l'Empire mongol (xiii-xive siècle après J.-C.), la majeure partie du pays appartenait à l'ulus (le territoire) des Djaghataïdes. Vers 1465, sous la conduite de Karay et de Jani Beg, quelque deux cent mille sujets mécontents du khan ouzbek Abilkhaïr émigrèrent au Mogholistan, dont le khan, Esen Buga, les installa entre les rivières Talas et Tchou, au sud-ouest du lac Balkhach. Ces séparatistes ouzbeks furent appelés Ouzbeks kazakh (« indépendants » ou « vagabonds ») et, avec les siècles, une différence significative apparut entre eux et les autres Ouzbeks, quant à leurs modes de vie respectifs : les Kazakhs étaient plutôt nomades et les Ouzbeks, plutôt sédentaires.
À la fin du xve siècle et tout au long du xvie siècle, les Kazakhs furent capables de consolider un empire nomade qui s'étendait à travers les steppes situées à l'est de la Caspienne et au nord de la mer d'Aral, jusqu'au cours supérieur de la rivière Irtych et aux contreforts occidentaux de l'Altaï. Sous les règnes de Burunduk Khan (1488-1509) et de Kasym Khan (1509-1518), les Kazakhs étaient virtuellement maîtres de toute la région des steppes, censés être en mesure de réunir deux cent mille cavaliers et redoutés de tous leurs voisins. Selon l'avis le plus répandu, le règne de Kasym Khan marqua le début d'un État kazakh indépendant. Son pouvoir s'étendait du sud-est de l'actuel Kazakhstan jusqu'à l'Oural.
Cependant, sous les règnes successifs de trois des fils de Kasym Khan (1518-1538), l'autorité du khan connut un affaiblissement partiel et le khanat en vint à se diviser en trois « hordes » distinctes. Ce furent, d'est en ouest, la Grande Horde, au sud-est de l'actuel Kazakhstan et au nord du Tianshan ; la Horde moyenne, dans la région centrale des steppes, à l'est de la mer d'Aral ; et la Petite Horde, entre la mer d'Aral et le fleuve Oural. Dans chaque horde, l'autorité du khan était en partie restreinte par le pouvoir des chefs de tribu, appelés sultans, et peut-être plus encore par celui des beys et batyrs (qui étaient à la tête des clans dont les tribus étaient constituées). En théorie, les khans commandaient une redoutable force de cavalerie, mais, en pratique, ils dépendaient de la loyauté de ces beys et batyrs. Le dernier fils de Kasym Khan qui régna sur les steppes kazakhes, Haqq Nazar (1538-1580), surmonta ces obstacles et, après avoir réussi à unifier les trois hordes, s'engagea dans des raids systématiques en Transoxiane, qui se poursuivirent sous ses successeurs immédiats, jusqu'à Tevkkel Khan (1586-1598), qui occupa temporairement Samarkand. Au début duxviie siècle, le processus de fragmentation stoppé par Kasym Khan reprit pour devenir endémique : le pouvoir central kazakh se retrouvait faible, voire inexistant au sein d'une pléthore de petits souverains.
Des années 1680 aux années 1770, les Kazakhs furent impliqués dans une série de guerres avec les Oirats, une fédération de quatre tribus mongoles occidentales, parmi lesquelles les Djoungars étaient particulièrement agressifs. En 1681-1684, ces derniers, conduits par leur souverain Galdan, lancèrent une attaque dévastatrice contre la Grande Horde. L'unification des trois hordes par Teüke Khan (1680-1718) provoqua un renversement temporaire de fortune dans les affrontements et, en 1711-1712, une contre-offensive kazakhe pénétra profondément en territoire djoungar. Les succès de Teüke ne se limitèrent pas au champ de bataille ; il fut également à l'origine de la création d'un code de lois kazakh, mélange de coutumes indigènes et de lois islamiques.
En 1723, le successeur de Galdan, Tsewang-rabdan, passait à nouveau à l'attaque. Secondés par des officiers suédois qui avaient été faits prisonniers par les Russes à la bataille de Poltava (1709) et s'étaient retrouvés dans ces contrées éloignées, les Djoungars se lancèrent dans une invasion destructrice des terres kazakhes orientales. Le souvenir de cette catastrophe nationale, le Grand Désastre, ne s'est jamais estompé chez les Kazakhs. La suivante et dernière invasion des Djoungars toucha la Horde moyenne, mais, grâce aux compétences du khan de cette horde, Abilkhaïr (1718-1749), qui réussit à forger une alliance kazakhe temporaire, elle fut moins dévastatrice. La délivrance ultime du fléau djoungar vint de l'intervention chinoise (mandchoue) : en 1757-1758, l'empereur Qianlong lança deux grandes campagnes au cours desquelles les Djoungars furent peu ou prou exterminés et où leur territoire fut incorporé à la Chine. Pendant un temps, le rusé Abylaï Khan, de la Horde moyenne, avait préféré ne pas prendre parti dans le conflit sino-djoungar. Mais, une fois que les jeux furent faits, Abylaï jugea prudent d'offrir sa soumission à l'empereur Qianlong. Par la suite, en 1771, Abylaï fut confirmé comme souverain à la fois par les Russes et par les Chinois. Du fait de la chute de l'empire djoungar, les Chinois héritaient d'un vaste territoire qui s'étendait jusqu'au lac Balkhach et au-delà, loin dans la steppe kazakhe. Le plus gros des guerres djoungares fut supporté par la Grande Horde ; le choc fut moins rude pour les Petite et Moyenne Hordes, en partie parce qu'elles se déplacèrent à l'ouest, vers des territoires tenus par les Russes. Au début des années 1730, Abilkhaïr, khan de la Petite Horde, prêta allégeance à l'impératrice russe Anna Ivanovna.
Souverainetés russe et soviétique
Les revers essuyés par les Kazakhs aux prises avec les Oirats retardèrent sans aucun doute l'émergence d'un État kazakh unifié et firent même décliner le niveau général de la vie culturelle. Ils rendirent également les Kazakhs moins capables encore de résister aux empiètements de la Russie depuis le nord. La progression vers la steppe kazakhe débuta par la construction d'une ligne de forts – Omsk en 1716, Semipalatinsk en 1718, Oust-Kamenogorsk en 1719-1720 et Orsk en 1735 – qui fut ensuite continûment prolongée vers le sud. L'avancée russe était lente, rarement violente, mais inéluctable ; elle exploitait pleinement les divisions internes et les dissensions entre les Kazakhs, mais, dans son essence, elle représentait le type même de l'empiètement d'agriculteurs sédentaires sur des territoires appartenant à des nomades. L'occupation de la steppe kazakhe par les Russes se révélerait essentielle pour la conquête de l'Asie centrale musulmane.
Certains Kazakhs pensaient que la présence russe garantirait au moins une certaine sécurité face aux raids oirats et l'allégeance de la Petite Horde à la Russie fut suivie par celle de la Horde moyenne en 1740 et par une partie de la Grande Horde en 1742, même si les effets de cette protection sur les Oirats devaient s'avérer limités. Finalement, après une série de soulèvements kazakhs infructueux, dont le plus important fut celui de Batyr Srym en 1792-1797, la Russie résolut de supprimer le reste d'autonomie que les khans possédaient encore. En 1822, le khanat de la Horde moyenne fut aboli ; en 1824, celui de la Petite Horde ; et, en 1848, celui de la Grande Horde.
À la suite de l'incorporation du Kazakhstan à la Russie, les idées modernes trouvèrent un terreau plus fertile chez les Kazakhs que dans les khanats ouzbeks semi-indépendants. La scolarisation russe introduisit ces idées dans la vie kazakhe, et des intellectuels formés à l'école russe, tels Tchokan Valikanov et Abay Kunanbay-Ulï, les adaptèrent aux besoins locaux spécifiques pour créer une culture laïque sans équivalent dans le reste de la Russie asiatique.
Les Kazakhs furent témoins, plutôt que participants, dans la guerre civile qui suivit la chute du régime tsariste en 1917. Un gouvernement provisoire kazakh, formé par l'éphémère parti politique Alash Orda, n'eut qu'une existence nominale. En 1919-1920, l'Armée rouge vainquit les forces des Russes blancs dans la région et occupa le Kazakhstan. Le 26 août 1920, le gouvernement soviétique établit la République autonome kazakhe qui, en 1925, devint la République socialiste soviétique autonome du Kazakhstan. À partir de 1927, le gouvernement des soviets mena une politique vigoureuse de transformation des nomades kazakhs en population sédentaire et de colonisation de la région par des Russes et des Ukrainiens.
En dépit de leur existence nomadique rurale, les Kazakhs constituaient la population indigène la plus instruite et la plus dynamique d'Asie centrale. Mais la collectivisation brutalement imposée par le régime soviétique eut pour conséquence une baisse dramatique de la population : entre 1926 et 1939, le nombre de Kazakhs en Union soviétique chuta d'environ un cinquième. Plus de 1,5 million d'entre eux moururent au cours de cette période, la majorité de faim et des maladies associées, les autres par suite de violences. Des milliers de Kazakhs s'enfuirent en Chine, mais moins d'un quart d'entre eux survécurent au voyage ; environ 300 000 partirent en Ouzbékistan et 44 000 au Turkménistan.
Le Kazakhstan devint officiellement une république constitutive de l'U.R.S.S. le 5 décembre 1936. Sous la direction du Premier secrétaire Nikita Khrouchtchev, le rôle du Kazakhstan au sein de l'Union soviétique connut un développement dramatique. Le programme Terres vierges et inoccupées, lancé en 1954, ouvrait les vastes pâturages du nord du pays à la culture du blé par des colons slaves. L'importance du Kazakhstan augmenta également du fait de l'implantation sur son territoire du principal centre spatial soviétique, à Baïkonour, ainsi que d'une grosse part de l'arsenal nucléaire de l'U.R.S.S. et des sites associés à l'expérimentation atomique.
Pendant un quart de siècle, la politique kazakhe fut dominée par Dinmoukhamed Kounaïev, Premier secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan de 1959 à 1986. Unique Kazakh à devenir membre du Politburo soviétique, Kounaïev se révéla être non seulement un politicien soviétique compétent, mais aussi un homme capable de projets constructifs pour son pays. Conscient que ses compatriotes constituaient une minorité au sein de la population du Kazakhstan, il veilla avec un soin égal aux besoins des Russes et des Kazakhs. Sa révocation, en 1986, par le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev provoqua les premières émeutes sérieuses des années 1980 en U.R.S.S.
L'effondrement politique et économique de l'U.R.S.S. au tournant des années 1990 conduisit les républiques non russes à déclarer leur indépendance. Le Kazakhstan proclama sa souveraineté le 25 octobre 1990 et son indépendance complète le 16 décembre 1991.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Isabelle OHAYON : docteure en histoire, chargée de recherche au CNRS
- Arnaud RUFFIER : anthropologue, chercheur à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale
- Denis SINOR : professeur émérite d'études ouraliennes et altaïques, professeur d'histoire à l'université d'Indiana, Bloomington
- Julien THOREZ : docteur en géographie, chargé de recherche au C.N.R.S., membre de l'U.M.R. 7528 Monde iranien et indien (C.N.R.S., Sorbonne nouvelle, EPHE, INALCO)
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
KAZAKHSTAN, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
ALMATY ou ALMA-ATA, anc. VIERNYÏ
- Écrit par Pierre CARRIÈRE
- 311 mots
- 1 média
Appelée Viernyï jusqu'en 1921, la ville d'Almaty (nommée Alma-Ata pendant la période soviétique), ville principale de la république du Kazakhstan, située au pied des monts Ala-Taou, sur le cône de déjection construit en commun par la Grande et par la Petite Almaatinka, comptait 1,5...
-
ARAL MER D'
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Yves GAUTIER
- 2 373 mots
- 1 média
Partagé par la frontière entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud, la mer d'Aral occupe, au milieu de déserts sableux, une partie basse de la dépression touranienne ou aralo-caspienne ; elle a communiqué avec la mer Caspienne jusqu'à une époque géologique récente (quelques...
-
ASIE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Louis DUBERTRET , Encyclopædia Universalis et Guy MENNESSIER
- 7 936 mots
...le bouclier précambrien de l'Aldan. Les plissements calédoniens se trouvent à l'ouest où ils dessinent un V ouvert vers le nord-ouest (partie ouest du Kazakhstan central et chaînons septentrionaux du Kazakhstan). On y trouve de grands anticlinoriums à noyau précambrien, séparés par des synclinoriums... -
ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique
- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL
- 34 880 mots
- 8 médias
Partout, les sables tiennent une grande place, la topographie variant selon qu'ils sont fixés par la végétation ou demeurent libres.Dans les secteurs les moins arides, Betpak-Dala et Semiretché kazakhes, les sables sont retenus par l'uvette ou l'erkek ou, même, le saxaoul. Le Kyzyl-Koum ne présente... - Afficher les 22 références
Voir aussi
- RUSSIE FÉDÉRATION DE
- ALMA-ATA ACCORDS D' (déc. 1991)
- RUSSE LANGUE
- RUSSIE FÉDÉRATION DE, économie
- NAZARBAÏEV NOURSOULTAN (1940- )
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS
- DZOUNGARS ou DJOUNGARES ou JÜNGAR
- KHAN
- PAUVRETÉ
- DOUANIÈRE UNION
- STEPPE
- SÉDENTARISATION
- COMPAGNIES PÉTROLIÈRES
- KAZAKH
- ALA-TAOU ou ALATAU
- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911
- CHINE, économie
- ASTANA, anc. NOURSOULTAN
- OPPOSITION POLITIQUE
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- RÉPRESSION
- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE
- CEI (Communauté des États indépendants)
- RUSSIE, histoire, des origines à 1801
- URSS, histoire
- PRIVATISATION
- PAYS ENCLAVÉS
- CORRUPTION
- EXPLOITATION PÉTROLIÈRE
- PÉTROLIÈRE PRODUCTION
- KAZAKH, langue