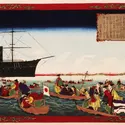KYŌTO
Article modifié le
La ville moderne : Kyōto du XVIe au XIXe siècle
Si le découpage en périodes historiques tel qu'il est communément admis fait aller la période moderne du Japon de 1573 à 1868, il faut faire remonter la formation de la ville moderne à la fin du xve siècle. Après les onze années des troubles de l'ère Ōnin (1467-1477), l'essentiel de la ville avait été réduit en cendres par les armées de l'Est et de l'Ouest qui avaient pris Kyōto comme champ de bataille. La paix revenue, le bakufu ne fit pas reconstruire les anciennes voies. Au milieu des terres ravagées, les habitants se regroupèrent dans les deux agglomérations subsistantes, au nord et au sud, et rebâtirent les quartiers et les rues selon leurs besoins propres. La ville ne ressemblait plus à l'ancienne capitale. La population avait diminué, avoisinant sans doute les 100 000 habitants. Dans la ville haute, le palais était situé à Tsuchimikado (emplacement actuel), à proximité des maisons de guerriers et de nobles de cour. Ces demeures, de dimensions considérablement réduites, étaient désormais implantées au milieu de quartiers d'artisans et de commerçants. La ville basse devenait quant à elle le cœur économique de la nouvelle Kyōto. La densité y était plus forte et les riches commerçants s'y étaient installés.
Si l'antique quartier de l'époque Heian avait été un ensemble compact, ceint d'un mur et de larges avenues, le nouveau quartier urbain (que l'on nomme désormais machi), s'ouvrait complètement sur des ruelles étroites, centres animés de la ville moderne. Le quartier n'était plus désigné par un numéro de cadastre mais par un toponyme lié à son activité économique ou à un fait marquant de la mémoire collective. Les ruelles étaient bordées le plus souvent de boutiques, espaces semi-publics qui constituaient une zone tampon entre la rue et l'espace privé de l'intérieur des îlots où l'on pouvait trouver des équipements communs comme un puits, un bain ou un potager.
Le processus d'unification du pays réalisé à cette époque par les militaires et le renforcement du pouvoir politique à l'échelle du territoire furent accompagnés, tout au long des xvie et xviie siècles, par un durcissement de l'autorité politique sur l'espace urbain de Kyōto. Les grands travaux entrepris sous l'égide de Toyotomi Hideyoshi et la planification urbaine poursuivie par ses successeurs furent menés à terme contre le pouvoir populaire, les institutions religieuses et les aristocrates. Ils modifièrent les liens qu'avaient tissés entre les citadins les anciens modes d'occupation spatiale.
En 1586, Toyotomi Hideyoshi programme la construction d'une vaste résidence, Jūraku-dai, autour de laquelle sont regroupées les demeures de ses seigneurs (daimyō). Débute alors la transformation de la ville en jōkamachi, ou « ville sous le château », et la mise en place d'une nouvelle typologie urbaine.
Durant les années 1590-1591, quatre étapes marquèrent l'évolution de l'urbanisme à Kyōto. D'abord, les anciens quartiers carrés furent systématiquement divisés par une rue centrale qui permit l'occupation de l'espace vide de l'intérieur des îlots ; des échoppes y furent installées, et les façades sur rue furent ainsi multipliées ; les institutions bouddhiques furent déplacées à la périphérie est de la ville, sur la rive droite de la Kamo (c'est la création du quartier de Tera-machi). En 1591, une enceinte de terre (odoi) longue de 22,5 kilomètres fut bâtie autour de la ville ; elle avait pour fonction de la protéger contre d'éventuelles attaques, de contenir les crues de la rivière Kamo, tout en affirmant davantage l'image de la « ville sous le château » de Toyotomi. L'exemption de la rente foncière pour les domaines intra-muros, sur laquelle avait été établi le pouvoir des nobles de cour, des temples et des sanctuaires, favorisa le dynamisme des quartiers populaires tout en rendant possible l'urbanisation de nouvelles terres. Enfin, le percement du canal Takase contribua au développement économique de la ville en facilitant les communications fluviales avec Ōsaka.
La politique mise en place par les Tokugawa au début du xviie siècle s'est faite dans la continuité des actions entreprises par Hideyoshi. En 1602, Ieyasu imposa à ses daimyō la construction d'un palais à Nijō-Horikawa (l'actuel château de Nijō) qui devait accueillir les cérémonies qui allaient consacrer l'entente de la cour et du bakufu. Les affaires locales furent administrées sous l'autorité d'un gouverneur (shoshidai) de Kyōto, dont le rôle majeur était de soumettre la cour, les nobles de cour et les citadins à l'autorité des Tokugawa. Quant à la politique de planification urbaine, elle visa à faire de la capitale un espace organisé d'après l'ordre nouveau des statuts sociaux, et l'évolution des quartiers dut subir les effets d'une relative discrimination : les temples bouddhiques furent regroupés, les aristocrates rassemblés peu à peu autour du palais impérial, et, en 1640, un décret imposa l'édification d'un quartier réservé (yūkaku) afin de mieux contrôler l'ordre public : le quartier de Shimabara fut construit à la périphérie de la ville et les prostituées de plusieurs quartiers y furent regroupées et enfermées derrière de hauts murs. En 1715, 1 583 personnes y travaillaient, dont 549 prostituées. Il subsistera jusqu'en 1958, date de la loi prohibant la prostitution.
Bénéficiant des conséquences de la paix, l'accroissement de Kyōto sera rapide, à l'instar de celui d'Edo et d'Ōsaka. À la fin du xviie siècle, la population s'était fortement accrue. Les bases de la prospérité sont l'industrie touristique, le tissage de Nishijin et la production artisanale. Les grands marchands d'étoffes de kimono se développent, comme la maison Echigo-ya (les Mitsui) ; il se forme de puissantes corporations de marchands qui vont s'engager bientôt dans les prêts aux daimyō.
L'actuel palais impérial (Kyōto gosho), situé dans l'arrondissement de Kamigyō, fut construit en 1855, à peu près à l'emplacement des anciennes propriétés qu'avait occupées l'empereur depuis le xiiie siècle. Il reprend les caractéristiques du style d'architecture (shinden-zukuri) des anciens palais aristocratiques. Il est protégé par une enceinte de pisé sur sa face sud comportant une porte à usage cérémoniel, la Kenrei-mon. Un Shishin-den (Palais de l'Étoile Polaire), un Seiryō-den (Palais de Pureté et de Fraîcheur), ainsi que des édifices secondaires, des cours et des jardins y ont été construits comme dans l'antique palais.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Nicolas FIÉVÉ : docteur ès lettres en études de l'Extrême-Orient, architecte D.P.L.G., chargé de recherche au C.N.R.S.
- Raphaël LANGUILLON-AUSSEL : docteur agrégé de géographie
Classification
Médias
Autres références
-
JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire
- Écrit par Paul AKAMATSU , Vadime ELISSEEFF , Encyclopædia Universalis , Valérie NIQUET et Céline PAJON
- 44 411 mots
- 52 médias
...alors une grande popularité en Chine, le Tiantai (en japonais Tendai) et le Zhenyan (en japonais Shingon), et déplaça la capitale à Heiankyō, l'actuelle Kyōto, inaugurant ainsi en 794 une nouvelle période de l'histoire japonaise. On désigne sous le nom d'époque Heian (Heian jidai), d'une... -
JAPON (Arts et culture) - Les arts
- Écrit par François BERTHIER , François CHASLIN , Encyclopædia Universalis , Nicolas FIÉVÉ , Anne GOSSOT , Chantal KOZYREFF , Hervé LE GOFF , Françoise LEVAILLANT , Daisy LION-GOLDSCHMIDT , Shiori NAKAMA et Madeleine PAUL-DAVID
- 56 194 mots
- 35 médias
À Heian-kyō, le carroyage urbain dessine des îlots carrés de 120 mètres de côté et une propriété occupe, selon le rang et la fortune, un quart, une moitié ou la totalité d'un îlot ; parfois deux, voire quatre îlots pour les plus fortunés. Chaque propriété est ceinte d'un mur en pisé, percé d'une porte... -
JARDINS "SECS", Kyōto (Japon)
- Écrit par Alain THOTE
- 185 mots
- 1 média
Courant religieux venu de Chine à partir du milieu du xiiie siècle, le bouddhisme chan (zen) a inspiré le développement de plusieurs formes d'art au Japon, comme la cérémonie du thé (chanoyu), l'arrangement floral (ikebana) ou la peinture monochrome. Parmi elles, mais de création...
-
KANSAI ou KINKI
- Écrit par Raphaël LANGUILLON-AUSSEL
- 1 022 mots
- 1 média
Grande rivale culturelle du Kantō, le Kansai, aussi appelé parfois Kinki ou Kinai, est une région située au centre de l'île japonaise de Honshū. D'une superficie de 33 108 kilomètres carrés, elle est composée de sept départements (Kyōto, Osaka, Hyōgo, Nara, Shiga, Wakayama et...
Voir aussi