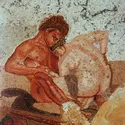ARÉTIN L' (1492-1556)
Article modifié le
Pietro Aretino, dit l'Arétin, conteur et polémiste, hagiographe aussi et auteur dramatique, est né à Arezzo en 1492 et mort à Venise en 1556. Il est le fruit de la mésalliance d'une jeune bourgeoise, Tita (ou Margherita) Del Boncio, avec un cordonnier prénommé Luca. Ce dernier, à une date difficile à préciser, quitte Arezzo « pour aller s'enrôler dans la milice », laissant son épouse seule avec ses trois enfants, dont Pierre était l'aîné : abandon de famille dont on ignore les causes exactes – peut-être une liaison de Tita avec le noble Luigi Bacci chez qui elle avait vraisemblablement rempli les fonctions de nourrice – mais qui est sûrement à l'origine du mépris que le jeune Pierre vouera sa vie durant à son père, refusant de porter son nom et ne consentant jamais à lui envoyer le moindre secours.
Une vie aux cent actes divers
Vers sa quinzième année, l'Arétin quitte Arezzo et se rend à Pérouse, où il acquiert, au cours d'un apprentissage sans lendemain, les connaissances théoriques en matière de peinture qui feront de lui, plus tard, un critique averti, écouté des plus grands maîtres. C'est là, surtout, qu'il s'essaie pour la première fois à la poésie pétrarquisante alors à la mode, publiant en 1512 un recueil de vers sans originalité mais suffisant à démentir la légende persistante d'un Arétin parfaitement ignare.
Après un séjour d'une dizaine d'années à Pérouse, il se rend à Sienne, où enseigne un de ses oncles maternels, puis à Rome où il aborde une carrière de courtisan au service du richissime banquier siennois Agostino Chigi. Beau parleur, truculent, c'est alors que « messire Pierre » acquiert cette réputation de joyeux compagnon, et aussi de mauvaise langue, qui le suivra jusqu'à la fin de ses jours.
Lorsque meurt le pape Léon X, en 1521, il se lance à corps perdu dans la campagne pour la candidature au pontificat de son nouveau protecteur qui est, depuis la mort de Chigi, survenue en 1520, le cardinal Jules de Médicis. S'il n'a pas inventé les pasquinades, ces sonnets satiriques placardés sur une statue mutilée baptisée Pasquino, son agressivité et le soin qu'il prend de sa réclame ne tardent pas à l'imposer comme le colporteur de ragots – souvent fondés – et l'interprète des récriminations populaires. L'insolence de ses propos est telle qu'à l'arrivée du pape « barbare » Adrien VI, ancien précepteur de Charles Quint, que le conclave a préféré à Jules de Médicis, l'Arétin est contraint de déguerpir.
De Rome il se rend à Bologne, Arezzo, Florence, puis à Mantoue où le marquis Frédéric de Gonzague, séduit par sa faconde, le comble de faveurs et manifeste le désir d'orner sa cour d'« un si précieux joyau ». Pourtant, au bout de deux mois, Pierre quitte Mantoue pour Reggio où séjourne Jean des Bandes Noires. Conquis par l'atmosphère de bamboche et de paillardise qui règne dans l'entourage de ce condottiere issu de la famille des Médicis, il s'attarde à ses côtés et ne rentre à Rome qu'à la fin de 1523, après la mort d'Adrien VI et l'accession au pontificat du cardinal de Médicis sous le nom de Clément VII. Ce second séjour à la cour, interrompu seulement par un bref voyage dans le Nord au cours duquel Jean des Bandes Noires le présente à François Ier, va être décisif pour la carrière de l'Arétin.
Comblé de présents par le nouveau pape, il ne réussit cependant pas à jouer le rôle auquel il aspire, et rencontre bientôt un adversaire irréductible en la personne du dataire Giberti, chef du parti pro-français et véritable maître de la politique pontificale. Il se heurte à lui une première fois, lorsque, non content d'avoir intrigué pour faire libérer Marcantonio Raimondi, emprisonné par le dataire pour avoir gravé des dessins obscènes du peintre Jules Romain, il écrit par bravade seize Sonnets luxurieux au bas des seize gravures. Puis, au cours des premiers mois de 1525, il compose sa première comédie, la Cortigiana, une charge contre la cour et les grands, et prend la défense des auteurs de pasquinades contre les rigueurs de la censure du dataire. L'animosité croissante entre Giberti et l'Arétin trouve son épilogue dans l'agression dont ce dernier est victime le 28 juillet 1525. Survivant miraculeusement à ses blessures, Pierre implore en vain la justice pontificale contre son agresseur, un serviteur du dataire ; beaucoup voient en celui-ci le véritable instigateur de l'attentat. Force lui est d'abandonner Rome au mois d'octobre suivant, sans avoir obtenu réparation, pour rejoindre son ami Jean des Bandes Noires. Mais la mort de ce dernier, un an plus tard, le prive une nouvelle fois de protecteur. Après un second séjour de quelques mois à Mantoue, il s'enfuit à Venise au début de 1527, craignant – à juste titre – que le marquis Frédéric de Gonzague ne le fasse tuer pour se concilier les faveurs du pape.
C'est à Venise que l'Arétin va, à trente-cinq ans, refaire sa vie et s'installer définitivement. Ami de l'architecte et sculpteur Jacopo Sansovino et de Titien, il ne tarde pas à avoir ses entrées dans nombre de maisons vénitiennes ; il se ménage les bonnes grâces des dirigeants de la Sérénissime et du doge lui-même, qui ne dédaignent pas, semble-t-il, les informations et l'aide polémique que peut leur apporter, en échange de leur hospitalité, la plume redoutée de celui que tout le monde appelle désormais le « Fléau des princes ».
Fort de cette protection, l'Arétin peut répandre à loisir les pamphlets qui feront sa fortune. Dans ses poésies satiriques et ses Pronostici (parodie burlesque des « pronostications » en honneur à l'époque), il s'attaque avec violence aux princes et aux souverains qui ne se résolvent pas à acheter son silence, et ne tarde pas à recueillir les fruits de ses diatribes : François Ier, entre autres, lui fait don en 1533 d'une somptueuse chaîne d'or, et Charles Quint, en 1536, lui octroie une pension de deux cents ducats. C'est alors que, la renommée aidant, Pierre entame une correspondance suivie avec des gens de toutes conditions, sur tous les sujets, politiques, littéraires et autres. Se proclamant sans vergogne le « rédempteur de la vertu », le « détenteur des secrets du monde », il devient ainsi l'arbitre des renommées, gagnant – et dépensant – plus que la plupart des princes de son temps.
À partir de 1537, sa demeure est devenue le rendez-vous de tout ce que Venise et l'Europe comptent de célébrités ; hommes de lettres, artistes, ecclésiastiques de tous rangs, soldats de tous grades, ambassadeurs, princes de passage défilent sans cesse chez le « divin Arétin ». Chez lui se retrouvent aussi courtisanes, gondoliers et mendiants, car il gaspille autant qu'il reçoit. Il mène un train de vie princier, entouré de nombreux serviteurs et de ces « arétines », servantes et maîtresses tout à la fois, dont l'une lui donnera deux filles. Il protège la veuve et l'orphelin, aide les indigents ou les exilés en difficulté, trouve des mécènes pour les artistes, des couvents pour les pécheresses repenties, arbitre les querelles de famille, conseille les jeunes gens et les place dans toutes les cours d'Europe, où ils vont grossir le nombre de ses informateurs ambassadeurs de sa renommée.
S'il se fait beaucoup d'ennemis, nombreux et non des moindres sont les grands qui, par admiration et plus souvent par peur, le comblent, sa vie durant, de présents et d'honneurs : Charles Quint ne craint pas, en 1543, de le faire chevaucher à sa droite, et, dix ans plus tard, lors d'un voyage à Rome, le pape Jules III l'embrasse en public, mais ne lui octroie pas, cependant, le chapeau de cardinal auquel l'Arétin aspire sans l'avouer. Bref, malgré d'inévitables et, parfois, de graves déconvenues, sa fortune « insolente » ne se dément pas jusqu'au jour d'octobre 1556 où il meurt terrassé par une attaque d'apoplexie.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Paul LARIVAILLE : professeur à l'université de Paris-IV
Classification
Média
Autres références
-
ART (Le discours sur l'art) - L'histoire de l'art
- Écrit par André CHASTEL
- 4 726 mots
- 1 média
...d'un « style idéal ». Il y eut des résistances, surtout à Venise ; il est important de noter que la première « critique d'art », au sens journalistique et spontané du terme, c'està-dire sans grande doctrine, est née au même moment dans les lettres de Pietro Aretino (mort en 1557), compatriote de Vasari. -
ÉROTISME
- Écrit par Frédérique DEVAUX , René MILHAU , Jean-Jacques PAUVERT , Mario PRAZ et Jean SÉMOLUÉ
- 19 777 mots
- 6 médias
...mot va bientôt désigner la chose. En attendant, l'« érotisme » imprimé sera parfaitement incarné par plusieurs écrivains en France et en Italie. Ainsi de L'Arétin (1492-1556), considéré à l'époque comme un auteur scandaleux de sonnets licencieux (ou Raggionamenti, 1536). Il achèvera une vie... -
TINTORET (1519-1594)
- Écrit par Anna PALLUCCHINI
- 3 171 mots
- 7 médias
...l'échange intense d'artistes entre la Vénétie et l'Italie centrale qui favorise la diffusion des idées nouvelles, mais aussi le fait que Pietro Aretino ( l'Arétin) se fixe à Venise à partir de 1527. Le dialogue de Dolce sur la peinture, intitulé L'Aretino, consacre l'importance du Toscan,...
Voir aussi