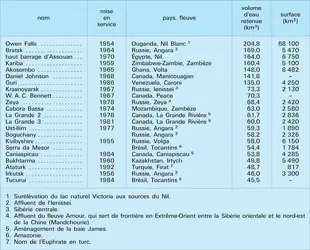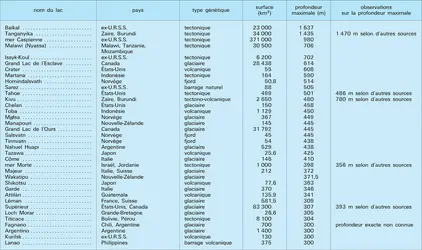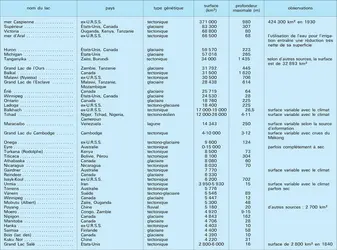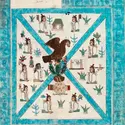LACS
Article modifié le
Autres collections d'eaux dormantes
De la flaque d'eau de surface (ou souterraine) aux grands lacs, tous les intermédiaires existent ; le moindre fossé humide toute l'année, le moindre bassin en eau, le plus petit étang abritent des biocénoses plus ou moins caractéristiques et réagissant aux fluctuations des facteurs externes de manière similaire à celles qui peuplent des portions de grands lacs ; de la même façon, les lagunes, malgré leurs liens avec la mer, ont une individualité d'eaux continentales.
Étangs et marais
Par définition, un étang est un réservoir d'eau vidangeable et fait de main d'homme. Quand il n'est plus exploité, ni vidangé, il évolue vers un état d'équilibre qui l'apparente à un lac. En raison de ses caractères propres, et notamment de sa faible profondeur (en général 1 à 2 m), des facteurs y jouent un rôle moins important que dans un lac et d'autres voient leur action grossie. Ainsi, la stratification thermique y est moins nette, moins durable par suite d'une prise aux vents différente, et d'une profondeur moyenne moindre. La faible profondeur rend actifs jusqu'à la surface les phénomènes qui modèlent le fond. L'existence des étangs, liée à celle de l'homme, est également conditionnée par la présence de fonds imperméables, le plus souvent argileux ou marneux recouverts parfois de sables généralement siliceux. La flore phanérogamique y trouve le moyen de se développer en ceintures caractérisées, depuis les colonies de Carex (laîches) du bord de l'eau jusqu'aux nénuphars, en passant par les roseaux (Phragmites), joncs et scirpes, potamots et autres plantes fixées.
La turbidité des eaux y est souvent forte par suite de la remise en suspension des matériaux du fond, plus ou moins floculés, dès que le vent provoque la turbulence des eaux. Le développement considérable à certaines époques d'espèces phytoplanctoniques a le même effet. Les processus physico-chimiques sont accélérés : la faible profondeur permet un transfert plus rapide des produits de décomposition bactérienne dans la zone euphotique trophogène. Enfin, les étangs sont le plus souvent utilisés comme réservoirs à poissons et l'homme y introduit des engrais choisis et en retire de la nourriture ou des produits de consommation, soit par pêche directe, soit lors des vidanges qui modifient le milieu (en l'améliorant, parfois).
La production annuelle des étangs va de quelques dizaines de kilogrammes de poissons à l'hectare (pêche extensive) à quelques kilogrammes par mètre carré (pisciculture intensive).
Les marais sont à la limite entre milieu terrestre et milieu aquatique. Ils ont en commun avec le premier un sol hydromorphe et des échanges physico-chimiques rapides, soit avec l'atmosphère, soit avec les horizons inférieurs, et avec le second la flore et les dépôts de sédiments quand ils sont remplis d'eau. Des processus bactériens intenses y provoquent souvent des formations plus ou moins localisées de bitumes qui s'étalent en taches d'huile dans les zones d'eau libre protégées, entre les touffes de Carex, scirpes, renouées, roseaux couvrant parfois de grandes surfaces. Les marais ne sont que le cas extrême d'une zone littorale abritée d'étangs ou de lacs laissés à l'abandon.
Ces milieux peuvent être aménagés. Les marais sont parfois asséchés, soit pour devenir d'excellentes terres à culture, soit pour éviter les ennuis que leur voisinage occasionne (moustiques, brumes, humidité résiduelle, « miasmes »). Cependant, leur rôle microclimatique est indéniable et ce sont des portions de nature qui servent de refuges à de très nombreux organismes utiles (dont les oiseaux migrateurs). Dans leur aménagement, un juste équilibre doit donc être calculé entre l'intérêt à court et à long terme de leur maintien et celui de leur destruction partielle ou totale.
Les étangs ont plusieurs modes d'utilisation. Lieux de baignade ou plans d'eau destinés à la navigation de plaisance, ils sont aussi utilisés par les pêcheurs à la ligne pour leur sport favori. Mais leur aspect esthétique ne doit pas faire oublier que ce sont avant tout des « champs » à poissons, de véritables usines à fabriquer des protéines animales. Leur exploitation, florissante dans certains pays, est malheureusement freinée dans d'autres par la concurrence entre les différentes sources de protéines animales disponibles (viandes, poissons marins ou lacustres). Dans les contrées à moyens de communication difficiles et où l'eau est abondante (zone équatoriale) ainsi que dans les pays centraux d'Europe et d'Afrique, les étangs font l'objet de soins tout particuliers. Il en est de même dans les régions à très forte densité de population telles que la Hollande ou l'Indonésie), où la nécessité de protéines fait oublier le phénomène de concurrence. L'élevage des poissons en étangs est la base même de la pisciculture, qui s'accompagne parfois d'autres activités d'élevage (canards) ou de culture (riz).
Mares et milieux temporaires
Les mares sont de très petits lacs naturels ou artificiels, où la végétation littorale est soit presque nulle, soit au contraire très développée. De profondeur variable, une mare est parfois temporaire, la disparition de l'eau étant due soit à une infiltration lente, soit à l'évaporation (sous les climats arides). Rien ne particularise spécialement une mare par rapport à un lac, si ce n'est la taille et le caractère astatique de ce milieu. C'est dans les mares que se développent le mieux certaines espèces d'algues ou de crustacés au point que les unes forment des fleurs d'eau, les autres une biomasse plus ou moins exploitable (mares à phyllopodes, fosses à daphnies). Des mares très pauvres de forêts sur terrains siliceux aux mares de fermes riches en matières organiques d'origine animale, tous les intermédiaires existent, et c'est un milieu de choix pour l'étude expérimentale des phénomènes aquatiques (et de leur mécanisme d'action).
Ces derniers s'y trouvent à la fois à la taille de l'homme et de ses possibilités de mesures dans le temps et dans l'espace et ils sont le plus souvent simplifiés par la dominance nette, quoique temporaire, d'un nombre très réduit d'espèces, souvent même d'une seule. C'est par l'étude de ces milieux temporaires qu'a été notamment mis en évidence le rôle considérable des stades de repos sur la renaissance de la vie dans les milieux aquatiques. Le sédiment desséché, craquelé même (fentes de dessiccation) d'une mare temporaire recèle, en effet, des spores d'algues, des œufs de durée de rotifères et de phyllopodes, des éphippies de cladocères, des œufs et des copépodites de copépodes cyclopides, des kystes d'harpacticides, de protistes, de tardigrades, toute une vie qui n'attend que l'eau pour se développer, croître, se reproduire, parfois à une vitesse incroyable (quelques jours, voire quelques heures).
Ces milieux servent ainsi de réservoirs à une flore et à une faune plus ou moins cosmopolites, voire ubiquistes. Ils contribuent au maintien un peu partout sur les continents de cette flore et de cette faune et permettent leur dispersion.
Lagunes
Les lagunes sont des lacs peu profonds en communication plus ou moins importante avec la mer et qui, de ce fait, en subissent constamment l'influence. Dans une lagune, on distingue essentiellement deux types de milieux : celui qui subit en permanence l'influence des apports marins (lagune « vivante ») et celui qui évolue de manière autonome (lagune « morte »). Le premier de ces milieux s'apparente à un milieu marin littoral, tandis que le second est la lagune proprement dite. Du point de vue hydrologique, la lagune vivante possède avec quelque retard un régime strictement marin (flux, reflux, parfois houles), tandis que la lagune morte ne se trouve que sous l'influence des vents locaux, précipitations et apports continentaux qui, progressivement, en font soit un milieu en voie de dessalure, soit au contraire en sursalure continue suivant l'importance de l'évaporation. Oxygène et pH sont déterminés par la végétation de fond (quand il y en a), tandis que phosphore et silice sont davantage influencés par le plancton.
Dans les conditions morphologiques et hydrodynamiques qui règnent dans une lagune, il y a remise en suspension de manière subcontinue des éléments qui ont tendance à se déposer. Une lagune, vivifiée régulièrement par les apports marins, est, comme tout lac, un piège à substances nutritives. Sa concentration en sels utiles y est inversement proportionnelle à la profondeur. La lagune s'enrichit ainsi par rapport à la mer voisine et, bien que le nombre des espèces soit relativement réduit, celles qui acceptent les conditions particulières de ce milieu forment d'importantes populations.
Les éléments phytoplanctoniques sont de deux sortes : des espèces euplanctoniques, assez rares et se développant mal dans les conditions régnant en lagune, et des espèces tychoplanctoniques dont quelques-unes sont très adaptées au milieu et s'y développent en masse. Elles servent de base à une chaîne alimentaire limitée, mais efficace du point de vue de la productivité. La répartition des animaux dépend de celle des éléments bioclimatiques ci-dessus énumérés (notamment l'oxygène) et de celle des organismes qui leur servent de nourriture.
Plusieurs espèces marines euryhalines (mollusques et surtout crustacés) trouvent dans les lagunes des conditions propices, sinon à tous les stades de leur croissance, du moins à certains d'entre eux. Cette constatation donne à l'étude des lagunes une importance considérable en aquaculture (moules, huîtres, crevettes, par exemple).
Les lagunes sont également exploitées à des fins touristiques (navigation de plaisance facilitée par l'absence de grandes houles) et elles sont le refuge de choix pour les navires marchands, là où la mer est hostile et l'accès à la lagune aménagé (lagune Ebrié, par exemple, où se situe le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire). Venise est un des exemples les plus élaborés d'utilisation de ce type très particulier de lac.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard DUSSART : maître de recherche au C.N.R.S., Station biologique des Eyzies, université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie
Classification
Médias
Autres références
-
AZTÈQUES
- Écrit par Rosario ACOSTA NIEVA , Alexandra BIAR et Mireille SIMONI
- 12 581 mots
- 22 médias
...des volcans » de l’époque préhispanique. De ces montagnes ruissellent de nombreux cours d’eau et rivières qui alimentaient, au rythme des saisons, cinq lacs de faible profondeur, établis à différentes altitudes : au nord, les lacs de Zumpango et de Xaltocan, au centre le grand lac de Texcoco et, au sud,... -
BAÏKAL LAC
- Écrit par Laure ARJAKOVSKY et Pierre CARRIÈRE
- 4 074 mots
- 2 médias
Le lac Baïkal, situé au sud de la région géographique de Sibérie orientale, est l'un des plus vastes lacs du monde : il se place au septième rang pour sa surface (31 500 km2), au deuxième pour le volume des eaux (23 000 km3), qui est égal à celui de la mer Baltique. Le lac, qui...
-
BALATON LAC
- Écrit par Gyorgy ENYEDI
- 353 mots
- 1 média
Avec 600 kilomètres carrés de superficie, le Balaton est le plus grand lac de l'Europe centrale. Ce lac hongrois s'allonge dans un fossé tectonique au pied de la dorsale de Transdanubie sur 77 kilomètres de longueur ; sa largeur maximale est de 14 kilomètres. La profondeur du lac est...
-
CANADA - Cadre naturel
- Écrit par Pierre DANSEREAU et Henri ROUGIER
- 5 724 mots
- 10 médias
Leslacs occupent 7,5 p. 100 du territoire fédéral, c'est-à-dire une fois et demie la superficie de la France. Les bassins-versants des grands fleuves sont également évocateurs d'une démesure incontestable : 3 583 265 kilomètres carrés pour celui des fleuves tributaires de l'Arctique. À l'eau, omniprésente,... - Afficher les 32 références
Voir aussi
- PLEUSTON
- NEUSTON
- PÉRIPHYTON
- PSAMMON
- DYSTROPHISATION, écologie
- HOLOMICTICITÉ, limnologie
- MÉROMICTICITÉ, limnologie
- PÉLAGIQUE VIE
- VARVES
- RIVIÈRES
- EAUX CONTINENTALES
- SEICHE, limnologie
- PISCICULTURE
- ENDORÉISME
- LÔNES
- NOUES
- MARE
- LAGUNE
- BEINE
- ÉTANGS
- VÉGÉTALE BIOLOGIE
- SELS MINÉRAUX
- BIOMES
- SALINITÉ
- PHYTOPLANCTON
- ZOOPLANCTON
- NECTON
- TEMPÉRATURE
- SÉDIMENTATION LACUSTRE
- COURANT, hydrologie
- BIOTECTON
- PRODUCTION, écologie
- AQUATIQUE VIE
- DULÇAQUICOLES MILIEUX
- BENTHIQUE VIE
- ZONES HUMIDES, écologie