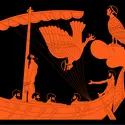TURCO-MONGOLES LANGUES ET LITTÉRATURES
Article modifié le
Littératures
La littérature en turc ancien
Les inscriptions runiques
En accédant à l'empire, les Türk allaient se trouver en contact avec des civilisations diverses : chinoise, sérindienne, iranienne et byzantine. Il leur fallut utiliser un moyen d'expression et ils choisirent l'alphabet « runique » pour écrire leur langue. Celui-ci, issu de l'araméen par divers intermédiaires, allait être un instrument incomparable pour noter les phonèmes de leur langue dans ses moindres détails.
Les anciens Türk avaient eu une littérature qui fut longtemps ignorée ou, du moins, dont on ne savait pas qu'elle leur appartenait. En effet, les voyageurs avaient signalé l'existence de stèles gravées depuis le fleuve Talas, au nord-est du Syr-Darya, jusqu'au bassin de Minousinsk dans le secteur russe et dans la haute Mongolie, en particulier dans la vallée de l'Orkhon. Ces dernières devaient être déchiffrées par le linguiste danois Thomsen, qui en donna en 1893 une première traduction, révélant des pages insoupçonnées de la littérature et de l'histoire des Türk dont on connaissait seulement les grands traits par les textes chinois. Alors apparurent les textes célèbres relatant les hauts faits des empereurs des Türk depuis la fondation de l'empire en 552 jusqu'à sa fin en 744. Les stèles dédiées à Köl-tegin et à Bilgä-qaghan furent connues comme portant les textes les plus anciens de la littérature « turque » ; peu après fut découverte et traduite l'inscription de la stèle de Toñouqouq qui est un morceau fort important.
De nombreuses inscriptions ont été retrouvées depuis le début du xxe siècle, et l'on en découvre encore d'autres dans les régions les plus diverses : en Mongolie et dans la Touva, elles concernent les Türk orientaux ; dans la région du Baïkal et dans la vallée de la Léna, elles sont attribuables vraisemblablement à leurs vassaux Qouriqan et Bayirqou ; dans la vallée de l'Iénissei et de ses affluents, en particulier dans le bassin de Minousinsk, elles relèvent de la culture des anciens Kirghiz ; dans la région située au nord du Syr-Darya, dans les vallées du Talas et du Tchou et non loin de l'Issiq-Köl, toutes ces inscriptions ont pour auteurs les Türk occidentaux. Elles sont assez courtes, et seules les inscriptions de l'Orkhon (Köl-tegin et Bilgä-qaghan) avec celle de Toñouqouq constituent des documents considérés comme relevant de la littérature ; les autres permettent de compléter la connaissance de l'ancien turc tant au point de vue de la grammaire que du vocabulaire.
D'autres documents en turc ancien ont été découverts au Turkestan oriental, principalement dans la région de Tourfan : ce sont des fragments de manuscrits, plus ou moins longs et plus ou moins lacunaires, qui nous apportent encore de nouveaux éléments d'appréciation sur le fait littéraire chez les anciens Türk ; l'un d'eux, publié par Thomsen, renfermait un texte manichéen, ce qui donne à penser que l'alphabet « runique » fut employé à l'époque ouïgoure, après la fin de l'empire turc ; reste à savoir si le manuscrit fut écrit après l'installation des Ouïgours à Tourfan ou s'il fut apporté par eux quand ils abandonnèrent la vallée de l'Orkhon. L'alphabet « runique » fut aussi employé dans la région de Koutcha, à Qoum-Toura, où une inscription a été retrouvée par Pelliot.
La littérature ouïgoure
Les Ouïgours succédèrent aux Türk dans la haute Mongolie en 744, et le siège de leur empire y demeura jusqu'en 840, date à laquelle ils furent vaincus par les Kirghiz de l'Iénissei qui s'emparèrent de leur capitale, Kara-Balgassoun. Pendant près d'un siècle, les Ouïgours tentèrent d'amener à leur civilisation les territoires qu'ils contrôlaient, mais leur conversion au manichéisme semble avoir été une des causes de leur défaite. Au cours de cette période, les manichéens venus de la Transoxiane par le Turkestan oriental ou par le Sémiretchié leur apportèrent avec leur religion une littérature spécifique qu'ils traduisirent vraisemblablement, mais aucune trace n'a été retrouvé en haute Mongolie. En même temps, les Ouïgours empruntèrent à la Transoxiane l'alphabet sogdien, issu du syriaque, tirant de celui-ci une écriture particulière permettant de rendre les phonèmes de leur langue, et qui devint par la suite l'alphabet ouïgour. On peut penser que tous ne devinrent pas manichéens et que certains d'entre eux devinrent bouddhistes et d'autres chrétiens nestoriens. Ils gardèrent cependant l'usage du vieil alphabet turc comme en témoignent les fragments manuscrits de Tourfan, et surtout la grande inscription située près de Kara-Balgassoun ; elle fut gravée sous le règne du qaghan Aï Tängridä Qut Bulmich Alp Bilgä (808-821), mais il n'en reste que des fragments. Rédigée sous forme d'une inscription trilingue : chinoise, ouïgoure et sogdienne, elle prouve l'influence qu'avaient acquise les religieux manichéens auprès des souverains ouïgours mais ne peut être considérée réellement comme une œuvre littéraire, bien qu'elle présente un style analogue à celui des inscriptions de l'Orkhon.
Depuis les environs de l'an 800, les Ouïgours occupaient les régions de Tourfan, de Beshbaligh, de Karashahr. Après la ruine de leur empire, une partie d'entre eux s'y réfugia tandis que l'autre allait occuper les principales villes du Gansu ; ils s'y maintinrent longtemps, puis furent refoulés dans les montagnes du Sud, touchant à la région du Kökö-nor. C'est probablement après cette installation dans ces territoires que furent écrites la plupart des œuvres dont une partie a subsisté. Dans la masse des manuscrits découverts depuis 1900 par les missions scientifiques envoyées en Asie centrale, le déchiffrement auquel il a été procédé a permis de distinguer deux genres de littératures : l'une, manichéenne, écrite avec un alphabet spécial et traduite de l'iranien ; l'autre, bouddhique, écrite à l'aide de plusieurs alphabets (sogdien, ouïgour et brahmi) et traduite du sanskrit, du koutchéen, du khotanais et du chinois. À ces deux littératures s'en ajoute une troisième, chrétienne (nestorienne), écrite en alphabet ouïgour, dont seuls quelques fragments ont été retrouvés, entre autres un texte sur le Passion de Georges, connu également en sogdien. Toute cette littérature ouïgoure est une littérature de traduction, comme ce sera le cas pour le mongol plus tard ; il ne semble pas qu'elle ait réalisé une œuvre originale, ou, du moins, s'il a existé des œuvres issues du fond ouïgour, rien n'en subsiste.
La littérature manichéenne en ouïgour dura peu de temps, car l'influence grandissante du christianisme et surtout du bouddhisme en amena la disparition. Malgré tout, en dehors des fragments qui offrent une valeur au point de vue de la connaissance de la langue ou de celle du manichéisme dont la plupart des œuvres ont été détruites, certains textes bien conservés, parmi lesquels figure le Khouastouanift (Manuel de confession), permettent d'avoir une notion correcte de la manière dont cette langue, peu apte à noter les concepts de cette religion, a réussi à surmonter les difficultés, et cela jusqu'à la mise au point d'hymnes manichéens déchiffrés et traduits par W. Bang et A. von Gabain. Il a fallu pour cela disposer de bons traducteurs qui ont, vaille que vaille, fait passer directement en ouïgour des mots tels que amvardišn (« recueil », « collection », etc.) qui n'est autre que le parthe amvardišn ('mwrdyšn), ou les ont adaptés, tel kägdä < kagda qui provient du sogdien kāγδi (k'γdyh), « feuille de papier », sans compter tous les termes techniques du manichéisme.
La littérature bouddhique en ouïgour est très riche ; elle a duré fort longtemps et on en connaît de nombreux textes. Pendant la période ancienne, probablement à l'époque où subsistaient les littératures manichéennes et chrétiennes, une masse considérable de textes traduits du sanskrit en sogdien, en koutchéen et en khotanais passa en ouïgour. Parmi tous ces textes souvent fragmentaires, certains sont plus complets, comme celui de la Tigresse affamée qui est conservé dans le texte imprimé du Suvarṇaprabhāsa ouïgour publié par W. Radlov et S. E. Malov et renferme de nombreux passages versifiés, ou celui qui est relatif à l'histoire des princes Kalyanamkara et Papamkara rapporté par Pelliot et dont une édition magistrale a été publiée. On peut y ajouter la biographie du pèlerin chinois Xuanzang et une série de textes, dont certains ne contiennent qu'un ou plusieurs chapitres de l'original. Là aussi, les traducteurs ont gardé en les adaptant à l'ouïgour un bon nombre de mots sanskrits tels que les noms des stations lunaires, par exemple ašliš qui provient du sanskrit aśleṣā, ou, d'une manière plus compliquée, le terme sanskrit passant par l'intermédiaire d'une des langues dans laquelle était rédigé le texte traduit, par exemple arzi, irzi, qui provient du sogdien rizai (rz'y) – le khotanais écrit riṣayi, ces deux intermédiaires provenant du sanskrit ṛṣi (« saint », « anachorète », « ermite »).
Au cours de la période mongole (xiiie et xive s.), la littérature bouddhique ouïgour continua de subsister et servit de modèle à la littérature mongole en voie de formation ; un très petit nombre de textes, d'ailleurs à l'état fragmentaire, relatifs au bouddhisme nous sont parvenus ; la raison en est l'islamisation progressive du monde ouïgour, qui semble avoir été parachevée lors des campagnes de Tamerlan (1375-1390) ; seuls restèrent bouddhistes les Ouïgours du Gansu. On ne possède plus que des documents d'un intérêt médiocre ; ce sont des inscriptions comme la partie ouïgoure de l'inscription du Jurongguan, au nord de Pékin, ou celle du prince Nomdaš, descendant de Gengis-khān, retrouvée au Gansu par Pelliot ; ces documents permettent seulement de pouvoir définir la langue alors employée que l'on peut nommer « moyen ouïgour ».
À partir du xve siècle, l'ouïgour disparut en tant que langue de civilisation des régions qu'il avait occupées depuis 840 en Asie centrale ; il demeura en usage cependant dans deux secteurs, d'une part au sud du Gansu, où les Sarïγ-Ouiγur (« Ouïgours jaunes ») se sont maintenus jusqu'à maintenant en conservant le bouddhisme comme religion, et dans leurs anciennes possessions de Koutcha et de Tourfan, où, devenus musulmans, ils cessèrent d'avoir une littérature distincte de celle des musulmans de la région de Kachgar. C'est au Gansu qu'a été découvert, au début du xxe siècle, le texte du Suvarṇaprabhāsa qui doit remonter à la fin du xviie siècle et que l'on peut considérer comme un texte ancien, alors que dans l'autre secteur ne subsistèrent que de rares textes, en particulier les modèles de suppliques datant de la fin des Ming (fin xvie et début du xviie s.), qui étaient en usage à la cour de Pékin et qui furent sans doute rédigés en ouïgour « tardif ».
L'alphabet ouïgour fut employé à la Horde d'Or et chez les Tīmurīdes pour transcrire certains textes rédigés en djaghataï, et il y eut même au xvie siècle des scribes ouïgours qui travaillèrent à la cour des sultans ottomans. C'est peut-être pour cette raison qu'un texte en moyen ouïgour, vraisemblablement rédigé en ouïgour de Tourfan vers 1300, la Légende d'Oghouz-qan, fut remanié au Kazakhstan dans le courant du xve siècle et a été conservé sous cette forme dans un manuscrit fragmentaire. Il s'agit là d'un texte d'origine épique se rattachant à la légende d'Oghouz-qan, qui a été conservé d'autre part chez les historiens persans ou turcs qui ont traité dans leurs ouvrages de l'origine des Türk. Ce texte paraît avoir subi fortement l'influence des religions pratiquées successivement par les Ouïgours et présente des détails pittoresques sous une forme assez naïve. Actuellement, l'ouïgour est en voie de reprendre sous transcription arabe une place dans la culture de l'Asie centrale. Il est langue officielle au Xinjiang (Turkestan chinois).
Origines et évolutions du djaghataï
Tandis que la littérature ouïgoure connaissait ces développements, le secteur occidental fut islamisé de bonne heure à la suite de la conversion du souverain turc de Kachgar, Satouq Boughra-qan, qui mourut vers 955. Au cours du xe siècle, ses descendants se partagèrent les oasis de la région de Kachgar et de Khotan ainsi que les plaines du Tchou et du Talas, puis conquirent la Transoxiane (999). C'est dans ces régions que devait se manifester une littérature d'expression musulmane, qui, au point de vue linguistique, est très proche de celle des Ouïgours et aura des développements connus plus tard sous le nom de djaghataï ; il s'agit d'une langue issue, comme l'ouïgour, du vieux turc, qui sera transcrite en caractères arabes. De la Kachgarie, le djaghataï gagnera la Transoxiane, acquérant au cours des siècles de nombreuses formes dialectales qui le transformeront peu à peu selon les milieux où il se développera.
Cette langue littéraire turque de l'Asie centrale islamisée employa donc comme moyen d'expression l'alphabet arabe. C'est à Kachgar, à la cour des souverains qaraqanides que fut composé le texte le plus ancien que nous possédons. Son auteur, Yūsuf Khass Hadjib, était originaire de Balasaghoun ; venu à Kachgar, il composa son œuvre en 1069-1070 et l'offrit au souverain de cette ville sous le titre de Qoutadhghou-bilig (La Science qui apporte le bonheur). Il s'agit d'une poésie didactique où l'influence iranienne se fait sentir aussi bien dans la versification que dans le style ; la langue elle-même est artificielle, fondée sur le dialecte turc de la région de Kachgar fixé dans des formes conventionnelles. C'est cette langue qui devait connaître un succès tel qu'elle servit au xvie siècle à Babour pour rédiger ses Mémoires, au xviiie siècle à Abu'l-Ghāzī pour écrire son Histoire des Turcs, et pour d'autres œuvres produites tant dans le milieu qiptchaq de la Horde d'Or que dans le milieu ouzbek à l'époque de Chaybānī.
Le Qoutadhghou-bilig étant une œuvre sentencieuse, à l'encontre de ses modèles iraniens, ne rapporte aucun événement historique ou légendaire, bien qu'il donne la possibilité de voir quel était l'état social des Türk de Kachgarie et quelle était la manière dont ils se comportaient en tant que musulmans. Malheureusement, les personnages sont artificiels, en fait purement allégoriques et dépourvus de vie. Malgré ces défauts, cette œuvre littéraire eut un immense succès dans le monde turc ; c'était la première manifestation d'un certain humanisme bien que très imprégné par l'islam, alors que jusqu'à cette époque les littératures turques avaient été des littératures religieuses et de traduction.
Une autre œuvre découverte un peu plus tard et d'une importance égale à celle du Qoutadhghou-bilig fut composée au xiie siècle par Aḥmad ibn Maḥmūd Yögneki ; il s'agit encore d'une œuvre didactique qui « renferme des règles de morale sèches sans rapport avec la vie réelle » ; elle fut écrite pour un certain émir Dad-Ispahsalar-Beg et fut connue sous le titre de Hibat al-haqaiq. Peu après fut écrite l'œuvre de Maḥmūd al-Kāshgarī qui devait exercer une influence capitale sur le développement de la langue littéraire turque. Kāshgarī, originaire des environs de l'Issiq-Köl, voyagea beaucoup et apprit, à ce qu'il dit, tous les dialectes turcs pratiqués dans le monde de la steppe et dans les possessions turques ; il semble qu'il ait été d'origine turque bien que connaissant parfaitement l'arabe, et peut-être était-il de la famille des Qaraqanides. Il fixa sa résidence à Bagdad, et c'est là qu'il écrivit son Dīvān lughāt at-Türk, œuvre immense où il fixa toutes les connaissances qu'il avait acquises sur les Türk, entre le début de l'année 1072 jusqu'à son achèvement le 10 février 1074. Cette œuvre renferme un vocabulaire d'une richesse incomparable et une masse d'informations sur tout ce qui concerne le monde turc.
Au siècle suivant, l'islam fit de nets progrès chez les Türk grâce à l'action d'un cheikh nommé Aḥmad Yāsāvi qui vécut dans la ville de Yāsi, à la place de l'actuelle ville de Turkestan. Il y mourut en 1166 ou 1167 après avoir écrit des poésies mystiques qui exercèrent une grande influence. Cette œuvre nous est parvenue très altérée, mais sa renommée fut telle que Tamerlan fit ériger un édifice sur la tombe de son auteur. Aḥmad Yāsāvi laissa de nombreux disciples qui écrivirent des poésies mystiques en turc, et dont l'influence s'étendit jusque dans le courant du xive siècle. L'un d'entre eux, Ḥakīm‘Aṭā, composa en prose un recueil de sentences.
Le turc ayant supplanté au Khārezm la langue khārezmienne au cours du xiie siècle, c'est après la conquête mongole, pendant le xive siècle, qu'il y fut utilisé par des écrivains usant de la même langue que celle de l'auteur du Qoutadhghou-bilig, mais avec des emprunts à la langue des milieux qiptchaq et oghouz qui constituait celle de la Horde d'Or. Le djaghataï n'avait pas atteint le terme de l'évolution qui forma la langue employée par Babour, mais cette langue issue du turc kachgarien avait subi au cours des siècles l'influence des grands dialectes pendant qu'elle était utilisée dans diverses régions situées plus à l'ouest.
On connaît au xive siècle, écrit par le poète Qutb, un roman en vers, Khusrav-u Shirin, qui est une imitation du roman de Niẓāmī. Il peut être daté des années qui précèdent 1340. D'autre part, un auteur vivant à la Horde d'Or, mais né au Khārezm comme l'indique son surnom de Khārezmi, composa en 1353 au nord de la Transoxiane un ouvrage connu sous le nom de Muḥabbat Nāmé (Le Livre de l'amour). Ces deux œuvres montrent l'évolution de la langue dont on retrouve les mêmes symptômes aussi bien dans les yarligh, ou rescrits des souverains de la Horde d'Or, que dans les inscriptions funéraires du Sémiretchié. La langue créée dans la région de Kachgar est devenue la langue écrite du monde turc, les grands dialectes parlés exerçant leur influence selon les régions avant d'atteindre eux-mêmes le statut de langues littéraires.
L'apparition de Tamerlan et l'avènement des Tīmūrides donnèrent une nouvelle impulsion à la langue écrite, et ce sera l'âge d'or du djaghataï. Sous les Tīmūrides, la poésie turque atteint une rare qualité. Lutfi, qui fut le panégyriste d'Ulugh-Beg, et Sekkāki, un Transoxianais, jouèrent un rôle important dans la poésie djaghataï, le premier par son Dīvān et par son Gul-u Naurūz, le second par ses nombreuses poésies. Ils sont les plus représentatifs parmi les premiers poètes de cette époque, comme d'ailleurs le poète Kāsimi-anwār qui composa quelques pièces de vers en turc. C'est de cette même époque que datent les deux textes djaghataï écrits en caractères ouïgours, l'un, le Tezkéreh-i evliyā (Mémorial des saints), traduit du persan par un inconnu le 20 décembre 1436, l'autre le Miradj Nāmé (Ascension de Mahomet), traduit de l'arabe ; un troisième manuscrit du même genre, le Bakhtiyar Nāmé, a été écrit en 1435.
À cette époque vivait un poète mystique, Mīr Ḥaydar Medjdhūb, très prisé par les Tīmūrides ; il écrivit au xve siècle un Makhzen el-Asrār (Trésor des mystères) qui, à ses yeux, était la réplique à une œuvre du même nom de Niẓāmī. Un autre poète, le prince Sayyid Aḥmad, petit-fils de Tamerlan, écrivit vers 1435 un Ta'ashshoq Nāmé qui est une imitation du Muḥabbat Nāmé de Khārezmi. On pourrait citer un grand nombre d'autres poètes, mais tous sont dominés par Mīr ‘Alī Shīr Nawā'ī, qui d'ailleurs nous les fait connaître par son Madjālisūn-Nafā ‘is (Assemblées où l'on parle des choses précieuses), biographies des poètes contemporains.
Mīr ‘Alī Shīr fut l'homme le plus éminent du monde turc au xve siècle. Né à Harāt, sa famille s'étant attachée aux Tīmūrides, il fut le compagnon d'étude de Ḥusayn Bāyḳarā qui, une fois monté sur le trône, le nomma garde du sceau. Partageant sa vie entre le service de l'État et ses occupations, il devait mourir le 4 janvier 1501, âgé de soixante-deux ans. Ce grand homme prit le surnom de Nawā'ī dans ses poésies turques et celui de Fāni dans ses poésies persanes. Il subit profondément l'influence de Niẓāmī et surtout celle de Djāmī. Il écrivit de nombreuses poésies en turc qu'il classa en quatre divans : Étrangetés de l'enfance, Raretés de la jeunesse, Merveilles de l'âge mûr et Utilités de la vieillesse. C'est dans ses poésies qu'il a donné libre cours à son génie poétique, souvent sous l'influence de la poésie persane. Il a écrit des commentaires à des œuvres religieuses sous forme de quatrains, des poésies mystiques (Trésor des secrets), des romans (Ferhād et Shīrin et Laylā vé-Madjnūn) et la vie du roi Bahrām Gūr (les « Sept Planètes »). Il a écrit également le Maḥbūb al-Qulūb (Aimé des cœurs), en imitation des œuvres des mystiques persans, des biographies, dont celle de Djāmī, une histoire des prophètes, des patriarches et des philosophes, et une histoire des anciens rois de Perse. Son dernier ouvrage est le Muhākamat al-Lughatain (Débat des deux langues), où il discute de la valeur du persan et du turc comme langues littéraires et conclut en faveur du turc. Malgré leurs efforts, Mīr ‘Alī Shīr comme d'ailleurs ses prédécesseurs et ses émules ne purent jamais s'affranchir de l'emprise de la littérature persane.
Après l'effondrement des Tīmūrides, l'un des plus grands écrivains turcs, si ce n'est le plus grand, fut Babour, le futur conquérant de l'Inde. Né en 1482, il fut obligé dans sa jeunesse d'abandonner les terres de ses ancêtres et, après avoir fondé une principauté à Kaboul en 1503-1504, il conquit l'Inde du Nord-Ouest et s'empara de Delhi en 1526 ; il mourut le 26 décembre 1530. Babour a laissé de nombreuses poésies, mais il est surtout connu par ses Mémoires si vivants, qui sont l'œuvre maîtresse de la littérature turque écrite en djaghataï. Ils sont pleins de sincérité, écrits dans un style simple et vivant, très différents de tous les textes orientaux de ce genre.
À la même époque, des œuvres historiques furent composées chez les Ouzbeks en l'honneur de Chaybānī ; elles furent rédigées également en djaghataï, car le milieu ouzbek n'avait pas encore assimilé la culture persane ; les Ouzbeks firent usage de cette langue en prenant pour modèle Mīr ‘Alī Shīr et Aḥmad Yāsāvi. Le Tevārikh-i Gūzida Nūsret Nāmé date de cette époque (1502-1503) et fut abrégé sous le titre de Chaybānī Nāmé (Livre de Chaybānī), qui est le panégyrique du conquérant ouzbek.
Cependant, si l'on continua à employer le djaghataï jusqu'au début du xviiie siècle, comme l'atteste l'œuvre poétique du mystique sūfi Allāh-Yār, et si les Mémoires que Mīrzā Ḥaydar Dūghlat rédigea en Kachgarie en utilisant le persan, Tārīkh-i Rashīdī, furent traduits en djaghataï à plusieurs reprises, il n'en est pas moins vrai que le persan supplantait peu à peu le djaghataï en Transoxiane et en Kachgarie et que son usage persista seulement au Khārezm et dans la région de Khokhand. Abū'l-Ghāzī, souverain de Khiva au xviiie siècle, composa deux œuvres historiques célèbres, un Shedjere-i Tarākima (Histoire des Türkmènes) et le Shedjere-i Türk (Histoire généalogique des Türk) ; la langue qu'il emploie n'est plus le djaghataï, mais un djaghataï tellement imprégné par l'ouzbek qu'on peut le considérer comme écrit en cette langue. Ces deux ouvrages furent rédigés à la fin de sa vie, le premier en 1659 et 1660, le second en 1663. Le djaghataï est supplanté pendant un temps par le persan dans les deux Turkestans ; finalement, de nouvelles langues littéraires telles que l'ouzbek en Transoxiane et l'ouïgour dans le bassin du Tarīm se manifesteront à l'époque moderne.
La littérature mongole
Comme c'est généralement le cas dans toutes les littératures, les Mongols ont possédé des chants épiques relatant les exploits de leurs souverains ; on constate leur existence dans certains passages de l'histoire des Mongols rédigée par le Persan Rachīd al-Dīn (Reshid ed-Din) et surtout par ceux qui subsistent dans le texte de l'Histoire secrète des Mongols (1240 env.). Cette chronique est l'œuvre la plus ancienne de la littérature mongole ; elle relate l'histoire de Gengis-khān, celle de ses ancêtres et celle de son premier successeur. Elle occupe une place à part, tant par sa langue que par son style, et dut connaître plusieurs états ; elle renferme de nombreux passages de poésie allitérée épique où sont contés dans un style rude et coloré certains épisodes relatifs à Gengis-khān ; c'est le seul témoin des premiers chants épiques. Les autres textes de la littérature mongole, à partir du règne de Qubilai et jusqu'à la fin de la dynastie mongole de Chine (1368) et à l'effondrement de celle des Ilkhans d'Iran (1335), sont rares. Tous ont été rédigés en moyen mongol (xiiie s. début du xviie s.), langue qui aboutit alors à un nouvel état appelé « mongol classique » qui fut utilisé jusqu'à une date récente. Ces monuments préclassiques sont des inscriptions et des textes manuscrits ou imprimés qui proviennent de Mongolie, de Chine, d'Asie centrale et d'Iran ; malheureusement, il ne s'agit que d'inscriptions, de documents diplomatiques ou administratifs ; seules quelques poésies plus ou moins fragmentaires et d'un intérêt littéraire médiocre ont été retrouvées. Les pièces littéraires les plus importantes consistent en des traductions mongoles de textes bouddhiques, tels les fragments imprimés découverts à Tourfan du Bodhicāryavatāra traduit et commenté par Čhos-Kyi'o-dzer, édition en date de 1312. Des textes bouddhiques fragmentaires, xylographiques, ont été découverts à Tourfan ; il s'agit d'un hymne à Mahākālī et de fragments de poésies, notamment d'un texte particulièrement intéressant qui renferme une partie de la légende d'Alexandre apparaissant sous le nom de Sulqarnai (équivalent de son nom musulman : Dū'l-Qarnaīn). L'ensemble de ces fragments ne permet pas de se faire une idée précise au sujet de la littérature des Mongols. D'autres textes ont paru au xvie siècle ; c'est l'époque de la seconde génération des grands traducteurs qui vont faire passer du tibétain en mongol les énormes collections de textes religieux qui constituent le Kandjur et le Tandjur dans les deux grands centres de Koukou-Qoto, « la Ville bleue », et de Koumboum au nord-est du Tibet.
En dehors de cette littérature de traduction, il dut y avoir une littérature historique, mais les textes n'en sont pas conservés et ont été incorporés dans les œuvres historiques qui commencent à paraître au xviie siècle. C'est alors que surgissent les chroniques appelées Shara Tuudji (Histoire jaune), dont l'auteur est inconnu, Erdeniyin tobtchi (Résumé précieux [de l'origine des souverains]) de Sanang-Setchen (1662), Altan kürdün mingqan gegesütü bitchik (Livre de la roue d'or aux mille rayons), Altan tobtchiya (Bouton d'or), Bolur erike (Chapelet de cristal, 1774-1775) ; ces chroniques et d'autres encore ont conservé des passages des chroniques disparues, en particulier des morceaux en vers allitérés qui prouvent l'existence de textes épiques relatant la vie de certains souverains. Dans tous ces textes, les auteurs ont voulu rattacher la lignée issue de Gengis-khān par ses ancêtres plus ou moins mythiques, aux rois de l'Inde qui favorisèrent la propagation du bouddhisme et à ceux du Tibet servant d'intermédiaire entre rois indiens et souverains mongols.
La langue mongole classique fut employée à partir de la seconde moitié du xviie siècle et au xviiie siècle ; elle s'était enrichie du vocabulaire des Ouïgours, aux xiiie et xive siècles, et de celui des Tibétains, depuis le xvie siècle ; ces deux siècles seront l'âge d'or de la littérature mongole, en fait pendant l'ère de la dynastie mandchoue ; malheureusement, ce sera surtout une littérature de traductions. On traduira en mongol surtout des œuvres tibétaines et chinoises et ces modèles susciteront des œuvres de toutes sortes ; les histoires chinoises intéressant les Mongols seront traduites, des romans, tels le San Guo zhi yanyi, le Liao zhai zhi yi, le Xi you ji, etc., en même temps que deux vastes chants épiques d'origine populaire étaient composés l'un en mongol, La Geste de Guessar, d'après le texte tibétain qui constitue L'Épopée de Guésar de Ling, l'autre en kalmouk, La Geste de Djanggar, qui célèbre les prouesses du héros kalmouk.
C'est l'époque où sont rédigés de nombreux récits de voyages décrivant des lieux célèbres, tels Pékin ou le Wutaishan.
En outre, une abondante littérature consacrée à l'astronomie, à la médecine, à la jurisprudence, etc., voit le jour ; s'y ajoutent des recueils de lexicographie, des traductions des classiques chinois, des manuels scolaires comme le San zi jing et le Qian zi wen, des écrits de genre didactique, tel le Trésor des belles paroles, des recueils de sentences, de maximes, de proverbes. Beaucoup d'éditions sino-mongoles paraissent alors et l'emprise du monde chinois s'exerce d'une manière de plus en plus forte.
En même temps, les Mongols occidentaux, ou Kalmouks, accèdent à l'art d'écrire grâce à Zaya-pandita qui, vers le milieu du xviie siècle, créa l'alphabet kalmouk, plus précis que l'alphabet mongol et par suite mieux adapté à la langue kalmouke. Des textes de toutes sortes voient alors le jour ; c'est la première réaction qui permettra aux Kalmouks de rénover leur langue. Ils composent de nombreux ouvrages historiques entre autres œuvres qui se dégagent de l'influence prédominante des Chinois. Les Bouriates rédigent alors leurs chroniques en attendant de noter les légendes épiques qui se sont conservées chez eux ; leur langue se fixe. Après beaucoup d'hésitations, les Khalkhas, à la chute des Mandchous, adoptent l'alphabet cyrillique pour transcrire leurs textes littéraires et commencent à recueillir à leur tour les textes folkloriques et les légendes épiques qu'ils avaient conservés (Rintchen) ; ils constitueront une langue à la fois populaire et savante, qui est devenue le mongol officiel et a supplanté la vieille langue écrite qui s'était fixée au début du xviie siècle.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Louis HAMBIS : directeur de l'Institut des hautes études chinoises, professeur au Collège de France
Classification
Autres références
-
AZERI
- Écrit par Charles URJEWICZ
- 715 mots
Habitants de l'Azerbaïdjan, les Azeri (Azerbaïdjanlylar) forment la population caucasienne la plus nombreuse. Estimés à 6 800 000 en 2006, ils sont concentrés dans leur république, où, avec 7 600 000 habitants, ils représentent près de 90 p. 100 de la population totale. Les Azeri constituent...
-
ÉPOPÉE
- Écrit par Emmanuèle BAUMGARTNER , Maria COUROUCLI , Jocelyne FERNANDEZ , Pierre-Sylvain FILLIOZAT , Altan GOKALP , Roberte Nicole HAMAYON , François MACÉ , Nicole REVEL et Christiane SEYDOU
- 11 783 mots
- 7 médias
...alimente et relance l'oral, surtout au Tibet, où les textes abondent. Le barde tibétain ne fait jamais usage d'un instrument de musique. Chez les Turco-Mongols, l'accompagnement musical, à la vielle ou au luth, tend à professionnaliser le barde, mais l'exécution de l'épopée, qui exige la participation... -
ISLAM (Histoire) - Le monde musulman contemporain
- Écrit par Françoise AUBIN , Olivier CARRÉ , Nathalie CLAYER , Encyclopædia Universalis , Andrée FEILLARD , Marc GABORIEAU , Altan GOKALP , Denys LOMBARD , Robert MANTRAN , Alexandre POPOVIC , Catherine POUJOL et Jean-Louis TRIAUD
- 31 436 mots
- 12 médias
...porter une appréciation équilibrée. La politique linguistique peut constituer un indice assez significatif de la latitude laissée aux minorités ethniques. Les autochtones du Xinjiang parlent, dans leur écrasante majorité, des langues turques, principalement celle qui est maintenant dite uigur (ou ouïghour... -
KITAN ou KHITAN
- Écrit par Françoise AUBIN
- 620 mots
- 1 média
Ancien peuple de pasteurs nomades protomongols, connu depuis le ive siècle, qu'on trouve installé à la fin du viiie siècle sur le territoire des actuelles Mongolie-Intérieure et république populaire de Mongolie. En 926, son chef Abaoji (872-926, du clan Yelü), qui s'était proclamé empereur...
- Afficher les 8 références
Voir aussi
- KITAN ou KHITAN, langue
- RUNES ou RUNIQUE, écriture
- TURQUE LITTÉRATURE
- SOGDIEN
- AGGLUTINANTES LANGUES
- LANGUES ÉVOLUTION DES
- BOUDDHIQUE LITTÉRATURE
- TURC, langue
- YŪSUF KHASS HADJIB (XIe s.)
- MAḤMŪD AL-KĀSHGARĪ (XIe s.)
- NAWĀ'Ī MĪR ‘ALĪ SHĪR (1439-1501)
- DJAGHATAÏ, langue
- YÖGNEKI AḤMAD IBN MAḤMŪD (XIIe s.)
- ALTAÏQUES LANGUES