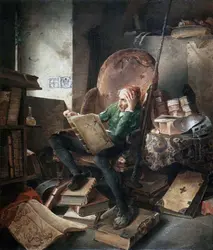LECTURE
Article modifié le
Les sociologies de la lecture
Le lecteur contemporain, auquel des sondages de plus en plus nombreux proposent le miroir permanent de ses propres pratiques, est-il pour autant bien connu ? Quelles ont été les origines de ce recours croissant aux enquêtes ? Statistiques et questionnaires éclairent-ils mieux les comportements actuels que les traces éparses laissées par nos ancêtres ? La lecture des sondages peut être faite de deux manières : pour les résultats qu'ils énoncent, pour les préoccupations dont ils sont les témoins et les valeurs dont ils sont le signe.
Les premiers sondages
Ce type d'enquête, se répand dans les années 1930 aux États-Unis. La crise a, selon plusieurs analyses, dirigé des millions d'Américains vers leurs bibliothèques et, par là même, mis l'accent sur nombre d'inégalités dans l'offre de lecture. Inégalités qui sont alors moins souvent pensées en termes sociaux qu'en termes géographiques. On met en avant les disparités qui existent entre États, entre régions, entre zones rurales et zones urbaines. Et l'on s'inquiète que le nombre d'inscrits en bibliothèques n'excède pas 20 p. 100 de la population, ou que les bibliothèques « réservées aux Noirs » dans les États du Sud n'accueillent que 10 p. 100 d'entre eux. Lorsque certains s'interrogent sur les origines socioprofessionnelles des lecteurs, comme le font très vite les chercheurs de Chicago, lieu foisonnant d'investigations sur la lecture, c'est afin de comprendre pourquoi la classe moyenne lit des livres de « meilleure qualité » que les nouveaux immigrants. La Seconde Guerre mondiale ayant elle aussi suscité une très forte croissance des pratiques de lecture, d'autres enquêtes, menées cette fois par les éditeurs, font se demander avec inquiétude si ce « boom », qui a favorisé l'achat de livres, va se poursuivre. Va-t-il falloir produire plus ou moins ? Les non-lecteurs forment-ils un marché potentiel ? Les genres appréciés, les succès sont-ils prévisibles ? Autant en emporte le vent va-t-il remplacer la Bible ? Les enquêtes très complètes suscitées alors par le Book Industry Committee cherchent à dresser un tableau exhaustif des habitudes des lectures qui naissent alors. En France, les seules sources disponibles ont longtemps été les statistiques éditoriales : comptabilisant annuellement nombre de titres et d'exemplaires produits, répartis très approximativement par disciplines ou estimés en termes de chiffres d'affaires, ces statistiques ne permettent qu'imparfaitement de cerner l'état de l'édition, et point du tout celui des lectures.
Si le Front populaire s'intéresse aux grandes enquêtes sociales, si l'I.F.O.P. (Institut français d'opinion publique) est créé en 1938 sur le modèle de Gallup (institut américain fondé en 1935), la lecture ne constitue pas alors pour autant un thème de sondage. Elle est éventuellement un indicateur d'opinion : les lecteurs de L'Aurore, de L'Humanité, de L'Époque, de Combat ou de Franc-tireur ont-ils un avis différent sur tel ou tel aspect de la reconstruction, se demandent les sondages de l'après guerre. En 1949, l'un des premiers sondages de l'I.F.O.P. sur « les fêtes » s'intéresse aux distractions préférées des Français le dimanche ou le soir. Le fait que la lecture vienne en tête des activités vespérales ne suscite alors aucun satisfecit particulier. La crise qui frappe l'édition française entre 1932 et 1937 avait pourtant vu naître quelques doutes, et avec eux les premiers questionnements touchant les publics acheteurs. Mais ce sont les groupes de presse qui, les premiers, se plaignent de ne pas connaître leur lectorat. La préoccupation initiale pour la lecture a donc bien, comme aux États-Unis, une origine professionnelle et marchande « l'homme politique, le chef d'entreprise, le directeur de journal doivent, comme on dit, avoir des „antennes“. [...] Il faut qu'ils déterminent ce qui forme, dans un milieu donné, les aspirations, les tendances, l'évolution des sentiments, même – et surtout – alors que ceux-ci ne sont pas exprimés... », estime Claude Bellanger, président de l'Institut français de presse, dans sa préface à un sondage consacré en 1949 à la lecture de la presse.
Il faut attendre la fin des années 1950 pour voir apparaître les premières enquêtes consacrées à la lecture de livres. « Ce que lisent les Français », titre Réalités en 1955. Les Français lisent-ils plus de livres que les Anglais ou les Américains ? Préfèrent-ils les ouvrages de « pure imagination » ou ceux qui témoignent de « qualités d'observation » ? Les classiques ou les nouveautés ? Sont-ils hostiles aux traductions ? Nul ne cherche, à l'époque, à mesurer une éventuelle « chute de la lecture ». Tout au contraire, le commentaire de Réalités affirme au détour d'une phrase : « La France aime lire ». Si les éditeurs sont parfois à l'origine de ces quelques enquêtes, celles-ci sont surtout dues aux préoccupations de la génération des « sociologues des loisirs ». Ceux-là, soulignant que l'élargissement des loisirs est une conquête ouvrière, se donnent pour but de mener une « recherche action ». Comment s'intègre la lecture dans les loisirs populaires ? Comment transformer du temps de loisir en temps de culture ? Comment, demande Joffre Dumazedier, « élever le niveau culturel des loisirs » ? Quels sont les obstacles à la lecture d'œuvres littéraires en milieu populaire, interroge dans le même temps Robert Escarpit.
Le développement des politiques culturelles mises en œuvre par le ministre de la Culture va le conduire à créer, en 1961, son propre département d'études pour tenter de mesurer les effets de son action. Recueillir des données, déterminer des enjeux, mettre en œuvre des campagnes, dénoncer des lacunes, annoncer des programmes, scander des progrès, évaluer des résultats : telles sont ainsi les raisons d'être des enquêtes en sociologie de la lecture. La culture se conjugue encore au singulier, elle est univoque et incontestée : on ne cherche pas à distinguer alors les modes, formes et contenus de « cultures populaires », mais à faire partager par tous des valeurs esthétiques qui ne sont pas encore remises en cause. Le doute n'est pas encore né qui conduira les sociologues de la fin des années 1960 à s'interroger sur les formes de domination idéologique d'une « culture bourgeoise » ou, plus tard, comme le fait Pierre Bourdieu, sur les phénomènes de reproduction et de distinction à l'œuvre dans les pratiques et dans les « goûts ».
Les enquêtes sur la lecture et l'idéologie culturelle
La multiplication des inquiétudes depuis la fin des années 1970 va changer la donne : désormais, des journaux, des clubs de livre, des éditeurs, des associations de bibliothécaires commandent à des instituts de plus en plus nombreux des enquêtes propres à cerner qui l'image de l'écrivain chez les Français, qui la lecture des jeunes, qui l'influence de la télévision sur la lecture, qui les connaissances littéraires des Français, qui l'image des bibliothèques publiques, etc. L'heure est à la multiplicité des thèmes d'investigation et à la multiplication des commanditaires. Plus que toute autre pratique culturelle, la lecture semble avoir besoin d'être sans cesse questionnée : où et quand lisez-vous ? La télévision est-elle plus importante pour l'éducation de vos enfants que la lecture ? Comment choisissez-vous vos livres ? Regardez-vous les émissions littéraires ? Quel est l'effet des clubs et des supermarchés sur le choix des ouvrages ? Quels sont les principaux obstacles à la lecture ? Les publics questionnés sont aussi de plus en plus nombreux : il peut s'agir de telle ou telle tranche d'âge, de telle ou telle catégorie de la population, de tels ou tels adhérents à tel club ou abonnés à telle revue.
Cette multiplication des sondages témoigne d'une inquiétude forte et partagée : « la lecture se meurt », l'âge d'or de la lecture est derrière nous ; loin d'avoir contribué à la croissance de la lecture et à l'amélioration des goûts, l'augmentation du temps libre aurait favorisé d'autres loisirs et d'autres médias ; la télévision – puis Internet –hypnotiserait les regards et les esprits ; les livres seraient devenus des objets, des marchandises interchangeables ; le phénomène des best-sellers, focalisant l'attention et le succès sur quelques titres, contribuerait à un appauvrissement intellectuel et esthétique du champ éditorial ; les pratiques de lecture diminueraient, notamment chez les jeunes ; la culture contemporaine serait à l'image de ces livres « préfabriqués » et « prévendus » par supermarchés et clubs de livres ; le niveau culturel de la population baisserait ; lire ne serait plus participer d'une valeur, mais manipuler un produit. Ces questions, ces doutes, exprimés par les pédagogues, les institutions culturelles, la presse, seront l'objet d'articles, de colloques, de résolutions et de nouveaux sondages, cherchant toujours à mesurer des lacunes, à dénoncer des concurrences ou, au contraire, à vérifier la permanence d'un certain nombre de goûts et de valeurs.
Si les enquêtes se multiplient et se répètent, c'est aussi parce qu'elles sont devenues, pour ceux qui en sont à l'origine, un acte symbolique, une façon de marquer un territoire et une appartenance à une communauté socioculturelle inquiète de l'état des pratiques de lecture en France, voire de revendiquer dans cet espace une forme de primauté. Il est alors intéressant de prendre connaissance de ce « bruit d'informations » en étant attentif aux présupposés dont ils sont bien souvent porteurs. On en comprend mieux les thèmes, les questionnements et les résultats. Car les préoccupations des « sondeurs » expliquent ainsi bien souvent les opinions et comportements des « sondés ».
Une lecture attentive des questionnaires d'enquête laisse émerger quelques-uns de ces présupposés normatifs et de ces hiérarchies implicites. Beaucoup ne considèrent comme véritable lecture que la seule lecture de livres et n'explorent pas, par exemple, la lecture de la presse. Celle-là pourtant ne recouvre ni les mêmes façons de faire, ni les mêmes raisons d'être, ni les mêmes publics : elle est le témoin d'une autre histoire et d'un autre rapport à la lecture. D'une absence mise en œuvre par le questionnement même, on peut alors conclure à une perte et déplorer que la France compte « deux non-lecteurs sur trois ». Si les sondages avaient existé au xixe siècle, sans doute certains d'entre eux auraient exclu de la même manière une partie de la production romanesque – le feuilleton, par exemple – alors rejetée par les prescripteurs de lecture. Est-ce à dire que les romans n'étaient pas lus ?
D'autres sondages s'apitoient sur « l'ignorance » d'une population qui ne sait pas toujours que Céline était un homme, que Balzac a écrit Eugénie Grandet, qui ne peut citer un grand écrivain italien, ou allemand, qui ne connaît pas les noms des Prix Nobel, n'a jamais entendu parler de Kafka ou de Nabokov, etc. Ainsi le niveau culturel est-il essentiellement mesuré à l'aune de signes, d'indices de ce qui serait un savoir littéraire. À ces commentaires, nombre de questions pourraient être renvoyées : quel était, sur ce même point, l'état des connaissances, des points de repère, voilà cinquante ans ? Que penser d'un questionnement en termes de devinettes ? Savoir que Céline est un homme, est-ce avoir lu le Voyage au bout de la nuit ? Qui décide de la pertinence de telle ou telle question ? La lecture des résultats de ces mêmes sondages peut inspirer d'autres commentaires, notamment sur la permanence de la lecture des grands écrivains du xixe siècle par exemple, ou bien sur la prégnance de certaines traces laissées par l'éducation scolaire.
L'histoire des sondages est donc aussi l'histoire d'un certain nombre de préoccupations culturelles et sociales. En cela, leur effet d'obscurité est aussi fort que leur volonté de lumière. La focalisation sur certains thèmes en voile parfois d'autres. L'apparente pléthore d'enquêtes peut s'accompagner d'absences. Si la révélation de l'existence et de la permanence de l'illettrisme dans nombre de pays développés, des États-Unis à la Grande-Bretagne et à la France, a eu au milieu des années 1980 un effet de choc, c'est parce que, impensable et impensé, il ne pouvait même être questionné, ni soupçonné. Le traditionnel « Savez-vous lire et écrire ? » a d'ailleurs disparu depuis 1946 de la plupart des recensements des pays européens. On le voit, les termes et thèmes des sondages sont aussi le lieu où s'expriment les valeurs et les hiérarchies culturelles partagées à un moment donné par une société. Certes, ils permettent de mesurer des pratiques et de cerner des valeurs. Mais ils participent tout autant à la création de ces valeurs. Ainsi sont-ils l'occasion de faire « en creux » une histoire des aspirations et des inquiétudes culturelles qui caractérisent une société. Un tantinet tautologiques, ils sont autant utiles par leurs obsessions ou leurs oublis que par leurs données. Une sociologie de la lecture, quant à elle, ne saurait se passer de l'observation attentive des façons de faire individuelles, de l'écoute minutieuse de chacune des histoires de plaisirs ou de déplaisirs provoqués par la confrontation des hommes et des textes.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henri-Jean MARTIN : professeur émérite à l'École nationale des chartes, directeur d'études à la IVe section de l'École pratique des hautes études
- Martine POULAIN : conservatrice générale des bibliothèques, directrice de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art
Classification
Média
Autres références
-
APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
- Écrit par Jonathan GRAINGER et Johannes ZIEGLER
- 1 848 mots
- 1 média
La lecture est une invention culturelle, l'une des plus grandes de la civilisation. Les systèmes d’écriture, comme l’alphabet latin, ont été inventés pour transcrire le langage oral. C’est ainsi que le langage oral est devenu immortel. Dans le cerveau du lecteur, les symboles sur la page deviennent...
-
ALEXIES
- Écrit par Marie-Pierre de PARTZ
- 1 658 mots
Les alexies correspondent aux troubles de la lecture qui apparaissent chez des lecteurs habiles à la suite d’une lésion cérébrale aiguë (par ex. accident vasculaire ou traumatisme crânien) ou neurodégénérative (certaines démences). Ces déficits, encore appelés « dyslexies acquises », sont à différencier...
-
BARTHES ROLAND (1915-1980)
- Écrit par Philippe DULAC
- 4 712 mots
- 1 média
...euphories/dysphories matérielles là où on attendrait une classique étude historique ou idéologique. Avec Sur Racine, où il expérimente sur l'auteur de Phèdre une lecture psychanalytique assez novatrice qui fera grincer des dents aux sorbonnards élevés dans la stricte méthode de Lanson – respect des vraisemblances... -
BIBLIOTHÈQUES
- Écrit par Henri-Jean MARTIN
- 8 934 mots
- 3 médias
...bibliothèques universitaires qui disposèrent de très faibles moyens et demeurèrent embryonnaires jusqu'à une période très récente. Longtemps, enfin, la lecture publique ne réussit pas à se développer en France. Certes, les gouvernements tentèrent à plusieurs reprises de créer un réseau de bibliothèques... -
BRAILLE
- Écrit par Françoise MAGNA
- 7 024 mots
- 3 médias
Lalecture du braille se pratique en faisant glisser la dernière phalange des index sur la ligne écrite. Pour permettre la continuité dans la lecture et pour une lecture plus rapide, il faut utiliser les index des deux mains : la première moitié d'une ligne est lue par la main gauche, la seconde par... - Afficher les 43 références
Voir aussi
- SOCIOLOGIE HISTOIRE DE LA
- DÉVOTION
- LITTÉRATURE SOCIOLOGIE DE LA
- CONSONNE
- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE
- RELIGION POPULAIRE
- LATINE LITTÉRATURE
- MILIEU SOCIAL
- CULTURE SOCIOLOGIE DE LA
- COLLECTIONNEURS
- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE
- ENQUÊTES & SONDAGES
- BIBLIOTHÈQUE BLEUE
- VOLUMEN
- ENSEIGNEMENT PUBLIC
- AUTODIDAXIE
- ÉCOLE PRIMAIRE ou ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
- BIBLIOPHILES
- RELIGIONS SOCIOLOGIE DES
- JONGLEURS
- HISTOIRE SOCIALE
- ÉLITES
- LECTURE PRATIQUES DE
- POLITIQUE CULTURELLE
- MISE EN PAGE
- PONCTUATION