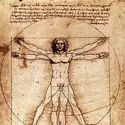ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472)
Article modifié le
De la théorie à la pratique
L'œuvre construite est peu importante en quantité. Alberti, homme de cabinet, ne fut pas présent sur les chantiers, comme le révèle par exemple la lettre dans laquelle il donne des instructions très précises à Matteo de' Pasti, chargé de l'exécution de San Francesco à Rimini. Dans d'autres cas, son intervention n'est pas prouvée. On lui attribue généralement la paternité du palais Rucellai, à Florence. Le palais fut construit en deux étapes par Bernardo Rossellino (1448-1455, apr. 1457 et av. 1469), mais l'humaniste est vraisemblablement l'inspirateur d'une façade qui présente pour la première fois trois niveaux de pilastres appliqués sur le revêtement à bossage typique des palais florentins. Cette superposition d'ordres inspirée de modèles antiques (Colisée, théâtre de Marcellus), l'utilisation d'une corniche à l'antique et, à la base de l'édifice, d'un opus reticulatum, sont tout à fait dans l'esprit d'Alberti, qui apparaît ainsi comme l'inventeur d'un type de façade sans précédent à Florence. En 1450, Sigismondo Malatesta avait appelé Alberti à Rimini pour moderniser San Francesco et en faire un mausolée dynastique, d'où son nom de tempio Malatestiano. Le Florentin conçut une enveloppe moderne, habillant la façade et les flancs de l'ancien édifice, ainsi qu'une rotonde, dans le prolongement du chœur, couverte d'une immense coupole ; toutefois, ce dernier projet ne put être mené à bien. À Florence, Alberti réalisa à la demande de Giovanni Rucellai le Saint-Sépulcre de l'église San Pancrazio, petit édicule supporté par des pilastres cannelés (1467), et surtout la façade de Santa Maria Novella (1457-1458). Quant aux édifices prévus pour Mantoue, ils ne furent pas terminés : San Sebastiano n'a jamais reçu la façade que prévoyait Alberti, et c'est Filippo Juvara qui construisit au xviiie siècle la coupole de Sant'Andrea. De même, l'église de Rimini resta inachevée.
Tous ces édifices sont cependant très importants pour l'histoire de l'architecture, car ils posent, d'entrée de jeu, les deux problèmes cruciaux de l'architecture religieuse de la Renaissance : celui du plan (centré ou longitudinal) et celui de l'adaptation des formules antiques aux façades des églises modernes. San Sebastiano, construit sur l'emplacement d'un ancien oratoire, a un plan en croix grecque. Sant'Andrea, église destinée à accueillir de nombreux fidèles, comporte pour cette raison une nef sans bas-côtés, mais dotée de chapelles latérales et couverte d'une puissante voûte en berceau reposant sur des piliers disposés entre les chapelles, dans un rythme inspiré de l'arc de triomphe antique. Enfin, le temple des Malatesta devait combiner une nef longitudinale et un sanctuaire en forme de rotonde. Les principales solutions qu'adopta l'architecture religieuse des siècles suivants se trouvent ici définies : le plan central fut celui du Saint-Pierre projeté par Bramante et par Michel-Ange ; le plan longitudinal de Sant'Andrea préfigure celui du Gesù construit à Rome par Vignole ; la combinaison de la nef et de la rotonde, souvenir du Saint-Sépulcre de Jérusalem, se retrouve à la Santissima Annunziata de Florence ; elle fut reprise par Diego de Siloé pour la cathédrale de Grenade.
L'autre grand problème était celui de la façade. Les modèles antiques utilisant les ordres – le portique de temple avec fronton et l'arc de triomphe – s'adaptent difficilement à l'élévation d'une église chrétienne comportant une nef haute et des bas-côtés. À Santa Maria Novella, Alberti adopta la solution la plus simple : deux niveaux d'ordres superposés, large au rez-de-chaussée et plus étroit à l'étage, avec de part et d'autre de ce niveau supérieur des volutes pour relier les deux étages. Cette formule fut reprise et diffusée par Antonio da Sangallo le Jeune, à Santo Spirito in Sassia, à Rome, et s'imposa définitivement dans la Ville éternelle, avec la façade du Gesù et sa nombreuse descendance. À Rimini, la proximité de l'arc d'Auguste semble avoir imposé le modèle de l'arc de triomphe, dont on retrouve des éléments : les colonnes cannelées engagées et les tondi (ou médaillons) des écoinçons. L'arc de triomphe constitue le rez-de-chaussée ; la partie haute de la nef est fermée par un second niveau plus étroit. Dans ce cas, les deux étages sont reliés par des demi-frontons. Palladio se souviendra de ces éléments pour ses façades d'églises vénitiennes.
Sant'Andrea représente une nouvelle étape, plus audacieuse et plus problématique. L'arc de triomphe, monumental, est combiné à un fronton de temple, couvrant apparemment les deux niveaux de l'élévation. En réalité, ce n'est possible que pour le narthex, plus bas que la nef. En retrait de la façade et dissimulé par elle, un petit arc, situé plus haut que le fronton, masque la partie supérieure de la nef. Cette solution, peu satisfaisante, n'eut pas de suite. Alberti a donc posé et tenté de résoudre les problèmes majeurs de l'architecture de la Renaissance. Le style de ses réalisations témoigne lui aussi de sa modernité, car elles ne reprennent pas seulement à l'Antiquité des formules de disposition des ordres, elles en ressuscitent la monumentalité. Même inachevé (Matteo de' Pasti ne put mener à terme l'entreprise en raison de la mort de Sigismondo, en 1468), le temple des Malatesta frappe par la noblesse de sa conception. Dans la majesté de son volume intérieur, Sant'Andrea de Mantoue est comparable aux plus belles réalisations de l'Antiquité.
Cette monumentalité très romaine est cependant combinée à un décor archaïsant, qui lui confère une originalité supplémentaire. La décoration ne renie pas les modèles et le style toscans : la façade de Santa Maria Novella est une savante synthèse d'éléments antiques (attique, pilastres et demi-colonnes placées sur piédestal) et d'un registre décoratif typiquement florentin (incrustations, chapiteaux au décor préclassique, etc.), qui en font la transcription moderne de San Miniato al Monte. Curieusement, les formes des ordres décrites dans le traité ne sont pas utilisées dans la réalité. Les chapiteaux de la façade de Rimini, dont la composition est donnée par l'humaniste avec la plus grande précision, diffèrent du corinthien de l'arc antique voisin, et seraient inspirés d'un type ancien de chapiteau italique ; de même, les chapiteaux de Sant'Andrea ne respectent pas les normes canoniques.
Humaniste, théoricien et praticien dilettante, Alberti inaugure l'un des principaux types de l'architecte à l'âge classique. Pierre Lescot, Daniele Barbaro, Claude Perrault seront, de ce point de vue, ses héritiers. L'autre grande figure de la Renaissance italienne, Brunelleschi, représente un second type : celui de l'homme de chantier, qui, bien qu'attentif à l'aspect théorique de son art et aux principes de l'Antiquité, est plus attaché aux réalités pratiques et à la tradition locale qu'il hérite de son expérience de constructeur. Antonio da Sangallo, Philibert Delorme et François Mansart se situent dans cette lignée. L'œuvre d'Alberti et de Brunelleschi traduit cette opposition, si bien exprimée par André Chastel : « On n'aura aucune peine à opposer la démarche de Brunelleschi à celle d'Alberti, si l'on songe à ce qui sépare Saint-Laurent du Temple de Malatesta, Santo Spirito de Saint-André de Mantoue : ici, ligne et dessin, là, mur et volumes ; ici, la scansion des vides et un rythme explicite, là, des consonances multiples ; ici, le roman toscan porté à un ordre de rapports d'une pureté parfaite, là le modèle romain obstinément médité » (« L'Architecture cosa mentale », in Filippo Brunelleschi, la naissance de l'architecture moderne, L'Équerre, Paris, 1978). Peut-être faut-il des génies comme Léonard ou Michel-Ange pour dépasser cette opposition.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Frédérique LEMERLE : chargée de recherche au C.N.R.S., centre d'études supérieures de la Renaissance, Tours
Classification
Médias
Autres références
-
TRAITÉ DE LA PEINTURE, Leon Battista Alberti - Fiche de lecture
- Écrit par Martine VASSELIN
- 1 111 mots
- 1 média
D'après des annotations autographes relevées sur des manuscrits, le Traité de la peinture de Leon Battista Alberti (1404-1472) fut achevé, dans sa rédaction latine, en août 1435 et, dans sa version italienne, en juillet 1436. Un groupe de manuscrits en latin comporte une dédicace à Gianfrancesco...
-
ACADÉMISME
- Écrit par Gerald M. ACKERMAN
- 3 543 mots
- 2 médias
Une théorie humaniste de l'art fut inventée ou exprimée pour la première fois, avec une clarté remarquable, parLeon Battista Alberti dans son traité Della pittura, écrit aux alentours de 1435. Comme aucune théorie antique de l'art, susceptible de servir de modèle, n'avait survécu, l'humaniste... -
ANATOMIE ARTISTIQUE
- Écrit par Jacques GUILLERME
- 8 927 mots
- 7 médias
...quasi mystique, L. B. Alberti et Léonard de Vinci inaugurent un nouveau type d'enquête, une analyse déjà scientifique de la morphologie humaine. Alberti se constitue un système métrique qu'il appelle Exempeda et qui lui permet de patiemment commensurer les divers segments des corps reconnus... -
ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE
- Écrit par Martine VASSELIN
- 1 060 mots
De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...
-
ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture, sciences et techniques
- Écrit par Antoine PICON
- 7 917 mots
- 6 médias
...tâches de chantier s'inscrit du même coup dans une nouvelle vision des procédures d'édification. Semblable vision se précise par la suite dans l'œuvre d'un Leon Battista Alberti, dont le De re aedificatoria reprend la triade vitruvienne solidité, utilité, beauté en la réinterprétant à la lumière des acquis... - Afficher les 22 références
Voir aussi
- RIMINI
- DÉCORATION ARCHITECTURALE
- THÉODOLITE
- FLORENCE
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.
- ART THÉORIE DE L'
- ITALIENNE LITTÉRATURE, des origines au XVIIe s.
- ARCHITECTURE HISTOIRE DE L'
- ITALIENNE ARCHITECTURE
- COMPOSITE ORDRE
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE