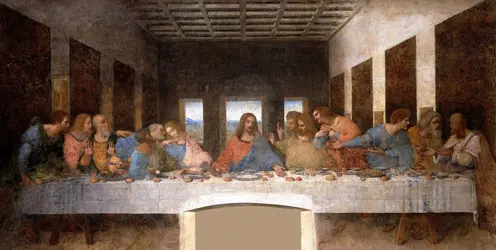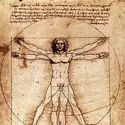LÉONARD DE VINCI (1452-1519)
Article modifié le
Le savoir
La « science » de Léonard a généralement déçu les philosophes qui mettent, comme il se doit, l'accent sur la systématisation des observations ; elle a ébloui ceux qui sont sensibles à la capacité d'appréhender méthodiquement les phénomènes et d'isoler leurs caractères. Il n'y a aucun doute, l'activité intellectuelle de Léonard est plus conforme à l'orientation aristotélicienne qui part de la saisie successive des objets particuliers qu'à l'orientation platonicienne attachée à l'unité première. Toutefois, l'insistance sur la valeur des mathématiques, paradigme absolu du savoir, et sur les infinite ragioni che non sono in esperienza équilibre l'empirisme radical, auquel, dans son souci du concret, se tient constamment Léonard. Cette attitude doit être comprise à partir d'une démarche complète que trop de commentateurs n'ont pas pris la peine de restituer. Léonard se propose d'élaborer une science du « visible », et il n'hésite pas à subordonner les conclusions de la filosofia ou science du monde physique, au rôle privilégié de la peinture, observatrice nécessaire, perché l'occhio meno s'inganna (C.U., fo 4). En fait, le paradoxe n'est qu'apparent : Léonard ne nie pas la relativité des sens, l'œil n'est pas ici l'œil vulgaire mais l'œil savant. L'activité de représentation, c'est-à-dire la peinture, est indispensable à l'exploration scientifique de la nature et la réalise, à partir du moment où elle assure une démarche méthodique. L'axiome auquel revient sans cesse Léonard dans l'introduction du Trattato est donc l'identité de la peinture et de la philosophie, de l'art et de la science.
En tenant compte de cet axiome, on peut rendre compte effectivement du lien interne des démarches de Léonard en évitant de tomber dans la célébration indistincte des découvertes miraculeuses du génie. Chaque savant ayant trouvé ou cru trouver la trace de découvertes considérables dans les écrits enfin révélés de Léonard après 1882, il devint habituel de le traiter en précurseur universel. Ainsi lit-on chez Péladan : « Les représentants de chaque branche du savoir humain sont venus témoigner de l'universalité de Léonard. L'astronome a salué le précurseur de Copernic (gravitation), de Kepler (scintillement des étoiles), de Matzlin (réflexion solaire), de Halley (vents alizés), de Galilée (mouvement). Le mathématicien a salué le précurseur de Cammandus et de Manolycus (centre de gravité de la pyramide). Le mécanicien a salué le successeur d'Archimède (théorie du levier), l'hydraulicien a salué le précurseur de Castelli (mouvements des eaux), le chimiste a honoré le précurseur de Lavoisier (combustion et respiration)... » Il est vrai qu'un grand nombre des découvertes de la science moderne sont anticipées dans les notes de Léonard, mais elles ne sont qu'exceptionnellement formulées dans les termes requis. Aussi importe-t-il de se former une idée du cadre général de ses recherches.
La conception générale de la nature est établie sur un double héritage : la vieille théorie des éléments et celle de l'analogie du microcosme humain et du macrocosme, les deux notions étant d'ailleurs liées. « Les Anciens ont appelé l'homme microcosme, et la formule est bien venue puisque l'homme est composé de terre, d'eau, d'air et de feu, et le corps de la Terre est analogue » (ms. A, fo 55, vo). Il y a dans la nature une vaste circulation de l'eau à partir de l'océan comparable à la diffusion du sang à partir du cœur, etc. Jusque dans la croissance des métaux, la nature se comporte comme un vivant gigantesque (Anatomie B, fo 28, vo). On sent ici poindre le « vitalisme » d'un Paracelse. Mais Léonard ne se tient pas à l'intuition ; pour rendre compte de l'agitation diffuse dans la nature : le vent, les eaux, la chute des corps, etc., il procède à l'analyse méthodique du mouvement et de ses lois, et il apparaît ainsi engagé dans la voie de Galilée, mais sans déboucher sur la physique abstraite de l'étendue. Tout mouvement est dû pour lui au fait que chacun des quatre éléments réside à l'état de repos dans sa sphère, et la diversité des phénomènes naît de la confusion et des conflits qu'entraînent leur déplacement et leur mélange à des niveaux divers. Il s'agit donc de mesurer des forces.
L'idée la plus fortement développée, sinon la plus originale, est que la gravité, qui, par exemple, attire ou semble attirer un corps vers le centre de la Terre, n'est pas due à une force d'attraction (ce que dans son langage Léonard nomme desiderio, désir de retrouver sa place), mais dépend de la teneur du corps en tel ou tel élément. La pesanteur, comme tous les autres mouvements, est due à un déplacement initial, une violence, un choc : toute action de ce genre est dite accidentale. La description du monde physique prend ainsi le caractère d'une véritable dramaturgie, que le vocabulaire de Léonard ne fait rien pour atténuer. La gravité et la force, nées de l'impeto et de la percussion, agissent donc jusqu'à épuisement, donnant l'impression que les choses réelles sont unies par quelque chose d'invisible. Il peso è corporeo e la forza incorporea... se l'una desidera di se fuga e morte, quell'altro vuole stabilità e permanenza (Cod. atl., fo 302, vo). Tout revient au dualisme et à l'opposition d'une énergie qui se détend et d'une matière qu'elle entraîne ; dans l'explosion qu'elle provoque, l'énergie va trouver la liberté et avec elle l'épuisement, c'est-à-dire la mort. Et c'est une loi universelle. On peut naturellement hésiter sur la valeur exacte du terme : spirituale appliqué au mouvement initial, principe de la force, selon que l'on prête à Léonard une métaphysique spiritualiste (Bongianni, Gentile) ou en quelque sorte prématérialiste (Luporini). Mais l'important dans toutes ces analyses est le mode d'approche des données sensibles et l'effort vers une dynamique universelle (théorie de l'énergie généralisée).
Physique et sciences naturelles
L'effort « scientifique » de Léonard se développe selon deux grandes directions : l'une proprement physique, tendant à fonder les principes généraux de statique et de dynamique qui permettent de comprendre tout un ordre de phénomènes relevant en définitive de la pesanteur et du mouvement ; De peso e moto est le titre d'un traité envisagé par Léonard. Le Codex Arundel en contient pour une bonne part les matériaux méthodiquement – mais incomplètement – regroupés. Tous les phénomènes envisagés à partir de ces principes débouchent sur des activités pratiques : traction, percussion, hydraulique, aérostation, et il est ainsi permis de grouper toutes les applications de la physique de Léonard sous la rubrique générale de la mécanique. Elles relèvent, au sens large, des travaux de l'ingénieur, et c'est là que l'apport de Léonard est tout à fait extraordinaire. Il l'affirme : « La mécanique est le paradis des sciences mathématiques, car elle conduit au fruit mathématique » (ms. E, fo 8, ro) ; « la science est le capitaine et la pratique les soldats » (ms. I, fo 190, ro). L'important est la pleine cohérence de l'opération. L'autre direction de ces études scientifiques concerne l'ensemble de la cosmologie et des sciences naturelles, sciences d'observation portant sur les phénomènes du monde visible et des êtres qui s'y trouvent. Il s'agit en d'autres termes des astres et en particulier de la Terre, avec ses pulsations, sa respiration originale, des trois règnes avec leurs espèces, dont la diversité et les particularités sont inépuisables ; dans les deux cas, il faut passer de la nomenclature, forme traditionnelle du savoir, à la représentation graphique, le dessin. C'est là que s'accomplit un véritable « décloisonnement » des disciplines, dont il est permis de faire, avec Panofsky, un des moments essentiels de la Renaissance. L'étude de l'espace repose sur l'optique : perspective et théorie de la lumière ; celle des formes concrètes de la nature et des vivants n'existe que par la recherche des caractéristiques qui s'exprime finalement par la figuration complète. La dispersion des observations de Léonard n'est donc ici qu'apparente. De même que ses réflexions inlassables de physique trouvent leur unité dans l'achèvement auquel elles conduisent, la mécanique, de même les innombrables notes et observations de géologie, de biologie, d'anatomie se comprennent en fonction d'un but idéal qui embrasse d'autorité toutes ces disciplines et auquel leur approfondissement doit conférer une sorte de sécurité et de perfection : la peinture. Ce sont les deux pôles autour desquels avec une ampleur intrépide Léonard a entrepris de réorganiser le savoir, à lui seul.
Sur un dessin d'anatomie tardif, on lit : « Que nul ne lise mes principes s'il n'est mathématicien » ; mais le terme de « mathématiques » garde une valeur générale et presque symbolique, à en juger par une autre note à propos des muscles faciaux et du sourire : « C'est mon intention que de décrire et représenter complètement ces mouvements par le moyen de mes principes mathématiques » (W. 19046). Ces principes sont l'analyse des forces, la schématisation, la mesure, complétant la représentation. Le recours insistant aux procédés mathématiques est donc une garantie de rationalité et l'unique moyen de s'assurer des principes stables dans les deux domaines auxquels il faudra toujours revenir, et où Léonard a entendu se « réaliser », la mécanique et la peinture.
Le monde de la technique
La technique, avec toutes les implications possibles dans toutes les directions, est sans nul doute le domaine propre de Léonard. Il n'est pas de domaine de l'industrie où il ne soit intervenu avec un projet de machine ; ainsi pour le textile, activité capitale étant donné l'importance de la laine et de la soie dans l'économie de la Renaissance, on trouve dans le Codex atlanticus, folio 393, verso, un procédé d'incannaggio dont le principe est toujours en usage, et un autre de tondeuse pour régulariser les surfaces des étoffes (amatrice) qui a été retrouvé au xviiie siècle en Angleterre et dont on se demande, par conséquent, si quelque industriel milanais ou florentin n'a pas tiré parti (Cod. atl., fo 397, ro). De même pour les moyens de transport, où les systèmes les plus divers de propulsion et de trait ont été envisagés par lui, ou pour tous les crics, palans, appareils à déplacer ou à soulever les fardeaux, particulièrement utiles pour la construction civile et militaire. Toutes les machines à vis, à poulie, à crans : moulins, pompes, scies, marteaux mécaniques, appareils de transmission, horloges, sont analysées et remontées avec le détail de leurs organes dans d'admirables dessins dont le manuscrit 8937 de Madrid montre bien qu'ils pouvaient être mis en ordre pour la publication. Léonard a porté une attention particulière aux instruments de mesure, tels que hygromètre, podomètre, ou compas parabolique.
L'abondance incroyable des dessins de Léonard peut induire en erreur, si l'on se laisse impressionner par cette fécondité fantastique au point de n'y voir qu'une sorte de rêverie mécaniste, finalement sans conséquence. Telle n'est pas la vérité. D'abord Léonard recopie avec soin des modèles déjà existants afin de les étudier et de les perfectionner : on a pu montrer qu'il a recueilli des schémas de grues et de palans utilisés par Brunelleschi pour la construction de la coupole de Florence, et, chose étrange, plus ou moins tombés en désuétude dans la seconde moitié du xve siècle (Reti, 1964) ; d'autres types d'appareils, militaires ou non, sont pris chez F. Di Giorgio, l'ingénieur siennois (dont le traité est d'ailleurs resté inédit jusqu'au xixe s.), ou chez un autre Siennois un peu plus ancien, le Taccola (dont le traité, accompagné d'illustrations, n'a été publié qu'au xxe s.). Les conditions de la transmission du savoir technologique expliquent donc bien des choses. Les difficultés de la réalisation aussi. Les ingénieurs italiens qui se sont intéressés à Léonard ont généralement pu fabriquer des maquettes capables de fonctionner à partir de ses schémas ; un certain nombre des projets ont dû être réalisés, surtout s'ils touchaient aux deux formes d'activité où la demande était forte : les fêtes et la guerre. Pour le reste, le lent développement de l'industrie, fortement régie par les règles artisanales, ne permettait pas des changements de modèles rapides. L'ardeur extraordinaire mise par Léonard à concevoir et à prévoir dans tout leur détail technique ces engins mécaniques est caractéristique du personnage. Il n'y a aucun doute qu'il a considéré la technologie comme un accomplissement majeur de l'homme : il est en cela la parfaite représentation de l'époque où les grandes réalisations du savoir sont exaltées comme la preuve de la dignité singulière de l'homme, deus in terris. Mais l'assurance de Léonard procède de la clarté de sa démarche : il analyse les jeux des forces en présence et travaille en fonction d'un problème de dynamique et de résistance à résoudre. On le comprend encore mieux depuis la réapparition du Matr. 8937, qui « esquisse un traité de cinématique pratique où, plutôt que des machines tout à fait prêtes à fonctionner, sont considérés des principes mécaniques et des mouvements fondamentaux » (L. Reti, 1969).
Le règne de l'air et celui de l'eau ont particulièrement attiré son attention. L'aérologie conduit à partir du vol des oiseaux à des principes qui doivent mener au mécanisme général d'une machine. Dessins et expériences datent du séjour milanais, puis de la seconde période florentine. Des essais ont dû être faits. Pour l' hydraulique, il n'est pas excessif de parler d'une passion de Léonard : la curiosité qu'il marque pour l'eau s'adresse aux applications pratiques, telles que canaux, navigation, écluses, machines à roue, jeux d'eau, mais aussi aux singularités des remous, des vagues, de la marée, ou encore au pouvoir de l'humidité en suspension dans l'atmosphère, aux vapeurs, nuées, et finalement aux cataclysmes du déluge évoqué dans des pages et des dessins célèbres (vers 1513). Rien ne montre mieux que ces études obstinées la volonté de maîtriser par l'intelligence toutes les manifestations d'un fluide, qui est d'intention « scientifique » mais qui ne peut pas plus constituer une discipline séparée et exhaustive, que le phlogistique cher à Voltaire. Dans l'exploration du monde physique, on sent affleurer l'intérêt esthétique ; cette inflexion, sensible dans l'expression littéraire comme dans la représentation graphique, est concevable à l'intérieur de la « science » de Léonard, mais non des Modernes.
De même, pour la géologie, où Léonard a fait des observations neuves sur les roches et les plissements alpins en particulier, et surtout avec la biologie, dominée par l'attention au corps humain. Ici, la liaison ou même la coïncidence des intérêts artistiques sont manifestes. La géologie et l'examen des phénomènes atmosphériques et météorologiques débouchent sur l'art du paysage, la biologie sur le traitement adéquat de la figure. Dans les deux cas d'ailleurs, l'articulation est rendue explicite par les chapitres du Trattato où ces développements sont amorcés. En même temps, les dessins de Léonard, véritables notations « scientifiques », sont souvent des chefs-d'œuvre surprenants de précision et d'ingéniosité. Dans le relevé du cerveau, Léonard va plus loin que Vésale. Il présente les organes de la respiration ou les muscles comme des machines : les schémas les montrent prêts à fonctionner avec une acuité surprenante, que les procédés de représentation photographiques n'ont pas dépassée. Les planches anatomiques ont été célèbres : Léonard les montrait avec fierté au cardinal d'Aragon ; J. Cardan les a vues et admirées, mais par une réaction typique, il les déclare peu utiles, parce que leur auteur n'est pas un médecin.
Les querelles des spécialistes n'étaient pas pour Léonard. Il prétendait, en fait, les battre tous séparément sur leur propre terrain, grâce à sa « méthode ». Mais la finalité de cette gigantesque entreprise était bien de doter le praticien, ingénieur ou peintre, de données irréfutables. Léonard a accompagné ce travail de notes polémiques qui achèvent de nous éclairer : il critique les « abréviateurs » ou compilateurs, qui s'en tiennent aux publications déjà faites, car il faut aller au fond des choses (Cahiers d'anatomie I, fo 4, vo et fo 5, ro). Il dénonce le charlatanisme des « nécromants et alchimistes », incapables de se plier à l'expérience (Anatomie B, fo 31, ro et vo). Il prend enfin ses précautions à l'égard des lettrés, qui sont « recitatori e trombetti delle altrui opere » et n'ont aucun titre à critiquer les « inventori e interpreti » qui s'adressent à la nature, à l'expérience, « maestro ai loro maestri » (Cod. atl., fo 117, ro). Ces prises de position sont claires : elles ne signifient nullement que Léonard refuse l'apport de la culture, mais qu'il entend tout contrôler à nouveau ; on le voit en mainte occasion recourir aux ouvrages des humanistes. Ignorant le latin – ce que signifie : omo senza lettere (Cod. atl., fo 119, vo) –, il n'a pas directement accès à l'énorme héritage culturel dont se prévaut toute l'époque ; en somme, il ne s'en reconnaît pas solidaire. Il ne lui restait donc qu'à élaborer pour son propre compte une culture d'un autre type, fondée sur ce qu'il nomme la nature et l'expérience, mais orientée vers les fins précises de l'ingénieur et du peintre.
On ne trouve pas d'autre morale chez Léonard que celle des devoirs intellectuels et du respect de la vie. Dans cet amas de notes, il y a un étrange silence sur la religion et la théologie ; le fameux « Lascia star le lettere coronate (l'Écriture) perché sono somma verità » (Cahiers d'anatomie IV, fo 10, ro) a tout l'air d'un conseil de prudence teinté d'ironie. La divinité est ce qui a ordonné « l'admirable nécessité » de l'univers, où les images se croisent sans fin dans un prodigieux carrousel de rayons lumineux (Cod. atl., fo 345, ro). Et la destinée humaine, vue selon la fatalité cosmique, à la manière de stoïciens, est située comme le vol du papillon avide de venir se consumer à la lumière (Cod. Arundel, fo 156, vo). Un grand nombre d'anecdotes, de petits contes irrévérencieux, d'allusions aux écrivains satiriques de la traditiontoscane, révèlent chez Léonard un observateur impitoyable, sarcastique ou attendri, des mœurs et des comportements ridicules des hommes. Chez lui règne le scepticisme élevé de l'intellect : « Vois, lecteur, comment ajouter foi aux Anciens qui ont voulu définir l'âme et la vie, choses impossibles à saisir, tandis que tant de choses que l'expérience permet à chacun de connaître clairement et de saisir sont restées pendant tant de siècles ignorées ou mal interprétées » (Cod. atl., fo 119, vo).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André CHASTEL : membre de l'Institut, professeur au Collège de France
Classification
Médias
Autres références
-
TRAITÉ DE LA PEINTURE, Léonard de Vinci - Fiche de lecture
- Écrit par Martine VASSELIN
- 1 235 mots
- 1 média
Vers 1490, à la cour de Ludovic le More, duc de Milan, Léonard de Vinci (1452-1519) songeait déjà à composer un traité, dont le manuscrit A de la bibliothèque de l'Institut à Paris contient le projet et le premier noyau. Jusqu'à sa mort, il ne cessa de rédiger des notes, élargissant, compliquant...
-
LA JOCONDE (PORTRAIT DE MONA LISA), Léonard de Vinci
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 932 mots
- 2 médias
La Mona Lisa de Léonard de Vinci est un des tableaux les plus célèbres du monde. Ce portrait représenterait Lisa del Giocondo (née Gherardini), épouse du marchand florentin Francesco di Bartolomeo del Giocondo : Mona Lisa est ainsi surnommée La Gioconda ou, en français, La Joconde. Le peintre,...
-
LÉONARD DE VINCI (exposition)
- Écrit par Christian HECK
- 1 037 mots
- 1 média
La rétrospective qu’a consacrée le musée du Louvre à Léonard de Vinci (24 octobre 2019 – 24 février 2020) ne pouvait être qu’exceptionnelle. Le cinquième centenaire de la mort de l’artiste ; sa reconnaissance, sur tous les continents, comme un génie universel de l’art, en même temps mythe...
-
ANATOMIE ARTISTIQUE
- Écrit par Jacques GUILLERME
- 8 927 mots
- 7 médias
...suffisait pour ainsi dire à lui-même, et détournait les théoriciens d'investigations proprement empiriques. Dans cet univers quasi mystique, L. B. Alberti et Léonard de Vinci inaugurent un nouveau type d'enquête, une analyse déjà scientifique de la morphologie humaine. Alberti se constitue un système métrique... -
ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - L'architecte
- Écrit par Florent CHAMPY , Carol HEITZ , Roland MARTIN , Raymonde MOULIN et Daniel RABREAU
- 16 594 mots
- 10 médias
...l'architecture. Si Alberti apparaît davantage comme un savant, épris d'architecture, Baccio Pontelli ou Chimenti Camicia avant tout comme ingénieurs-architectes, et Léonard de Vinci comme ingénieur-artiste, génial autodidacte, et architecte, Bramante, Giuliano et Antonio da Sangallo sont présentés comme des architectes... -
ART (L'art et son objet) - Le faux en art
- Écrit par Germain BAZIN
- 6 716 mots
...provenance est la Vierge aux rochers, dont il existe deux exemplaires. On peut suivre celui de la National Gallery de Londres depuis l'atelier même de Léonard de Vinci à Milan, grâce à toute une série de contrats. Aucun renseignement, par contre, sur la genèse de celui du Louvre, repéré seulement à... -
AUTOMATE
- Écrit par Jean-Claude BEAUNE , André DOYON et Lucien LIAIGRE
- 6 649 mots
- 2 médias
...Renaissance tire parti du nouvel essor des techniques (vulgarisation du système bielle-manivelle, miniaturisation des mécanismes d'horlogerie). Si Léonard de Vinci (1452-1519), dans ses dessins anatomiques, décompose les mouvements des membres dans un jeu de fils associés à des leviers osseux, Rabelais... - Afficher les 39 références
Voir aussi
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- ITALIEN ART
- MÉCANIQUE HISTOIRE DE LA
- ITALIENNE PEINTURE, XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.
- CÈNE, christianisme
- AUTOPORTRAIT, arts graphiques
- GLACIS, peinture
- MODELÉ, arts
- CLAIR-OBSCUR
- MELZI FRANCESCO (1491 env.-1568)
- SFUMATO, technique picturale
- PEINTURE DU XVe SIÈCLE
- PEINTURE DU XVIe SIÈCLE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVe et XVIe s.
- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance
- ATTRIBUTION, histoire de l'art
- CROQUIS
- ITALIENNE PEINTURE, XVIe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.
- SANGUINE