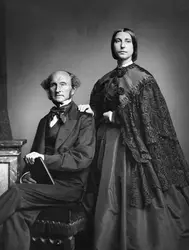LIBÉRALISME
Article modifié le
La démocratie libérale
Fruit d'une évolution historique bien plus que schéma de société conçu par l'esprit, la démocratie libérale, en son sens premier, est la conjonction du libéralisme politique et du libéralisme économique.
Le double principe de la démocratie libérale
Son « principe », pour s'exprimer comme Montesquieu, ou bien, si l'on préfère, son principe d'intelligibilité, est double. Il réside dans la dissociation de la politique et de l'économie et dans l'indissociabilité simultanée du libéralisme politique et du libéralisme économique. Celle-ci commande implicitement toute l'œuvre doctrinale de Sismondi ; celle-là fut explicitement proclamée, en France, dès les premières années de la Révolution en 1789.
Dissociation, d'abord, de la politique et de l'économie. En son sens exact, l'économie englobe la totalité des activités relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Ainsi entendue, l'économie constitue bien « le fond des choses » : pas de vie humaine sans la satisfaction, dans de bonnes ou de mauvaises conditions, des besoins de tous en biens et en services ; pas de vie sociale possible s'il n'y a pas production et consommation des biens et des services tenus pour indispensables. La politique, en son sens étymologique, c'est l'organisation de la Cité, ce sont les choix fondamentaux qui déterminent les modalités de l'organisation de la société. De façon plus précise, la politique, c'est la détermination de la forme de l'État, l'organisation des différents pouvoirs publics et la mise en œuvre de leurs compétences respectives. En son sens le plus usuel, celui qui correspond à l'expression « faire de la politique », le mot désigne tout ce qui concerne l'accès aux fonctions dont la compétence est délimitée par les différents pouvoirs publics. Au sens large ou au sens étroit du terme, la politique désigne toujours l'effort des hommes en vue d'assurer la maîtrise de leur destin, leur volonté de ne pas subir sans réagir la force des choses et de déterminer eux-mêmes les traits de la société où ils vivent. Comment, du même coup, l'un des objets essentiels de la politique ne serait-il pas l'action sur l'économie ? En d'autres termes, ceux de Bénoit, « si l'économie constitue le fond des choses, l'objet de la politique est d'acquérir la maîtrise des choses ».
Formule qui éclaire doublement le principe libéral de la dissociation de la politique et de l'économie. Elle affirme, en premier lieu, la prééminence de la politique sur l'économie. Alors que la thèse marxiste du matérialisme historique affirme la primauté de l'économie, l'organisation politique n'étant guère qu'une superstructure en dernière analyse commandée par elle, le libéralisme déduit la prééminence de la politique des enseignements de l'histoire : « C'est la politique qui tend toujours à gouverner l'économie. » Elle indique, en second lieu, que le libéralisme économique commande à l'État de « refuser de considérer l'économie comme entrant globalement dans le cercle des attributions propres de la puissance publique, État ou collectivités décentralisées, pour la laisser, en règle générale, aux particuliers ». Il reste que la dissociation est simplement institutionnelle : la décision de confier l'activité économique à l'initiative et à l'action privées implique, bien loin de l'exclure, « la maîtrise de l'économie par l'État libéral ». Moraliste et économiste, Sismondi l'enseigne : le bien-être de toutes les classes sociales, le bonheur pour tous doit constituer l'horizon de toute politique. En ce sens au moins, l'économie ne doit jamais cesser d'être subordonnée à la recherche de la liberté de la personne humaine.
Second principe constitutif du libéralisme, après celui de la dissociation « institutionnelle » de la politique et de l'économie : l'indissociabilité du libéralisme politique et du libéralisme économique. L'un et l'autre constituent les deux aspects de la société libérale. L'un et l'autre convergent vers un type particulier de société que Bénoit baptise démocratie libérale. La logique et l'histoire s'accordent-elles pour démontrer ou pour illustrer l'unité profonde du libéralisme ? À coup sûr, la question est cruciale, celle de savoir si les libéraux ont raison de plaider qu'il n'est pas de libéralisme qui ne soit à la fois politique et économique. Sont-ils fondés à dénoncer comme étant contre-nature l'alliance à laquelle aspirent certains socialistes entre un libéralisme intellectuel ou politique et un certain dirigisme économique, plus ou moins proche de la planification autoritaire ?
L'histoire enseigne, disent les libéraux, que le libéralisme résulte de la conjonction de deux mouvements, le libéralisme économique et le libéralisme politique, mouvements dont les origines sont distinctes mais qui procèdent, l'un comme l'autre, de la même aspiration des hommes à plus de liberté dans les sociétés au sein desquelles ils vivent. Et la logique exclut la possibilité de dissocier les deux dimensions du libéralisme. Il n'existe pas de libéralisme économique véritable sans libéralisme politique : « La liberté de produire et de consommer, souligne Bénoit, ne peut exister sans la liberté de choisir, faculté qui n'est précisément reconnue aux individus – producteurs et consommateurs – que dans le cadre du libéralisme politique. »
L'éthique du libéralisme
La dissociation de la politique et de l'économie, l'indissociabilité du libéralisme politique et du libéralisme économique : ensemble, les deux principes attestent l'unité profonde du libéralisme. Cette unité réside dans une philosophie ou, mieux, dans ce que Jean Baechler n'hésite pas à appeler une « idéologie ». À ce titre, le libéralisme apporte une réponse à chacune des quatre questions qualifiées de fondamentales : le Mal, le pouvoir, les conflits, l'extérieur. Le Mal est sans aucun doute possible le problème fondamental de l'existence humaine, et il déborde le champ couvert par l'« idéologie ». Selon Baechler, le libéralisme donne à cette question une réponse sans ambiguïté : « En chaque homme, il y a un tyran sanguinaire et un ange de bonté [...], chaque homme, pris individuellement ou en groupe, est un mélange indissociable de Bien et de Mal [...] ; quoi que l'on fasse, chacun a son versant lumineux et son ombre. » Cette réponse de Baechler revient à faire du libéralisme une version laïcisée du dualisme et à le distinguer par là des autres idéologies qui, toutes, cèdent au monisme. Une telle réponse comporte logiquement plusieurs implications : la primauté de l'ombre sur la lumière chez l'homme à l'état de nature ; l'impossibilité d'une cité idéale et la nécessité corrélative d'accepter une société imparfaite ; l'impossibilité d'accroître le Bien sans accroître simultanément le Mal.
Comme système de pensée ou comme disposition d'esprit, le libéralisme se donne également une certaine conception du pouvoir dans la société. Selon lui, le pouvoir est à la fois un bien et un mal : « Un bien, explique Baechler, en ce que seul le pouvoir permet de contenir la méchanceté naturelle. » Et d'ajouter : « Mais les détenteurs du pouvoir sont aussi des hommes et peuvent en user méchamment. » De là procède pour le libéralisme la règle impérieuse d'un pouvoir limité et divisé. Si l'on en croit en effet Baechler : « Le libéralisme parfait ou pur serait réalisé dans une société dont chaque membre serait un centre autonome de décision, qui consentirait des délégations provisoires et partielles du pouvoir et ne s'inclinerait devant la majorité qu'en se réservant le droit ultime à la révolte [...]. La réalité est plus ou moins éloignée de l'idéal, selon le nombre et la puissance des frottements. » Faute de pouvoir remplir les conditions pour qu'un tel idéal soit possible, l'absence d'empiétement sur l'autonomie d'autrui, l'égalité du pouvoir de décision de chacun, la société libérale s'accommode de solutions institutionnelles imparfaites : la multiplicité des partis, la liberté d'association, la division des pouvoirs, le contrôle de l'administration, les procédures d'appel...
Une troisième singularité du libéralisme réside dans la manière dont il pose le problème des conflits et dont il envisage leur résolution. À cet égard, la difficulté résulte du fait que le libéralisme reconnaît les divergences entre les opinions, les intérêts ou les profits, qu'il considère même que ces divergences constituent une richesse et une chance de salut pour les sociétés. La question, du même coup, se pose de savoir comment concilier la stabilité de l'ordre collectif et la protection de la diversité sociale. Dans l'univers de rareté qui est celui où se prennent les décisions économiques, le marché est la seule procédure pacifique permettant d'arbitrer les conflits. Le marché est la seule procédure sociale qui permette à des consommateurs et à des producteurs de s'entendre sur un prix et sur un volume de transaction. C'est la loi de l'offre et de la demande : vendeurs et acheteurs se font réciproquement des concessions, qui permettent de s'arrêter à un prix qui ne satisfait personne mais que tous acceptent. Au débat entre des intérêts divergents il n'y a pas d'autre issue, hormis la procédure du marché, que la loi du plus fort, c'est-à-dire le plus souvent celle du pouvoir politique. Encore faut-il, pour que la marché soit « bon » et juste, assujettir les opérateurs à des règles impératives.
En tant que procédure d'arbitrage, le marché ne concerne pas seulement les échanges réputés « marchands ». Partout où existent une offre et une demande, le libéralisme met toute sa confiance dans le marché, conçu comme un affrontement entre des intérêts divergents, pour parvenir à un arbitrage en suivant une voie pacifique. Ainsi existe-t-il, selon cette ligne de pensée, une offre et une demande de nuptialité, de natalité, de criminalité. Et les libéraux rappellent que l'homme politique lui-même se présente sur un marché : l'échange des suffrages contre un programme. Rappel d'autant plus salutaire à leurs yeux que l'homme politique pense bien souvent pouvoir tout promettre sans jamais rien donner.
Il reste que sur l'issue de l'affrontement entre l'offre et la demande, les libéraux n'ont pas toujours professé le même optimisme, et ils demeurent aujourd'hui encore très divisés. Pour le libéralisme des Lumières, la concurrence ne peut pas ne pas favoriser le triomphe de la raison, pour peu qu'aucune entrave ne vienne en fausser le jeu. Comme le dit encore Baechler : « ... l'équilibre ne peut être stable qu'au point où s'impose la bonne solution, devant laquelle les passions, les intérêts et les opinions s'inclineront, car le bon sens – c'est-à-dire la capacité de s'ouvrir à la vérité – est la chose du monde la mieux partagée ». En d'autres termes, la « main invisible » ou la « ruse de l'histoire », sous les apparences de mouvements browniens irrationnels, finit néanmoins par faire coïncider le réel et l'idéal. Conviction assurément contradictoire avec celle de l'imperfection irréversible des hommes : on ne peut simultanément affirmer que le Mal est indéracinable et que la Raison finira par triompher pour instaurer un ordre juste et bon.
À ce libéralisme optimiste ou angélique on peut en opposer un autre, établi sur un fond de scepticisme ou de relativisme. Dans cette seconde version du libéralisme, aucune solution ne peut être décrétée rationnelle et la coïncidence entre le réel et l'idéal n'est pas l'issue nécessaire de la confrontation des idées ou des intérêts sur le marché. Le Vrai ou le Bien ne pouvant être le privilège de personne, il faut postuler l'équivalence entre les profits et le caractère arbitraire de chacun. Une fois admis ce postulat, la confrontation sur le marché aboutit, non pas à la « bonne » solution, mais à la moins mauvaise possible, celle au moins dont la seule vertu incontestable sera d'inspirer le respect, faute de pouvoir être admise comme préférable aux autres.
Enfin, le libéralisme est singulier en ce qu'il pose autrement le problème des relations internationales et celui de la guerre. Ce sont les principes mêmes dont il se réclame qui lui commandent le respect de l'indépendance, la tolérance vis-à-vis de systèmes sociaux tenus pour « équivalents », la préférence pour les valeurs de paix ou de compromis et la condamnation simultanée des valeurs héroïco-militaires. Sur le plan international, l'idéal libéral est donc un système multipolaire et concurrentiel, calqué sur le modèle intérieur. Baechler voit dans l'adhésion à de tels principes l'ultime explication de la faiblesse des sociétés libérales, dès lors qu'elles sont confrontées avec des régimes non pluralistes. Bien que tacite, le postulat libéral selon lequel « les autres sont comme nous » anesthésie et ne peut pas ne pas anesthésier « la réaction normale de méfiance et d'opposition devant l'étranger ».
Le Bien inextricablement associé au Mal, un pouvoir limité et divisé, la confiance dans le marché comme procédure de résolution des conflits, le présupposé ethnologique de l'équivalence des cultures érigé en principe d'action dans les relations avec les autres États : le libéralisme est à la fois une façon d'interpréter la société présente et un projet pour l'avenir. Il ne se confond pas avec le conservatisme parce qu'il est avant tout une volonté de liberté, de changement et de responsabilité. Il s'oppose en tous points à l'individualisme égoïste, au repliement sur soi qui caractérise les sociétés idéocratiques, asservies qu'elles sont à une vérité qu'elles prennent ou qu'elles feignent de prendre, pour « la » vérité.
Le retour du libéralisme
Il n'est guère excessif d'avancer que la polémique partisane, depuis plus de deux siècles, est dominée pour l'essentiel par la question du libéralisme. Libérale en paroles et par son action, la Révolution de 1789 a été détournée très vite de ses objectifs par un mouvement connu sous le nom de jacobinisme. Au nom de l'égalité et de leur impatience à créer une société selon leur cœur, les Jacobins ont institué un pouvoir central et autoritaire. La terreur ne fut bientôt plus que l'autre nom de l'État, et l'autoritarisme devint celui de l'égalité. L'opposition jacobine a assurément retardé de plusieurs décennies la mise en œuvre de la démocratie libérale proclamée par 1789.
L'autre opposition virulente au libéralisme est venue de l'Église catholique. La méconnaissance du libéralisme est profonde parmi les membres du clergé, si l'on en juge par les déclarations fréquentes qui sont faites à son endroit. Souvent, ils identifient laissez-faire et libéralisme, définissant ainsi ce dernier comme le faisaient ses adversaires, plus que ses partisans. Ce n'est sans doute pas un hasard si le libéralisme a rencontré moins d'obstacles dans les pays majoritairement protestants. On sait pourtant le caractère novateur et parfaitement « libéral » de la plupart des encycliques promulguées par Rome depuis le début des années 1960. La proclamation par Rome, dont les démêlés avec la liberté d'expression furent nombreux, d'un droit de tous à une information objective revêt à cet égard une valeur symbolique de première importance.
Le libéralisme subit également les attaques de ceux qui se réclament de lui : ce sont les adversaires de l'intérieur, les plus dangereux car ils avancent masqués. Parmi eux, Malthus ou Ricardo, ces faux libéraux coupables de prêcher pour autre chose qu'un simple encadrement institutionnel du marché et de la concurrence. Plus récemment, ces économistes qui cèdent à la tentation de la technique économique ou de l'économie pure, indifférents qu'ils sont aux finalités ultimes de la société libérale et à la philosophie qui l'inspire nécessairement.
Adversaires déclarés du libéralisme, sous toutes ses formes, ceux qui tiennent l'État pour l'instrument exclusif de la liberté réelle et concrète de l'individu. Fasciné par l'État prussien, Hegel voyait dans l'État l'incarnation de l'Esprit à l'œuvre dans l'Histoire. Le libéralisme, quant à lui, n'accepte pas plus la déification de l'État que l'illusion de son dépérissement.
Mais c'est évidemment le socialisme qui constitue le principal défi au libéralisme. Entendu dans son sens le plus général, le socialisme tient pour nécessaire, au nom de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, la substitution de l'action de la collectivité à la libre initiative des individus qui la composent. Proudhon, le premier, lance l'anathème : « La propriété, c'est le vol. » Alors que les libéraux font du droit de propriété le fondement même de la liberté, le socialisme de Proudhon considère qu'elle est la cause ultime de l'inégalité, de l'injustice et de l'asservissement. Par-delà son interprétation de la société capitaliste, Marx fera de l'appropriation collective des moyens de production le passage obligé vers la société sans classe, celle où peut seulement prendre fin l'exploitation de l'homme par l'homme.
Le plus grand défi que le marxisme ait lancé contre le libéralisme réside dans la distinction, désormais classique, entre les libertés « formelles » et les libertés « réelles ». À quoi bon bénéficier de la liberté formelle, inscrite dans le droit positif, si l'on ne dispose pas des moyens de l'exercer ? Quelle est la liberté des loisirs de celui dont le temps est tout entier absorbé par le travail quotidien ? Que signifie pour un homme d'être libre de se cultiver s'il manque matériellement du minimum vital ? Semblables questions, les démocraties qui se réclament du libéralisme ne se les seraient sans doute pas posées de la même façon, en l'absence du défi marxiste. Au moins se seraient-elles montrées moins attentives aux conditions qui influent, et qui ne peuvent pas ne pas influer sur l'exercice des libertés consacrées et garanties par les dispositions juridiques.
À cette distinction, qui les oblige à la confrontation du droit avec les faits, les libéraux doivent seulement rappeler que les libertés baptisées formelles sont la condition d'existence des libertés réelles. Ou bien, selon la formule de Raymond Aron dans son Essai sur les libertés : « Contre une certaine complaisance des privilégiés, enclins à s'accommoder de la misère du plus grand nombre pourvu que leurs libertés formelles fussent respectées, la protestation marxiste n'a rien perdu de sa fraîcheur. Mais le jour où, sous prétexte de liberté réelle, l'autorité de l'État s'étend à l'ensemble de la société et tend à ne plus reconnaître de sphère privée, ce sont les libertés formelles que revendiquent les intellectuels et les masses elles-mêmes. »
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis BALLE : professeur à l'université de Paris-II-Panthéon-Assas
Classification
Média
Autres références
-
AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD
- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN
- 29 789 mots
- 28 médias
...Les premières orientations économiques du gouvernement d'unité nationale et de ses successeurs confirmèrent une volonté d'ouverture internationale, de gestion libérale de l'économie et d'inscription dans une économie de marché (affiliation au GATT en 1993, abandon des nationalisations, indépendance... -
ALGÉRIE
- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN
- 41 845 mots
- 25 médias
...autre programme dit de concessions agricoles qui, tout en encourageant l'entrepreneuriat agricole, favorise l'ouverture du secteur au capital étranger. L'État s'oriente vers une politique libérale même si, dans certains cas, les bénéficiaires étaient des chômeurs recrutés pour mettre en valeur les terres.... -
ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et contemporaine
- Écrit par Michel EUDE et Alfred GROSSER
- 26 892 mots
- 39 médias
...davantage ceux que l'on qualifie, dès cette époque, de « libéraux » et de « nationaux ». N'y voyons pas deux écoles, deux directions de pensée distinctes. Libéraux, ils s'inspirent des exemples de la France et de l'Angleterre pour réclamer des constitutions comportant des assemblées représentatives élues... -
ARON RAYMOND (1905-1983)
- Écrit par Bernard GUILLEMAIN
- 6 089 mots
Le problème consiste à saisir dans quelle mesure la multiplicité référentielle dérive dulibéralisme affirmé par Raymond Aron ou lui sert de fondement. Dans un article intéressant, Alain Bloom écrit : « Le libéralisme d'Aron était celui de Locke, Montesquieu, John Stuart Mill et,... - Afficher les 83 références
Voir aussi