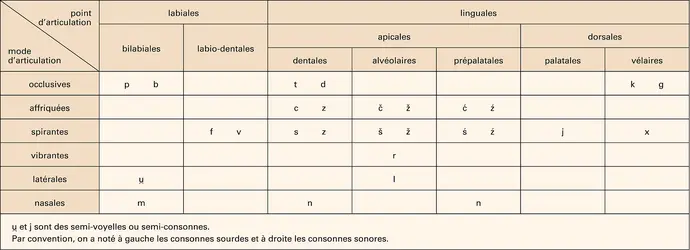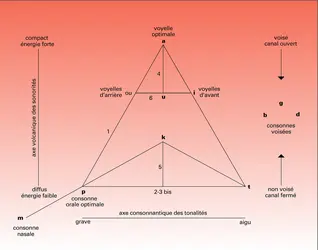LINGUISTIQUE Domaines
Article modifié le
Morphologie et syntaxe
Ces deux sous-domaines sont constitutifs de la grammaire : ils étudient la forme et l'organisation des unités significatives (dites de « première articulation »).
La morphologie
La morphologie est l'étude de la formation des mots et de leurs variations. Dans une langue comme le français, certains mots sont simples (« maison »), d'autres sont complexes (« maisonnette »), certains sont invariables (« pour », « et »), d'autres sont variables (« cheval/chevaux »).
La variation dans la forme des mots procède de la flexion, lorsque certains éléments non autonomes, appelés désinences, sont adjoints à une forme de base : ainsi, en français, les suffixes de conjugaison sur une base verbale (« chant-e, -ais, -erions »...), les désinences de genre (« avocat, -e ») et de nombre (« livre, -s ») sur une base nominale ; ou, dans des langues à déclinaison, les désinences de cas (latin « ros-a, -ae, -is »...).
À côté des formations grammaticales de ce type, il existe des affixations lexicales, dites dérivations, qui permettent de construire des mots complexes à l'aide de préfixes ou de suffixes, par exemple le célèbre « anti-constitution-(n)-el-(l)-e-ment ». Certains autres mots complexes sont construits par composition : « timbre-poste » et « portefeuille » sont des mots composés, construits à partir d'éléments autonomes.
La tâche de la morphologie consiste donc à analyser les formes des mots d'une langue donnée en morphèmes (unités minimales de signification, autonomes ou non), et à assigner à chaque mot une catégorie morphosyntaxique (également appelée partie du discours) : nom, verbe, article, etc. Le découpage en morphèmes est une tâche difficile, qui conduit à concevoir le morphème comme une unité abstraite et à élaborer des concepts renvoyant à des unités non directement observables. Ainsi, le concept de « morphème zéro » : « livre » s'analysera comme « livre- » (radical) + « -ø » (morphème zéro, marque du singulier) – par opposition au morphème « -s » (marque du pluriel). Ou encore le concept de variantes « allomorphes » : « all- », « ir- » et « v- » sont trois allomorphes, c'est-à-dire trois variantes de forme du même morphème radical du verbe « aller ». La morphologie de l'écrit peut être très différente de celle de l'oral : le français ne fait pas de différence, à l'oral, entre « leur secrétaire semblait réjoui », « leur secrétaire semblait réjouie », « leurs secrétaires semblaient réjouis » et « leurs secrétaires semblaient réjouies ».
La morphologie entretient des liens avec la phonologie (on parle parfois de morphophonologie), la syntaxe (on parle de morphosyntaxe, autre nom pour désigner la grammaire) et le lexique. De ce fait, le rôle et la place accordés à la morphologie au sein de l'analyse linguistique varient selon les théories.
La syntaxe
La syntaxe a pour objet l'organisation des morphèmes et des mots au sein de la phrase ; elle doit décrire la structure de la phrase, ainsi que la fonction des différents éléments qui la composent.
Les constituants de la phrase sont généralement organisés selon une structure hiérarchique, qui peut être visualisée à l'aide de diverses représentations graphiques : boîtes, parenthésages ou arborescences. Il existe toutefois un certain nombre de phénomènes qui se prêtent mal à une représentation hiérarchique : coordination, ellipse, apposition, apostrophe, etc.
Initiée par l'école distributionnaliste, la méthode dite de l'analyse en constituants immédiats permet de segmenter la phrase et d'en caractériser la structure syntaxique en termes d'emboîtements successifs de groupes de morphèmes, appelés syntagmes. Analyse que la grammaire générative reprend pour la formaliser en termes de règles de réécriture dans le cadre d'une grammaire syntagmatique ; le symbole de phrase (P) se réécrit (→) comme la donnée d'un syntagme nominal (SN) et (+) d'un syntagme verbal (SV), soit : P → SN + SV. À son tour, chacun des deux types de syntagmes fait l'objet d'une réécriture : par exemple SN → Dét. (déterminant) + N (nom), et SV → V (verbe) + SN ; etc. Dans une minigrammaire de ce type, le premier SN aura la fonction de sujet et le SN intégré au syntagme verbal aura la fonction d'objet. Des règles lexicales permettent ensuite de passer de ces catégories à des mots de la langue ; ainsi les règles : Dét.→ « le », N → « chat » ou « rat », et V → « mange », permettent d'obtenir : « le chat mange le rat » (mais aussi « le rat mange le chat » qui est également une phrase grammaticale !). À ce type de grammaire syntagmatique, on peut ajouter des règles permettant de dériver une structure syntaxique à partir d’une autre, par exemple pour représenter le passage de l'actif au passif (« le rat est mangé par le chat »). Comme il a été dit plus haut, d'autres types de modèles formels existent, qui visent notamment à une meilleure intégration des faits de lexique dans l'analyse syntaxique.
Grammaire traditionnelle, grammaires scolaires, théories linguistiques : la diversité est grande, tant dans le choix des catégories et des fonctions que dans le mode de description et de représentation de la structure des phrases. Diversité qui témoigne de la complexité de la tâche.
L'une des principales difficultés auxquelles est confrontée l'analyse syntaxique des langues tient au fait que l'ordre des mots, très variable d'une langue à l'autre, est loin de refléter univoquement la structure de la phrase. Ainsi, en français, certains constituants sont discontinus : c'est le cas, par exemple, du verbe « a … mangé », d'une part, et de la négation « ne … pas », de l'autre, dans la phrase « il n'a pas mangé ». Certains accords entre constituants se font à distance, comme dans la phrase « la pomme qu'il a mangée ». Et la place d'un constituant n'indique pas de façon nécessaire sa fonction : dans « il chante la chanson », le SN qui suit le verbe est un objet, mais dans « il chante le matin », c'est un circonstant. De façon générale, toutes les phrases qui ne correspondent pas à la structure simple prototypique « SN(sujet)-V-SN(objet) » posent des problèmes d'analyse : inversions du sujet, constituants clivés, éléments thématisés, cascades de groupes prépositionnels, phrases complexes comportant des groupes infinitifs ou participiaux, etc., sont autant de sources de difficulté pour les théories syntaxiques.
Par ailleurs, l'analyse syntaxique de la phrase se heurte à l'existence d'ambiguïtés structurelles, qui pose le problème de savoir à quel endroit de l’arbre syntaxique il convient de rattacher certains constituants : ainsi, dans la phrase « Marie a rapporté un vase de Chine , le constituant « de Chine » doit-il être rattaché à « a rapporté » ou à « un vase » ? : de même, dans « C’est un professeur de football américain », l’adjectif « américain » qualifie-t-il « professeur » ou « football » ?
Enfin, l'un des principaux enjeux actuels en matière de syntaxe porte sur la définition et la délimitation de l'unité d'analyse qu'est la phrase. L'idée naïve selon laquelle la phrase serait une suite de mots commençant par une majuscule et se terminant par un point est à l'évidence erronée. La plupart des approches (génératives ou non) s’inscrivent de fait dans la tradition grammaticale et tiennent à conserver la notion de phrase (définie sur des critères syntaxiques et non pas typographiques), quitte à s'interroger sur ses limites inférieure et supérieure : a-t-on déjà affaire à une phrase dans le cas de « Bien, et toi ? » ? A-t-on encore affaire à une seule phrase dans le cas de « Tous les hommes s'enfuirent. Sans compter les femmes et les enfants » ? Toutefois, certains auteurs, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler sur la langue parlée ou sur des productions discursives, préfèrent parler d'« énoncé » (unité minimale d'énonciation), alors que d'autres, cherchant une unité de taille supérieure à celle de la phrase, reprennent à leur compte la dénomination de « période ». Un terme qui, dans la tradition rhétorique, désignait une séquence complexe correspondant au développement logique de la pensée et à un rythme harmonieux plus ou moins calé sur un groupe de souffle.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Catherine FUCHS : directrice de recherche émérite au CNRS
Classification
Médias
Autres références
-
AFFIXE, linguistique
- Écrit par Robert SCTRICK
- 382 mots
Lors de l'inventaire des morphèmes d'un système linguistique, on est conduit à distinguer plusieurs sortes d'unités identifiables dans l'ordre phonétique et partageant la caractéristique de se rapporter au plan de la signification : parmi ces unités, les unes ont un contenu...
-
ALLÉGORIE, notion d'
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 1 455 mots
Cette dernière lui préfère néanmoins les termes métaphore, que nous rencontrions pour commencer, et image. Lalinguistique et la théorie de la littérature, héritières dans une certaine mesure du romantisme, ont renouvelé l'intérêt pour ce que Tzvetan Todorov appelle « la décision... -
AMBIGUÏTÉ, linguistique
- Écrit par Pierre LE GOFFIC
- 685 mots
Un mot ou un énoncé sont dits ambigus quand ils sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Cette définition intuitive étant très large, on s'efforce en linguistique de la préciser en circonscrivant, parmi tous les malentendus, équivoques et autres imprécisions du langage,...
-
ANALYSE & SÉMIOLOGIE MUSICALES
- Écrit par Jean-Jacques NATTIEZ
- 5 125 mots
- 1 média
À l'époque du structuralisme triomphant, la sémiologie musicale rencontre les modèles d'analyse linguistique pour des raisons à la fois épistémologiques et esthétiques. - Afficher les 135 références
Voir aussi
- FAMILLE LINGUISTIQUE
- LEXICOGRAPHIE
- LEXICOLOGIE
- SIGNIFICATION
- LEXIQUE
- SEILER HANS-JACOB
- GRAMMATICALISATION
- LAZARD GILBERT (1920-2018)
- GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE & TRANSFORMATIONNELLE
- COMPOSITION, linguistique
- PHONATION
- LEXICOMÉTRIE
- ÉCRIT CODE, linguistique
- ORAL CODE, linguistique
- UNITÉS LINGUISTIQUES
- GRAMMAIRE COMPARÉE
- RÈGLE DE RÉÉCRITURE, linguistique
- LINGUISTIQUE HISTORIQUE ou GRAMMAIRE HISTORIQUE
- DISTINCTIVITÉ, linguistique
- ACOUSTIQUE
- PROCESSUS COGNITIFS