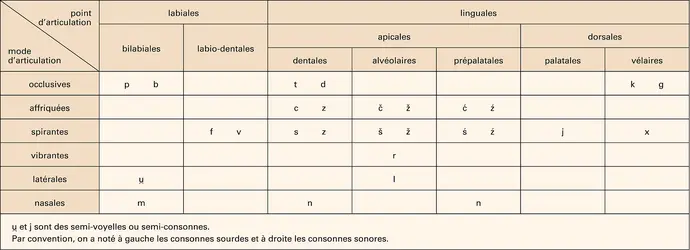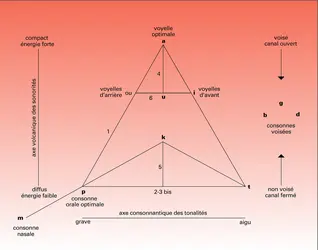LINGUISTIQUE Domaines
Article modifié le
La linguistique diachronique
La linguistique diachronique est le domaine de la linguistique qui s'intéresse à l'histoire et à l'évolution des langues. Né avec la grammaire comparée, ce secteur a connu une relative désaffection à l'époque du structuralisme, mais on assiste depuis quelques décennies à un renouveau des approches diachroniques.
La grammaire comparée
On doit au Britannique William Jones d'avoir, à la fin du xviiie siècle, avancé l'idée d'une parenté linguistique entre le sanskrit (langue ancienne de l'Inde), le grec et le latin. À sa suite, les chercheurs se livreront, durant tout le xixe siècle, à la recherche de la « famille indo-européenne » de langues, dont ils montreront qu'elle regroupe une dizaine de branches. L'indo-européen, tronc commun dont dérivent ces différentes branches de langues, est reconstruit dans ses traits phonétiques, morphologiques et dans certains de ses traits lexicaux à partir de systèmes complexes de correspondances. La méthodologie repose, en particulier, sur l'établissement de lois phonétiques (loi de Grimm, loi de Verner...) qui caractérisent l'évolution en termes de transpositions d'un système linguistique à un autre.
En Europe, la famille des langues indo-européennes se compose de six grandes branches. L'italique a donné naissance au latin, dont dérivent les langues romanes. Le germanique se divise en deux sous-groupes : le germanique de l'Ouest (ancêtre notamment de l'allemand, de l'anglais et du néerlandais) et le germanique du Nord (ancêtre du danois, du norvégien et de l'islandais). L'hellénique a donné le grec ancien puis le grec moderne. Le celtique connaît une sous-branche gaélique (source de l'irlandais) et une sous-branche brittonique (source du gallois, du breton, mais aussi du gaulois, qui s'est éteint). Le balto-slave a donné, du côté balte, le lituanien et le letton ; du côté slave, il s'est subdivisé en trois : le slave de l'Est (source du russe, du biélorusse et de l'ukrainien), le slave de l'Ouest (source du polonais, du slovaque et du tchèque) et le slave du Sud (source du bulgare et du macédonien, ainsi que du serbe, du croate et du slovène). Enfin, la sixième branche est celle de l'albanais.
En droit, la méthode utilisée pour la reconstruction de l'indo-européen avait vocation à permettre l'établissement d'autres familles de langues. C'est dans cet esprit que l'on a cherché à dresser le catalogue des « langues du monde » (titre d'un magistral ouvrage publié sous la direction d'Antoine Meillet et de Marcel Cohen) et de leurs filiations, même si l'exhaustivité d'une telle entreprise reste hors d'atteinte pour des raisons diverses. On évoque ainsi un certain nombre de grandes familles, comme celles des langues chamito-sémitiques, des langues bantoues, des langues ouraliennes ou encore des langues euskaro-caucasiennes. Toutefois, aux yeux de nombre de diachroniciens, l'indo-européen semble constituer le seul prototype parfait d'une véritable « famille », entendue au sens d'un ensemble de langues unies par des liens de parenté génétique et représentant des évolutions différentes d'une même souche linguistique. Les travaux de Meillet et de Benveniste restent, dans ce domaine, des modèles du genre.
Le renouveau des approches diachroniques
Le renouveau des approches diachroniques, auquel on assiste depuis le dernier quart du xxe siècle, procède de deux ordres de facteurs.
En premier lieu, la linguistique historique s'est trouvée, de fait, confrontée aux débats récents sur l'origine des langues et du langage, qui conduisent à s'interroger, en amont de l'indo-européen, sur la possibilité de reconstruire quelques « super-familles » originelles, voire une hypothétique langue mère unique. Malgré la défiance des diachroniciens, qui récusent par prudence méthodologique toute tentative de cet ordre, la vogue de la problématique des origines (orchestrée, entre autres, par les anthropologues et les généticiens) a incontestablement contribué à raviver l'intérêt des chercheurs pour l'histoire et l'évolution des langues.
Par ailleurs, des facteurs internes à la linguistique diachronique elle-même ont conduit au renouveau de cette sous-discipline. D'une part, elle a su tirer profit des nouveaux outils informatiques et des diverses ressources électroniques permettant de traiter les corpus textuels : pour l'étude d'états de langue disparus, mais ayant laissé des traces écrites, l'exploitation exhaustive de toutes les données disponibles, ainsi que les possibilités de calculs sur ces données (statistiques, études de cooccurrences lexicales...) ont conduit à de réelles avancées. D'autre part, de nouveaux types de modèles théoriques ont été élaborés, qui renouvellent l'approche des faits d'évolution. C'est le cas, notamment, de la théorie de la grammaticalisation, popularisée par les travaux d'Elizabeth Traugott : lorsqu'un mot lexical ayant un sens plein (par exemple en français, « pas », « mie » ou « goutte ») en vient à perdre ce sens pour fonctionner comme un pur outil grammatical (par exemple comme marqueur de la négation), on dit qu'il se grammaticalise. Ce procédé, massivement attesté dans l'histoire des langues, constitue l'un des ressorts de l'évolution linguistique. Sur la lancée, d’autres mécanismes d’évolution ont attiré l’attention des chercheurs : d’un côté, la lexicalisation (entrée dans la langue d’une nouvelle unité lexicale résultant d’un emprunt à une autre langue, d’un néologisme ou d’une métaphore figée) et, de l’autre, la pragmaticalisation (transformation d’une unité de la langue en marqueur discursif, par exemple lorsque « d’ailleurs », passe de circonstant de lieu à marqueur de discours, synonyme de « du reste »).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Catherine FUCHS : directrice de recherche émérite au CNRS
Classification
Médias
Autres références
-
AFFIXE, linguistique
- Écrit par Robert SCTRICK
- 382 mots
Lors de l'inventaire des morphèmes d'un système linguistique, on est conduit à distinguer plusieurs sortes d'unités identifiables dans l'ordre phonétique et partageant la caractéristique de se rapporter au plan de la signification : parmi ces unités, les unes ont un contenu...
-
ALLÉGORIE, notion d'
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 1 455 mots
Cette dernière lui préfère néanmoins les termes métaphore, que nous rencontrions pour commencer, et image. Lalinguistique et la théorie de la littérature, héritières dans une certaine mesure du romantisme, ont renouvelé l'intérêt pour ce que Tzvetan Todorov appelle « la décision... -
AMBIGUÏTÉ, linguistique
- Écrit par Pierre LE GOFFIC
- 685 mots
Un mot ou un énoncé sont dits ambigus quand ils sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Cette définition intuitive étant très large, on s'efforce en linguistique de la préciser en circonscrivant, parmi tous les malentendus, équivoques et autres imprécisions du langage,...
-
ANALYSE & SÉMIOLOGIE MUSICALES
- Écrit par Jean-Jacques NATTIEZ
- 5 125 mots
- 1 média
À l'époque du structuralisme triomphant, la sémiologie musicale rencontre les modèles d'analyse linguistique pour des raisons à la fois épistémologiques et esthétiques. - Afficher les 135 références
Voir aussi
- FAMILLE LINGUISTIQUE
- LEXICOGRAPHIE
- LEXICOLOGIE
- SIGNIFICATION
- LEXIQUE
- SEILER HANS-JACOB
- GRAMMATICALISATION
- LAZARD GILBERT (1920-2018)
- GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE & TRANSFORMATIONNELLE
- COMPOSITION, linguistique
- PHONATION
- LEXICOMÉTRIE
- ÉCRIT CODE, linguistique
- ORAL CODE, linguistique
- UNITÉS LINGUISTIQUES
- GRAMMAIRE COMPARÉE
- RÈGLE DE RÉÉCRITURE, linguistique
- LINGUISTIQUE HISTORIQUE ou GRAMMAIRE HISTORIQUE
- DISTINCTIVITÉ, linguistique
- ACOUSTIQUE
- PROCESSUS COGNITIFS