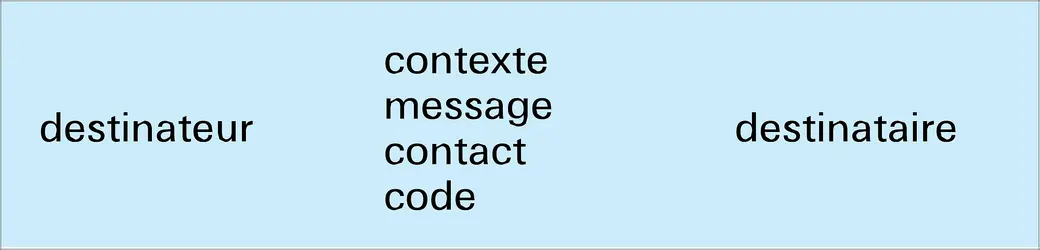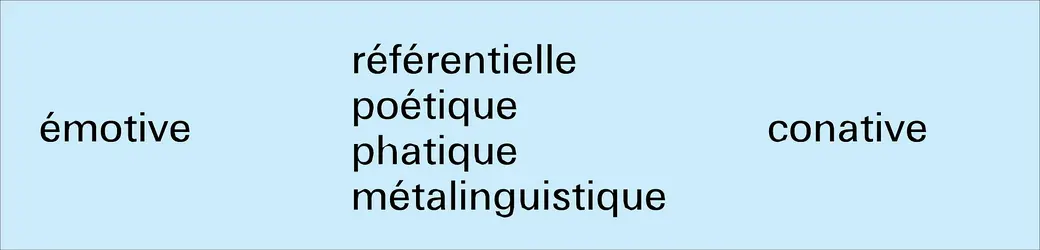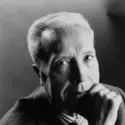LINGUISTIQUE & LITTÉRATURE
Article modifié le
Stylistiques et rhétoriques
L'idée d'une complémentarité par succession de la linguistique et de la littérature a pour elle les apparences de l'évidence ; elle s'inscrit, d'une part, dans le schéma héréditaire du cursus pédagogique ; elle achève, d'autre part, le schéma de la complexité ascendante – complaisamment entretenu par la linguistique – selon lequel on va naturellement du phonème au mot, du mot au syntagme et du syntagme à la phrase, tout en allant – « en passant » – du non-sens au sens. Le linguiste s'arrêtant aux limites de la phrase, au « littéraire » de compléter le dispositif en passant de la phrase au texte.
Mais ce seuil, dont Benveniste a tenté de formuler la théorie en distinguant, dans un article célèbre, « Sémiologie de la langue » (in Semiotica, I et II), un domaine sémiotique antérieur au sens et un domaine sémantique, ne constitue pas une ligne de partage aussi stable et aussi sûre qu'on semble vouloir le croire.
Tout se passe comme si c'étaient les effets pratiques de cette limite qui en déterminaient le statut théorique, tout en la maintenant aussi incertaine et mobile que possible. Le « seuil » fonctionne, en effet, à la satisfaction générale : les pratiques qu'il autorise et semble fonder sont aussi avantageuses pour le linguiste que pour l'analyste des œuvres littéraires.
Ainsi se trouve en effet séparé, pour le linguiste, un au-delà qui le dispense de s'interroger sur certaines des opérations auxquelles il recourt, en fait, dans l'en deçà de cette coupure ; ainsi se trouve justifié pour l'analyste de textes (historien, sociologue ou littéraire) un en deçà préconstruit qui le dispense de s'occuper de fonder ses opérations sur les textes.
Le fonctionnement de ce seuil est fort bien illustré par les manœuvres auxquelles donnent lieu les analyses stylistiques et rhétoriques. Apparemment, le partage va de soi – comme l'atteste une longue pratique pédagogique – entre langue et style. C'est après l'étude abstraite du grammairien ou du linguiste qu'intervient l'analyse de la mise en œuvre de la langue dans les textes littéraires, repérage des choix heureux du bon auteur.
La stylistique a besoin, pour déployer ses analyses, d'un niveau de base, d'un « degré zéro » du langage, que lui fournit la description linguistique ; la linguistique a besoin d'un réceptacle pour les énoncés trop complexes pour son modèle de phrase et la notion de « style » le lui fournit. Les deux disciplines s'entendent ainsi pour définir une norme ou, plus exactement, s'entendent pour ne pas la définir, se déchargeant l'une sur l'autre de cette tâche à la fois ingrate et dangereuse. La détermination de ce degré neutre se réalise ainsi négativement, à la faveur de la notion d'« écart ». On a là, on le voit, une notion à la fois essentielle et clandestine : aucune des deux disciplines ne peut l'assumer, sans qu'aucune, néanmoins, puisse s'en passer.
Bien que notion donnée comme secondaire, la notion d'écart fonctionne, en fait, en linguistique, comme une notion primitive. La normalisation des énoncés qui permet de les organiser en objets de connaissance s'opère à la faveur de la différence supposée évidente entre discours simple et discours orné, entre phrase acceptable et phrase déviante, entre langue quotidienne (supposée simple) et langue littéraire. Il y a une pré-stylistique du linguiste, dont la stylistique littéraire n'est – sous ses divers avatars (endroit ou envers) – que la réciproque.
La confusion qui règne autour de la notion de connotation fournit une excellente illustration du processus. Fort bien accueillie en milieu littéraire, elle offre, en effet, à l'analyse des textes, un instrument linguistique à sa mesure. Certes, on déplore souvent son faible degré d'élaboration scientifique. C'est que, telle qu'elle est, elle suffit au linguiste ; il n'est pas de son intérêt de l'éclairer davantage ; la préciser serait dangereux car elle ne l'intéresse que de l'extérieur ; son rôle est de fournir un alibi à la notion réciproque de dénotation et de faciliter la neutralisation nécessaire à la constitution d'un objet linguistique spécifique.
De fait, les rencontres sont ici frappantes entre un linguiste méticuleux comme Harris qui, dans ses Structures mathématiques du langage, est amené à écarter précisément les types d'énoncés que retiennent des poéticiens comme Jean Cohen (Structure du langage poétique) ou des rhétoriciens comme les membres du Groupe « Mu » (Rhétorique générale). Les procédures d'exclusion et d'inclusion fonctionnent ici symétriquement. Et quand les plus naïfs de ces théoriciens se hasardent à donner de la norme une formulation positive, on les voit les uns et les autres se référer à une prétendue « langue scientifique » qui représenterait le degré neutre du langage : le scientisme trouve dans le langage scientifique, qu'il emprunte, à la fois son critère de base et l'assurance de sa propre positivité.
Les opérations stylistiques et rhétoriques jouent de la séparation des deux domaines et permettent à la fois de renvoyer la subjectivité hors du domaine linguistique et de l'exalter dans le domaine littéraire. C'est ainsi que la stylistique de Bally (Traité de stylistique française) se chargeait de rendre compte de tout ce qu'une linguistique limitée au langage représentatif laissait pour compte : énoncés exclamatifs, fonction de l'intonation, figures diverses de la rhétorique. La stylistique littéraire d'un Spitzer (Études de style) ou d'un Cressot (Le Style et ses techniques) tentait, de son côté, de décrire l'usage individuel du langage, tel qu'il se réalise dans les œuvres littéraires. Complémentarité de la langue et de la parole qui pouvait trouver dans une lecture du Cours de Saussure un semblant de justification théorique.
C'est cette même théorie de l'écart qui a alimenté la stylistique statistique, illustrée notamment par les recherches de Pierre Guiraud (La Stylistique) et de Charles Muller (Initiation à la statistique linguistique), en France, et qui a connu un grand succès en Allemagne et aux États-Unis.
Malgré ses efforts pour sortir de l'ornière de l'écart, la stylistique immanente de Michaël Riffaterre (Essais de stylistique structurale) reste dans la même orientation théorique. On suppose ici que l'œuvre produit son propre code, un code a posteriori qui s'oppose au code a priori de la langue et du genre. Mais on abandonne ainsi le recours à la linguistique pour tomber ou dans une sorte de sociologie ou dans l'arbitraire culturel de l'explication de texte. Le style se réduit alors, classiquement, à une « mise en relief ».
Il en va de même pour les tentatives d'application immédiate de la grammaire générative classique à l'étude du style. La complémentarité des deux démarches est ici très visible : « Generative Grammars and the Concept of Literary Style » de Ohmann, ou « Stylistics and Generative Grammar » de Thorne (in Change) proposent de faire le chemin inverse de celui qui servait à constituer la norme.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre KUENTZ : maître assistant honoraire à l'universi-té de Paris VIII
Classification
Médias
Autres références
-
RHÉTORIQUE, notion de
- Écrit par Alain BRUNN
- 1 664 mots
La rhétorique désigne l'art du rhéteur, de l'orateur grec : en ce sens, elle engage une définition du langage et de ses pouvoirs. Elle est l'art de bien parler, c'est-à-dire d'agir par la parole sur un auditoire, de le convaincre par l'argumentation, mais aussi par...
-
ARTS POÉTIQUES
- Écrit par Alain MICHEL
- 5 906 mots
- 3 médias
...décrire objectivement les règles d'élaboration du texte, à dégager les « constantes du poème » (A. Kibédi-Varga), est évidemment liée aux progrès de la linguistique. La poétique retrouve ainsi ses relations avec l'étude de la forme (versification, figures). Mais la théorie moderne souligne que, dans le... -
BARTHES ROLAND (1915-1980)
- Écrit par Philippe DULAC
- 4 712 mots
- 1 média
Si donc la sémiologie relève de lalinguistique, l'affaire devient relativement simple. Il suffit d'emprunter à la linguistique sa rigueur de méthode et ses concepts les plus opératoires (principalement ces couples fondamentaux que sont : langue/parole, signifiant/signifié, syntagme/paradigme, dénotation/connotation),... -
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO et Antoine COMPAGNON
- 12 922 mots
- 4 médias
Pour le nouveau textualisme français, il y a deux ou trois références plus proches que l'aristotélisme : lalinguistique saussurienne, le formalisme russe et le New Criticism anglo-américain, tardivement découverts par une culture littéraire et philosophique parisienne relativement isolée du reste... - Afficher les 21 références
Voir aussi