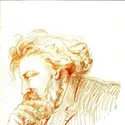LITTÉRATURE & PSYCHANALYSE
Article modifié le
L'inconscient pour l'inconscient
Un léger retour en arrière nous conduit à prendre en considération une autre ligne des investigations de Freud en matière d'art. Sonder les grandes œuvres avec les outils de la psychanalyse donne parfois des informations sur l'esprit humain, plus particulièrement sur des constantes du comportement et des usages si fréquents, si répandus dans les différentes sociétés qu'on ne sait plus très bien dire qui, de la culture ou de la nature, en est responsable (le statut intermédiaire à cet égard des formations inconscientes permet de couper court aux spéculations). Les recherches sur les rites et les dogmes de la religion ont été fructueuses, ainsi que celles qui ont porté sur les systèmes de parenté, les croyances en l'au-delà ou certaines interdictions et sanctions coutumières ou juridiques. En dehors du champ institutionnel, les productions artistiques et spécialement les créations littéraires – épopée, théâtre, fable – se sont révélées riches elles aussi en renseignements d'ordre général sur ce qui importe à l'homme du point de vue psychique et caractérise sa dimension d'animal culturel. Dans ce type d'exploitation du domaine littéraire, au sens large de ce mot – c'est-à-dire en incluant les traditions orales qui forment l'embryon historique de tous les récits (mythologique, religieux, gnomique, social ou politique) –, dans ce champ de recherche, donc, ce sont bien les réalisations narratives elles-mêmes qu'on interroge, pour mieux connaître l'âme humaine et non pour confirmer la valeur d'une hypothèse scientifique. Différence d'accent qui a son importance.
Freud fut heureux, à un moment donné, de prouver que les fous de nos romans possédaient une organisation inconsciente souffrant d'un mal reconnu, que leurs rêves s'interprétaient comme les nôtres ; mais, dans les essais plus tardifs, il s'est penché sur des œuvres littéraires afin de résoudre diverses énigmes de notre fonctionnement psychique. Il a repéré certains modèles de pensée dont les peuples de la terre avaient dès longtemps relevé l'originalité ; ces modèles ont en général partie liée avec de grandes formes linguistiques et discursives, avec des effets rhétoriques, des genres littéraires, des expressions ou usages symboliques. On évoquera ici, sans insister, les pages que le maître de Vienne a consacrées à l'humour, à l'ironie, au comique parallèlement au mot d'esprit (Witz), dans le livre qui porte ce titre : beaucoup d'exemples sont empruntés à la littérature. On citera, à l'autre extrémité de l'éventail, la célèbre étude du Thème des trois coffrets (1913), qui met en évidence des images (trois femmes), des conduites (choix mortel) et des motifs élémentaires (or, plomb) qui se rencontrent dans des œuvres appartenant à des genres, des époques, des cultures différentes – véritable travail de comparatiste qui prélude à une interprétation de style anthropologique. Surtout, on se gardera d'oublier et même de traiter cavalièrement l'analyse exemplaire de L'Inquiétante Étrangeté (1919) : elle a jeté une lumière nouvelle sur le phénomène du fantastique, qui traverse un grand nombre de cantons dans le territoire de l'art.
Cette réflexion sur l'Unheimliche (terme allemand intraduisible sans périphrase ou néologisme – je propose « infamilier » – qui suggère la réapparition terrifiante d'un refoulé où nous refusons de reconnaître quelque chose de très intime, lié à notre passé infantile) s'appuie sur une lecture suivie du conte d'Hoffmann, L'Homme au sable. Cette lecture fait apparaître des dimensions inédites au sein du conte, où la rencontre des yeux arrachés avec l'angoisse de castration concurrence la contemplation de l'automate Olympia et le jeu des appareils optiques pour rendre compréhensible le suicide du héros, au terme d'un échec amoureux qui porte les couleurs de la mélancolie. Mais Freud va au-delà d'un parcours du conte pour lui-même. S'il ne prend toujours pas en compte la totalité du texte, préférant accompagner quelques séries de représentations dont il démêle l'enchaînement, il fournit en revanche un éclairage étonnant à certaines constantes de notre imagination, qui recherche paradoxalement son plaisir au sein même de ce qui lui fait peur.
Il n'y a guère que Marthe Robert qui soit allée plus loin dans cette direction lorsqu'elle s'est attachée, dans Roman des origines et origines du roman (1972), à établir des liens étroits entre le genre romanesque tout entier et une formation localisée, encore que très fréquente, le « roman familial des névrosés ». Elle classe ainsi les fictions en deux genres, selon qu'elles reproduisent le schéma de l'enfant trouvé merveilleux qui s'invente une ascendance princière, ou celui du bâtard réaliste qui prend en compte la faute de sa mère avec un homme qu'il ne (re)connaît pas comme son père. De telles spéculations sont excitantes pour l'esprit. Elles n'apportent pas grand-chose, toutefois, au lecteur qui s'intéresse à ce qui se passe précisément dans les dessous d'un récit romanesque. On peut manifester une réserve du même type, accompagnée du même plaisir intellectuel, devant les analyses que Charles Mauron a effectuées sur le « genre comique » (1963) à partir des comédies de Molière, dans lesquelles un jeune premier, toujours, triomphe d'un barbon qui séquestre une femme à son profit. Il est vrai que le « héros » de ces pièces commet les exactions mêmes dont est victime le « héros » tragique, fatalité et grandeur en plus (Mauron a relu également les tragédies de Racine). Mais est-ce là ce qui donne du mystère à un Tartufe ou à un Alceste, à Bérénice ou à Britannicus ?
Un cas qui retient l'attention, à cause de son unicité, c'est celui de Hamlet (le personnage) et Hamlet (la pièce) – ces deux noms figurant dans le titre d'un essai d'André Green. Il y a belle lurette qu'on s'est aperçu, Freud le tout premier et Ernest Jones à sa suite, que le drame de Shakespeare se présentait comme une reprise, rajeunie et complétée (compliquée, aussi) de la tragédie d'Œdipe roi : le père trahi demande à son fils comme preuve d'attachement qu'il tue sa mère – voilà l'œdipe inversé, qu'on appelle négatif et qui coexiste avec l'autre en chacun de nous – et le jeune Hamlet profite d'une représentation théâtrale de son histoire pour exécuter en la personne de Polonius un amant supposé de la reine – en jouant cette fois la version positive du complexe. On n'a pas fini de rêver sur le génie du dramaturge moderne qui a trouvé le moyen de conjuguer de la sorte le mythe illustré par Sophocle avec la prescience de ce que devaient découvrir et perfectionner les hérauts de la psychologie du xxe siècle. Multiples sont les leçons que donnent l'étude du prince de Danemark et le déchiffrement des détails foisonnants dont est riche une pièce universellement appréciée et maintes fois rejouée, pour ne pas dire « interprétée », devant tous les publics et dans toutes les langues du monde.
Cette dernière remarque n'est pas innocente : nous nous occupons dans ce chapitre d'une variété particulière d'œuvres littéraires, celles qui forment le patrimoine de l'humanité. Celles qu'on peut nommer « transculturelles et transhistoriques », dont on peut dire qu'elles ont un contenu si puissant, si puissamment universel, que la traduction, avec son cortège de méfaits et de maléfices, ne les déforme presque pas, ne les gâte que superficiellement, à peine les égratigne. Il existe une autre variété de ces œuvres : les contes de fées. Le fait qu'ils aient été longtemps colportés oralement n'empêche pas qu'ils appartiennent à l'ordre de l'écriture, bien au contraire : la sédimentation lente, souvent séculaire, grâce à quoi ils ont acquis le contour et le contenu inusables qui les caractérisent, est pour eux l'équivalent exact d'une composition, de la création par un artiste. L'artiste moule sa matière dans une manière inaltérable ; la tradition orale, elle, utilise les mises au point infinitésimales qui se succèdent au fil du récit conté et raconté pour acquérir de son côté une authentique forme, inaltérable elle aussi, comme si elle avait été fixée sur un support graphique. La forme, qu'est-ce d'autre que du « faire-sens » peu à peu solidifié, devenu ossature, puis squelette, enfin schème porteur ? Le rituel codifié du langage propre aux contes, la suite préréglée des épisodes, l'immuable début qui détemporalise (« Il était une fois... »), l'immuable fin qui sanctionne d'un avenir sexuel le triomphe des héros (« ils se marièrent, etc. »), qui affirmerait que ce sont des façons de conter plutôt que la substance de l'histoire ? Les contes sont l'écriture du « On », chargée, surchargée des forces pulsionnelles que la collectivité sent palpiter au fond de ce qu'elle ignore d'elle-même et de ses lois de perpétuation. « Rêves primitifs de la jeune humanité », disait Freud.
Après d'autres qu'on a oubliés ou qui ont travaillé sur des corpus lointains (Géza Róheim fut l'un des plus aigus et tenaces, en Océanie et en Australie), il revient à Bruno Bettelheim d'avoir mis en vedette les histoires merveilleuses de notre Occident. On peut récuser en doute la pureté doctrinale de son freudisme, marqué par l'ego-psychology, se gausser de certaines naïvetés, on doit lui accorder le mérite d'avoir souligné l'importance pour les esprits frustes d'un univers de discours qui fonctionne de la même façon que les œuvres d'art pour les plus avancés. Le folklore des contes offre en quelque sorte des fantasmes en « prêt-à-porter », sur lesquels chaque inconscient individuel brode à sa main en se sentant délivré, par la généralité même de ces aventures, de l'angoisse de s'en croire seul, et coupable, dépositaire. Quel plaisir de faire comme tant de héros massacrant à l'envi marâtres, beaux-pères, ogres et sorcières, sans parler des frères et sœurs ! Que de crimes commis avec la bénédiction supposée de Ma Mère l'Oye ! Ce monde de fées apporte aux jeunes auditeurs plus de bénéfices en leur assurant par l'exemple innocence et liberté de rêver, qu'en leur serinant des leçons d'opportunisme ou de raison. Rares sont les artistes qui ont égalé la force de naturel, la capacité de résonance de ces récits.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BELLEMIN-NOEL : professeur de littérature française moderne et contemporaine à l'université de Paris-VIII-Saint-Denis
Classification
Autres références
-
AUTOBIOGRAPHIE
- Écrit par Daniel OSTER
- 7 519 mots
- 5 médias
Aumoment où l'autobiographe énoncerait le constat de son imaginaire réussite – je parle et je dis cela de moi –, la psychanalyse pourrait lui souffler : ce n'est pas toi qui parles, ou bien : tu parles d'autre chose que tu n'énonces pas, ou encore : tu énonces une chose dont pourtant... -
AUTOFICTION
- Écrit par Jacques LECARME
- 2 427 mots
- 2 médias
Avec le début des années 1980, on a assisté à l'étonnante aventure d'un néologisme dont on ne sait encore s'il correspond à un nouveau genre littéraire ou à un effet spécial d'affichage, aussi séduisant que trompeur. En 1977, le mot fut inventé par Serge Doubrovsky...
-
BACHELARD GASTON (1884-1962)
- Écrit par Jean-Jacques WUNENBURGER
- 3 479 mots
- 1 média
Naît alors une seconde œuvre. Souvent rangée du côté des sciences littéraires, elle se révèle une défense et illustration de la face nocturne de l'homme, qui ne se réduit pas aux rêves de la nuit. Elle nous fait descendre vers l'inconscient, vers la mort, mais aussi vers les forces... -
BIOGRAPHIE
- Écrit par Alain VIALA
- 2 601 mots
...Angleterre de Lytton Strachey (La Reine Victoria, 1921), en Allemagne de Emil Ludwig (Guillaume II, 1926), en France d'André Maurois, cependant que la psychanalyse structure un système explicatif des faits et des créations par les traumatismes de la petite enfance (Edgar Poe, sa vie, son œuvre [1933],... - Afficher les 19 références
Voir aussi