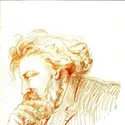LITTÉRATURE & PSYCHANALYSE
Article modifié le
Fantasme et fiction
Les œuvres nées de l'obscure tradition orale forment un point de référence commode. On y voit opérer en gros les mécanismes que la littérature dite grande présente dilués et déliés ; on peut leur appliquer tous les modes d'approche psychanalytique que l'on veut. Du fait même qu'ils ne sont surplombés par aucune instance auctoriale (qui donc, hormis un spécialiste, se soucie de déceler en Grimm un homme, ou deux frères, ou une équipe de chercheurs ?), il est possible de mettre en œuvre avec les contes un autre mode de lecture, un autre mode d'écoute qui fassent d'eux nos seuls partenaires, qui traitent les œuvres en valeurs authentiques, autonomes, dignes de considération pour elles-mêmes et non plus parce qu'elles reflètent un artiste ou un donné collectif. Les récits merveilleux prouvent qu'on peut lire en l'absence de l'auteur. En le plaçant, lorsqu'il existe, entre parenthèses.
L'adoption de ce style d'approche doit beaucoup, évidemment, à l'attitude structuraliste qui a prévalu dans notre culture durant la décennie 1968-1978, quand il fut à la mode de déclarer la mort de l'homme et le triomphe des dynamiques abstraites auto-organisées. Le prévisible mouvement de pendule qui s'imposedésormais, sans reconduire à la célébration idéaliste et idéalisante d'une personne « faite à l'image de Dieu », a réinstauré le privilège du sujet redevenu source de toute énonciation et pas seulement des énoncés. Le critique peut déplacer son champ d'action de derrière l'écriture à devant la lecture. Après le déchiffrement biographique, puis le décryptage des textes absolus, voici ce qu'on pourrait appeler la découverte du lecteur dans le livre – à l'instar de l'image dans le tapis de fameuse mémoire. Comment ne pas remarquer ce qu'une telle position a de conforme au projet même de la psychanalyse ? C'est bien dans le droit-fil de la théorie freudienne que l'on envisage le face-à-face de deux inconscients dans le cadre de la page écrite : une psyché ici, là du sens en gésine, ici et là deux forces au travail pour se reconnaître.
Une fois encore revenons à nos contes, pour imaginer ce que pourrait être le geste d'y réverbérer son propre inconscient de « consommateur », d'y affronter ses propres fantasmes en tant que tels, de les rêver, en quelque sorte, au lieu d'y guetter la rumeur des générations humaines. Tout d'abord, on soulignera les rapports typiques qui se nouent entre le petit auditeur (parfois lecteur) et le jeune héros d'une aventure merveilleuse, rapport dont le trait le plus visible est l'identification. Nous savons bien que chacun de nous envie la riche existence des héros de récit, et jusqu'à leurs infortunes. Cela vaut également pour notre inconscient, même si ce destin que nous rêvons est autrement apprécié sur « l'Autre Scène » que dans l'éclairage de notre quotidien. Le petit enfant dont le surmoi n'a pas encore atteint sa pleine force répressive n'éprouve aucune peine, aucune gêne à devenir, à s'avouer qu'il aimerait être un de ces enfants modèles que le récit présente successivement comme victimes, puis comme bourreaux des figures parentales. De manière plus subtile, en rechignant quelquefois à assumer tel aspect de son caractère pour mieux s'accorder le droit de lui ressembler sur tel autre point, les adultes épousent aussi intensément la destinée des personnages de roman ; ils s'en font des « idéaux ». Nul doute que l'oscillation entre idéal du moi et moi idéal ne soit un facteur déterminant dans la séduction qu'exerce sur nous celui à qui nous attribuons sur l'échiquier de notre vie psychique un rôle aussi réel qu'à nos amis et familiers. Et que nous ignorions quelle place il tient sur le théâtre de l'ombre n'est sans doute pas le moins décisif au principe et au terme de nos choix existentiels.
Le personnage devient un « porte-manteau » auquel nous accrochons nos costumes de lumière ou nos défroques de gueux. Il est ce support de nos fantasmes qui nous ressemble comme un double, et sa mise à nu devrait constituer le secret d'une psychanalyse du texte bien conduite. Il y a au foyer de tout récit, fût-ce un roman à intrigues multiples, quelqu'un dont on raconte la vie exemplaire et qui est pour chacun de nous, sur tous les plans, un alter ego. Un miroir dans lequel nous nous rencontrons en pleine lucidité, pour notre joie ou notre déception ; mais un ailleurs, aussi, où notre sosie inconscient ne nous offre que du plaisir, y compris le plaisir masochiste de deviner en lui quelque vérité déplaisante sur nous-même. « Fantasmer », est-ce autre chose qu'imaginer et rejouer des scénarios qui répètent certaines tragédies infantiles à la fois mal maîtrisées et indéfiniment fascinantes ? S'identifier, autrement dit se reconnaître sous les masques présentés par la fiction, voilà bien le mécanisme qui assure la jubilation inconsciente du lecteur.
Ou plus exactement la jubilation inconsciente propre à ce mode de lire qui caractérise le « lisant », si l'on entend par ce mot chacun de nous lorsqu'il effectue une lecture narcissique de tel roman, avec lequel nous entretenons des liens fraternels ou quasi amoureux ; lorsqu'il s'engage en entier dans l'aventure d'une participation, d'une substitution de rôles ; lorsqu'il s'abandonne au divertissement dans une sorte de dessaisissement. Je m'invente autre, c'est-à-dire je me retrouve tel que jamais je ne fus tout en désirant l'être. Je m'affronte à des tares que je ne m'avoue pas, je réalise des souhaits que je ne saurais assumer comme tels, à plus forte raison tenter de réaliser. Tel est l'état d'esprit invisible dans lequel nous lisons d'une seule traite, sans reprendre haleine une histoire nouvelle ou cent fois dégustée : paralysés, obnubilés, asservis. Heureux et un peu absents, éperdument perdus dans ce héros de papier à qui nous déléguons notre pouvoir de jouir, et même celui d'être nous. Mais ce style de lecture n'a qu'un temps (« la première fois »), ne va qu'à une circonstance (« mon livre de chevet »). Car, lorsque le lisant se fait lecteur, quand il prête attention à ce qui le comble ainsi, une fois qu'il s'est dédoublé pour se regarder lire et pour récupérer son esprit critique, n'y a-t-il pas changement de vision, de perspectives, d'optique ?
Oui et non. Le célèbre « Je me voyais me voir » de La Jeune Parque est une fausse fenêtre, en psychanalyse plus encore qu'ailleurs. L'essentiel n'est pas dans le double regard (ou la double présence), il est dans l'intercommunication des regards, ou faut-il dire dans le « regard-contre-regard », comme on parle de ce couple fécond que forment le transfert (du patient) et le contre-transfert (du psychanalyste) ? Je ne suis pas hors de moi à simplement contempler ces images qui se surveillent à la queue leu leu : je deviens la pulsation, l'échange vibrant, oscillatoire, quasi fusionnel, des saisies et pénétrations qu'effectuent les yeux couplés, ou dirai-je accouplés ? On peut parler d'extase. D'une extase contrôlée, mais contrôlée non pour en barrer l'exercice : pour en enregistrer la germination et les accomplissements fugitifs.
Il y a ainsi une lecture critique qui procède dans les allures de l'identification réciproque, et qui permet une exploration véritable de l'inconscient d'une fiction. On y célèbre en quelque sorte les épousailles d'un fantasme et de « son » lecteur. En soulignant l'adjectif possessif pour lui donner une valeur de réciprocité : c'est moi qui suis bel et bien le fantasme incarné du récit, et cela ne suffit pas de dire que le fantasme qui dormait dans l'œuvre (et qui, bien sûr, venait de l'écrivain, de l'auteur emporté par l'écriture) est mon ouvrage, voire ma « recréation ». Voilà à quelle condition, voilà à partir de quelle attitude minimale il est légitime de parler d'une critique véritablement psychanalytique.
Faire l'interprétation analytique d'une fiction, cela consiste donc à utiliser devant un récit les mêmes dispositifs qu'un psychanalyste avec un patient. Cela suppose que le récit en question se reforme, se réorganise en une personne qui sera mon vis-à-vis. Cette personne pourra être le héros, ou le narrateur, ou une « voix » syncrétique constituée (ce processus a pour nom « condensation ») par le télescopage, le chevauchement, la fusion de plusieurs visages en une figure : mon partenaire dans l'inconscient. Déchiffrer une fiction, ce sera donc construire puis faire parler cette figure, comme incarnant l'âme, le moteur et le résonateur fantasmatiques de cette histoire où je me devine impliqué du seul fait que je suis moi aussi un être humain, un sujet parlant.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BELLEMIN-NOEL : professeur de littérature française moderne et contemporaine à l'université de Paris-VIII-Saint-Denis
Classification
Autres références
-
AUTOBIOGRAPHIE
- Écrit par Daniel OSTER
- 7 519 mots
- 5 médias
Aumoment où l'autobiographe énoncerait le constat de son imaginaire réussite – je parle et je dis cela de moi –, la psychanalyse pourrait lui souffler : ce n'est pas toi qui parles, ou bien : tu parles d'autre chose que tu n'énonces pas, ou encore : tu énonces une chose dont pourtant... -
AUTOFICTION
- Écrit par Jacques LECARME
- 2 427 mots
- 2 médias
Avec le début des années 1980, on a assisté à l'étonnante aventure d'un néologisme dont on ne sait encore s'il correspond à un nouveau genre littéraire ou à un effet spécial d'affichage, aussi séduisant que trompeur. En 1977, le mot fut inventé par Serge Doubrovsky...
-
BACHELARD GASTON (1884-1962)
- Écrit par Jean-Jacques WUNENBURGER
- 3 479 mots
- 1 média
Naît alors une seconde œuvre. Souvent rangée du côté des sciences littéraires, elle se révèle une défense et illustration de la face nocturne de l'homme, qui ne se réduit pas aux rêves de la nuit. Elle nous fait descendre vers l'inconscient, vers la mort, mais aussi vers les forces... -
BIOGRAPHIE
- Écrit par Alain VIALA
- 2 601 mots
...Angleterre de Lytton Strachey (La Reine Victoria, 1921), en Allemagne de Emil Ludwig (Guillaume II, 1926), en France d'André Maurois, cependant que la psychanalyse structure un système explicatif des faits et des créations par les traumatismes de la petite enfance (Edgar Poe, sa vie, son œuvre [1933],... - Afficher les 19 références
Voir aussi