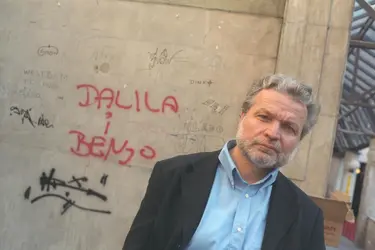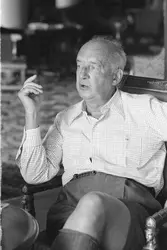EXIL LITTÉRATURES DE L'
Article modifié le
Exil et mémoire
Franchissons l'océan et touchons aux rives de la Méditerranée. Nous trouvons là une écriture qui entretient avec la langue française des rapports de fascination-répulsion.
Au célèbre « la langue française est ma patrie » d'un Gabriel Audisio, entraînant avec lui la totalité des écrivains pieds-noirs – d'Elissa Rhaïs à Albert Memmi – farouchement identifiés à la France par la langue, répond le non moins fameux « la langue française est mon exil » de Malek Haddad et avec lui de bon nombre de francophones des ex-colonies. Que nous sommes loin de l'allégresse joycienne de l'exilé emportant sa langue en guise de territoire – le génial landuage ! Mieux qu'aucun autre, sans doute, l'écrivain turc Nedim Gürsel saura le dire avec « les mots de l'exil » : « Je suis traversé dans ma vie quotidienne par la langue française qui me hante ; [...] ce lieu d'exil par excellence commence à structurer mes phrases [...] alors que je continue d'écrire en turc. » L'écrivain kabyle Nabile Farès se voit, dans son exil, comme « un passager de l'Occident », et s'il cherche à retrouver son identité par l'écriture il rédige Mémoire de l'absent (1974). Il est vrai qu'en arabe Occident se dit Maghreb ou territoire de l'exil, celui-là même où l'Islam s'éloigna du lieu de sa naissance.
La diaspora juive venue d'Orient situe son exil à une autre échelle, celle de l'identité : Albert Cohen, natif de Corfou, éduqué à Marseille, avocat à Genève, inventera pour le xxe siècle la métaphore absolue où les écrivains juifs de langue française se reconnaîtront, en installant sous la demeure somptueusement suisse et chrétienne de Solal (1930) une synagogue cryptique, peuplée d'un ghetto flamboyant et burlesque. Albert Memmi distinguera plus simplement – et avec lui la jeune et prolifique génération sépharade – le monde de l'intérieur (la famille, la tradition, la parole juive) et celui de l'extérieur (l'école, la culture occidentale, l'ascension sociale).
L'ascension par la culture est un trait pertinent de maints romans nés de l'exil : il caractérise les écrivains maghrébins, certes, mais aussi un grand pan de la littérature yiddish, à commencer par ce Manoir (1967), chef-d'œuvre d'Isaac Bashévis Singer, où l'on passe en une génération d'un shtetl – le village misérable et inculte – à la fastueuse Varsovie de la réussite. À l'image de la diaspora juive, la littérature yiddish est à la fois une et multiple, mais un seul trait la caractérise en son essence : la survivance. Aussi est-elle hantée par le destin collectif où l'intolérable et le tragique doivent se farder en écriture toute résonnante d'humour et de dérisoire. Elle est le témoignage d'un peuple morcelé qui, loin de tout territoire, hors de toute assise, proclame la force supérieure d'une âme résistante et souveraine.
Pour ceux qui ont déserté le Russie et l'Europe centrale en 1917, comme Vladimir Nabokov, ou un peu plus tard, dans les soubresauts des divers totalitarismes, l'exil apparaît, certes, comme une voie de salut. André Siniavski saura le célébrer, lui qui, délivré de la nostalgie par le séjour en prison, voit l'émigration comme « avant tout un endroit sur terre où l'on peut sans se cacher écrire ce que l'on veut et comme on veut ». Mais qui ne se rappelle l'amertume de Milan Kundera reliant d'un seul jet la Tchécoslovaquie à Rennes pour s'isoler en haut de la plus haute tour de la ville et regarder « à l'est, du côté de Prague » ? Attitude symbolique de l'exilé qui sait, comme Moïse, que la Terre promise lui est interdite, et qui s'en console par une écriture carnavalesque qui noie l'évocation mélancolique de son pays sous le rire, le masque grotesque et un pessimisme aussi bouffon que ravageur. Pour Nabokov, déjà, l'exil se doublait d'un sentiment aigu d'exil intérieur, d'une nostalgie de paradis perdu, de pays inaccessible – celle-là même qu'exprime à chaque page Autres Rivages (1951). Aussi multiplia-t-il les personnages déracinés – tel Pnine, universitaire russe des plus farfelus – ou repliés sur leurs obsessions et leur narcissisme agressif comme le Humbert Humbert de Lolita (1958). Pour lui aussi, nul doute que la patrie véritable est bien la langue, même s'il en a changé plusieurs fois, passant du russe au français, puis définitivement à l'anglais, en cultivant un art inégalé des jeux lexicaux et des parodies littéraires.
Judéo-Espagnol bulgare de langue allemande, autre bel exemple de passeur de frontières, Elias Canetti, lorsqu'il entreprend de raconter sa vie, l'intitule, de façon significative, La Langue sauvée (1977). Chez Canetti, comme chez Nabokov, le mot, le langage, voire la glose érudite témoignent de cette traversée des cultures et des idiomes. Quant à Cioran, le Roumain de Paris, qui, dit-on, mit dix années à maîtriser une langue qui était si familière à son compatriote, le génial Ionesco, il nous apprend que l'art de l'aphorisme – la parole économe de celui qui n'en sait que trop le prix – n'est plus cette élégante pratique d'un scepticisme de bon ton, mais bien tout ce qui reste à l'homme quand la Création, ce ratage primordial, est perçue comme un « acte de sabotage ». « C'est mon défaut d'élocution, mes balbutiements, ma façon saccadée de parler, mon art de bredouiller, c'est ma voix, mes r de l'autre bout de l'Europe, qui m'ont poussé par réaction à soigner quelque peu ce que j'écris et à me rendre plus ou moins digne d'un idiome que je malmène chaque fois que j'ouvre la bouche » (Écartèlement, 1979).
Chez tous ces bannis, et Walter Benjamin en est un cas extrême, lui qui, fine fleur de l'intelligentsia judéo-berlinoise, chassé par le nazisme, emprisonné par la France en 1940, toucha le fond du désespoir au point de se suicider à la frontière de l'Espagne, il s'agit toujours – par exemple, dans Images de pensée ou Rastelli raconte – de se laisser guider par une dérive intérieure qui est aussi un déplacement dans le langage. Chez Witold Gombrowicz aussi, ce Polonais qui eut le bon goût de choisir comme terre d'asile l'Argentine, patrie de la nostalgie, l'univers est en éternel bouleversement, la terre bascule et bouscule à la dérive, la vision pessimiste suggère « l'éclipse de l'homme, sa liquidation graduelle ». Autre figure emblématique de l'exil, Joseph Brodsky, Juif russe vivant aux États-Unis comme Soljénitsyne, développe une poésie du nomadisme : le poète ouvre les yeux sur un monde de ports, de rivières fuyantes, de bateaux « à la surface de l'eau, réduisant à zéro / tout espace derrière », sur des villes « où le pied ne laisse aucune trace », et il contemple, poussière, pourriture, charogne (« Nous resterons, mégot fripé, crachat, dans l'ombre / sous le banc »), toutes les formes du néant, toutes les expressions possibles d'un univers vide de Dieu, dont, comme tant d'autres, il se libère par le sarcasme et la dérision. Finalement, sous la multiplicité des thèmes, des voix et des écritures, on peut dire que ces écrivains de l'exil imposent la figure du banni sarcastique, fuyant les siens, maudissant et choyant contradictoirement sa terre, jetant un œil noir sur la Création tout entière. Les temps de la parole confisquée engendrent, et c'est heureux, une littérature nomade. Et, puisque c'est son seul bagage, son unique territoire, l'exclu promène une langue sauve qui puise dans son étrangeté et sa structure baroque une personnalité originale qui semble dire, dès lors qu'avec Georges Perec « l'Histoire avec sa grande hache » l'a retranché du lieu de sa naissance et de sa terre de référence : regardez-moi tel que je suis et sachez me reconnaître dans « le miroir brisé des mots » (E. Jabès).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Albert BENSOUSSAN : professeur émérite à l'université de Rennes-II-Haute-Bretagne
Classification
Médias
Autres références
-
CORRESPONDANCE DE HANNAH ARENDT
- Écrit par Alain BROSSAT
- 1 565 mots
Autant la réception de Hannah Arendt en France a été tardive, hésitante, voire rétive, autant la reconnaissance de sa stature de penseur du politique et de philosophe va bon train. La publication, en 1995 et 1996 respectivement, de sa correspondance avec deux de ses amis les plus proches – le philosophe...
-
DARWICH MAHMOUD (1941-2008)
- Écrit par Sobhi BOUSTANI
- 1 566 mots
- 1 média
La découverte de l'Autre,l'exil à l'intérieur d'un pays qui n'est plus le sien et l'engagement dans la vie politique marqueront profondément les premières œuvres de Mahmoud Darwich. Six recueils de facture lyrique imprégnés d'un romantisme prononcé vont d'abord l'imposer comme poète révolutionnaire... -
L'IGNORANCE (M. Kundera)
- Écrit par Anouchka VASAK
- 942 mots
« Du vraisemblable plaqué sur de l'oublié » : c'est ainsi que Josef, un des personnages du roman de Milan Kundera, conclut l'interprétation d'un souvenir. Que l'on retrouve sous cette expression celle du Rire de Bergson – « du mécanique plaqué sur du vivant » – donne...
-
KRACAUER SIEGFRIED (1889-1966)
- Écrit par Nicole BARY
- 1 208 mots
Tardivement connue en France, bien que la traduction française par Clara Malraux de son roman Ginster (1928, Genêt) soit parue dès 1933, l'œuvre de Siegfried Kracauer a été profondément marquée par les grands bouleversements du xxe siècle. Figure de proue de la République de Weimar...
- Afficher les 14 références
Voir aussi