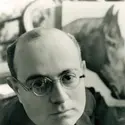LUMIÈRES
Article modifié le
Historicité des Lumières
On peut douter que les Philosophes se soient pensés comme formant un groupe socialement et idéologiquement homogène, dont les Lumières auraient précisément constitué le ciment. Voltaire dénonce les propositions régressives de Rousseau. Le Mondain marque, dès 1736, l'opposition de Voltaire aux tenants du primitivisme. Diderot se méfie de Voltaire, qu'il évitera de rencontrer. Rousseau, lui, a rompu très tôt avec le « clan encyclopédique ». Montesquieu appartient à un autre monde social, politique et même idéologique, malgré les Lettres persanes (1721) qui inaugure une des formes les plus novatrices de l'écriture philosophique. Si Voltaire reste sa vie durant fidèle au programme des Lettres philosophiques de 1734, que de changements chez un Diderot ou un Rousseau, au point même de les amener à se contredire ! Peut-on oublier que ces Lumières, que la postérité propose souvent comme un modèle figé, se sont étendues sur presque trois générations, connaissant nécessairement des évolutions contradictoires, hésitant entre radicalisation et accommodement ? Voltaire refusa l'athéisme du baron d'Holbach – un des collaborateurs les plus importants de la partie scientifique de l'Encyclopédie –, contre lequel il mena le combat au terme de sa vie. Suard, un des représentants des Lumières à l'Académie, semble bien éloigné des ardeurs philosophiques des années 1750. Qui admettre parmi les élus ? Que retenir dans ce que nous appelons les Lumières ?
La construction d'un système
On est loin de cette communauté que formait la république des Lettres des xvie et xviie siècles. Les contemporains en furent conscients, qui, à la façon de Sabatier de Castres dans Les Trois Siècles de littérature française (1772), dénoncèrent son démantèlement par les exclusions qu'opéra le clan encyclopédique. Même s'ils préfèrent parler de « siècle de la raison », « siècle philosophique », « siècle éclairé », on trouve des références aux lumières « de la raison », « de notre siècle », ou « de la philosophie » chez Voltaire, Rousseau, Diderot et leurs amis. Mais nombre de ces références existent aussi chez leurs adversaires. Des mots passent ainsi d'un camp à l'autre : on s'imite et on se pille, sans que cela prête vraiment à conséquence ou traduise un quelconque ralliement à une cause ou à l'autre. Dans ces transferts, les mots changent parfois de sens, et il existe un usage mondain et salonnier du vocabulaire philosophique qui n'est pas sans importance.
Comme souvent, c'est sans aucun doute à leurs adversaires que les Lumières doivent leur unité, plus apparente que réelle. L'antiphilosophie a œuvré à la constitution, largement fantasmatique, d'une armée philosophique, porteuse d'un projet déstabilisateur de l'ordre moral et social, partageant valeurs et mots d'ordre. Cette mise en perspective efface les différences de Voltaire à Rousseau, de Montesquieu pris à partie par les jansénistes après la publication de l'Esprit des lois (1748) au Système de la nature du baron d'Holbach (1770) violemment dénoncé au moment de sa parution. Ce n'est pas une boutade que de prétendre que les Lumières doivent leur cohérence aux mandements épiscopaux qui condamnent leur présence dans les œuvres philosophiques, aux Mémoires sur les Cacouacs de l'historiographe Jacob Nicolas Moreau (1757) qui décrit les Philosophes comme une peuplade grossière et hostile, ou encore aux dénonciations répétées de l'abbé Bergier et de ses acolytes.
Aux yeux de leurs adversaires, puis de leurs partisans, ces Lumières construites, érigées en système, étendues à l'ensemble des philosophes sont parfaitement incarnées, de fait, par le seul Voltaire. Son anticléricalisme, son engagement dans les affaires Calas, Sirven ou de La Barre revêtent dès lors une valeur paradigmatique. Ce mouvement fabrique une unité et une diversité à partir d'une figure symbolique, au demeurant largement caricaturée. Voltaire y est souvent accusé d'athéisme, ce qui est faux, d'antimonarchisme, ce qui est très inexact. Autant de distorsions qui expliquent par ailleurs le rôle qui lui sera dévolu dans le destin posthume des Lumières, où il apparaît comme un accomplissement. À tel point que le voltairianisme du xixe siècle républicain et bourgeois finira un temps par se confondre avec les Lumières elles-mêmes.
La Révolution, fille des Philosophes ?
La Révolution confortera ce processus de construction. Face à cet événement incompréhensible, ses adversaires désorientés tentèrent de l'expliquer par un complot émanant des Lumières. C'est la thèse d'Augustin Barruel dans ses Mémoires pour l'histoire du jacobinisme (1797-1799). Voltaire, agent de liaison, y est accusé d'être, avec l'appui des francs-maçons allemands, l'artisan de la Révolution. La démarche est plus subtile chez La Harpe, voltairien à ses débuts, zélé révolutionnaire jusqu'au triomphe des Jacobins, et qui, menacé de la guillotine, obligé de se terrer pour échapper au tribunal, converti au catholicisme, rédige les volumes consacrés à la Philosophie du XVIIIe siècle pour conclure son Cours de littérature ancienne et moderne, dont la publication commence en 1799. La thèse en est simple : les idées des philosophes en provoquant une fermentation des esprits ont engendré la Révolution. Ce schéma qui semble aujourd'hui banal, révèle pourtant une audacieuse nouveauté. À bien des égards, il fonde ce qu'on appelle communément l'histoire des idées, et donne au livre imprimé une force nouvelle. Par ce rôle dévolu au xviiie siècle, la Révolution constitue le couronnement de cette période d'expansion triomphante de l'imprimé.
De leur côté, les révolutionnaires ne demeurèrent pas en reste. En quête de filiation légitimatrice, ils se réclamèrent de Voltaire, qu'ils installèrent au Panthéon, de Rousseau souvent, et plus rarement de Diderot, trop matérialiste. Si les Girondins furent volontiers voltairiens, les Jacobins se rattachèrent plus volontiers à Rousseau, dont Robespierre dénoncera la marginalisation par les philosophes en place. Tout comme plus tard Napoléon, ils se crurent héritiers des Lumières, qu'ils inscrivaient dans les institutions et les lois.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean Marie GOULEMOT : professeur émérite de l'université de Tours, Institut universitaire de France
Classification
Média
Autres références
-
LUMIÈRES, notion de
- Écrit par Universalis
- 1 309 mots
Définir globalement les Lumières comme une rupture radicale intervenue dans la pensée au xviiie siècle serait les priver de leur généalogie et des antécédences qui les ont rendues possibles. C'est bien la continuité entre lumière de la foi, conduisant au salut éternel, et lumière de la raison, donnant...
-
QU'EST-CE QUE LES LUMIÈRES ? Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 136 mots
Publié en 1784 dans la BerlinischeMonatsschrift, soit trois ans après la Critique de la raison pure (1781) et quatre ans avant la Critique de la raison pratique (1788), Qu’est-ce que les Lumières ? peut être considéré comme le bouquet du feu d’artifice de cette période qualifiée d’ « ...
-
ABOLITIONNISME, histoire de l'esclavage
- Écrit par Jean BRUHAT
- 2 944 mots
- 3 médias
...Sans doute les abolitionnistes anglais ont-ils influencé la France, mais l'abolitionnisme français tire avant tout sa justification de la philosophie des Lumières. Quelles que soient leurs divergences sur la légitimité et l'utilité des colonies, les philosophes avaient été unanimes à condamner l'esclavage... -
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
...mouvement interne d'autodestruction. Même éveillée, la raison engendre des monstres. Aussi les théoriciens critiques prennent-ils le contre-pied de la thèse classique des Lumières qui faisait de la raison – le penser éclairé – un adversaire déclaré du mythe. Selon Adorno et Horkheimer, il existe une... -
ALEMBERT JEAN LE ROND D' (1717-1783)
- Écrit par Michel PATY
- 2 876 mots
- 2 médias
L'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du xviiie siècle, d'Alembert fut aussi un philosophe marquant des Lumières. Dans les sciences aussi bien qu'en philosophie, il incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes, ouvrant la voie...
-
ALFIERI VITTORIO (1749-1803)
- Écrit par Jacques JOLY
- 2 587 mots
- 1 média
...nouveau courant de sensibilité qui tend à en dépasser les limites. Plus qu'aucun écrivain italien de son temps, Alfieri a vécu la crise de l'idéologie des « Lumières » : son œuvre est un effort désespéré pour canaliser dans un cours rationnel des forces nouvelles. Ainsi s'explique l'aspect barbare de son théâtre,... - Afficher les 128 références
Voir aussi
- OBSERVATION
- EUROPE, histoire
- LITTÉRATURE SOCIOLOGIE DE LA
- HISTOIRE LITTÉRAIRE
- ORDRE DU MONDE
- NATURE ÉTAT DE
- ENFANT SAUVAGE
- SAVOIR
- NATURE & CULTURE
- COSMOPOLITISME
- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958
- FRANCE, histoire, de 1715 à 1789
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871
- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939
- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- SOCIALISTES MOUVEMENTS
- L'INGÉNU, Voltaire - Esprit des Lumières