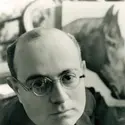LUMIÈRES
Article modifié le
L'Europe des Lumières
Très longtemps on a considéré que les Lumières comme un phénomène essentiellement français. Si des recherches, souvent importantes étaient consacrées à la diffusion des Lumières françaises en Europe, on faisait beaucoup moins de cas, par exemple, des origines étrangères de cette philosophie des Lumières, ou des formes qu'elles pouvaient revêtir, fussent-elles inspirées par la France, après avoir franchi une frontière ou changé de langue.
On n'accusera pas le seul francocentrisme d'un tel état de fait. Sans doute un vif sentiment de supériorité culturelle a-t-il ici joué son rôle. Mais rappelons aussi que les Lumières, fait alors sans doute unique, ont été en France, dès l'origine, l'objet d'un double discours, laudatif ou péjoratif, mais toujours politique, et qu'on en a fait une des causes déterminantes de la Révolution française qui aurait incarné leurs valeurs. Comme les Lumières, la Révolution a servi de modèle et de référence aux mouvements de libération nationale européens tout au long du xixe siècle. Enfin n'était-il pas acquis que l'Europe intellectuelle parlait français ? Une vision plus européenne des Lumières est apparue tardivement. Chez Gustave Lanson qui a montré dans une célèbre édition critique ce que les Lettres philosophiques de Voltaire devaient aux sources anglaises, mais plus encore chez Paul Hazard qui publia en 1935, La Crise de la conscience européenne (1680-1715). Par ailleurs, l'intérêt porté par le marxisme au xviiie siècle a fait que dans les pays soumis à la tutelle soviétique, tout comme en U.R.S.S, les académies des sciences consacrèrent une grande part de leurs travaux aux Lumières en général et à la forme nationale qu'elles avaient revêtue. Ce fut, par exemple, le cas pour la Russie, la Hongrie, et la R.D.A.
On peut aujourd'hui mesurer non seulement ce que fut la diffusion des Lumières, mais leur spécificité selon le pays considéré. Ainsi s'explique l'intérêt pour le despotisme éclairé qui toucha essentiellement la Prusse, la Russie et l'Autriche, pour des auteurs jugés marginaux, quand bien même ils avaient écrit en français, comme le comte Sociedad Jan Potocki (1761-1815), auteur d'un étonnant récit, Le Manuscrit trouvé à Saragosse, qui est le seul roman baroque des Lumières. On a pu rendre à chaque pays son dû philosophique, et remettre en cause les idées reçues. On doit ainsi à l'Italie une réflexion fondamentale sur la justice et ses pratiques grâce au traité du marquis de Beccaria (1738-1794), Des délits et des peines (1764) et aux Observations sur la torture de Pietro Verri (1777). Mais on doit plus encore à l'Angleterre. La première traduction française de L'Essai philosophique concernant l'entendement humain de John Locke date de 1723. Il s'en publiera huit éditions auxquelles s'ajoutent trois éditions d'un Abrégé. Cet ouvrage est la source du Traité des sensations de Condillac, paru en 1754, et du sensualisme que Diderot applique au domaine moral dans La Lettre sur les aveugles (1749) et à la formation de l'intellect dans L'Entretien avec d'Alembert (1769). L'essai Du gouvernement civil est traduit en 1691, et sa septième édition paraît en 1795. Si son influence immédiate n'est pas évidente, elle n'en est pas moins très sensible dans les débats sur la « constitution française » et l'avenir, après 1789, de la monarchie elle-même.
L'Europe géographique est parfaitement définie dès la Renaissance. Mais elle ne correspond pas à l'Europe culturelle constituée au cours du xviie siècle qui se limite d'abord à l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, ni à l'Europe religieuse, protestante au nord, catholique au Sud et orthodoxe à l'est. Dans un concert dissonant, chacun de ces pays tient un rôle : l'Angleterre est le modèle du libéralisme politique, l'Espagne est l'image de la réaction, de l'intolérance et de l'appauvrissement malgré l'or de l'Amérique, la France de l'esprit, de la galanterie, de la frivolité avant de représenter la philosophie nouvelle. Peu à peu, l'Europe gagnée à la philosophie s'agrandit : les pays du Nord avec Gustave III de Suède, la Russie modernisée par Pierre le Grand puis par Catherine de Russie, qu'admirent Voltaire et Diderot, l'Espagne sous le règne de Charles III et grâce aux efforts des afrancesados, réformateurs gagnés aux Lumières. La donne ne cesse de se modifier. L'Angleterre est soupçonnée de corrompre ses idéaux démocratiques, les Provinces-Unies de sacrifier tolérance et liberté aux nécessités du commerce, l'Italie est rendue responsable de son dépérissement politique et culturel, la Russie de sa barbarie.
Dans l'Europe du xviiie siècle les hommes et les idées voyagent. La presse périodique annonce et commente les livres nouveaux. On traduit, on correspond, les académies se mutiplient. Le philosophe est cosmopolite et souvent polyglotte. Il est parfois l'invité de pouvoirs qui, dans les faits, malgré ce qu'il choisit d'en croire, ne respectent pas les valeurs qu'il défend. Les despotes ont saisi l'importance légitimatrice de ce « mécénat » philosophique. Le sceptique Diderot, le matérialiste La Mettrie en bénéficieront. Le partage répété de la Pologne par les despotes éclairés rendra les philosophes un peu plus lucides sur la politique de leurs protecteurs. Diderot, véhément mais désenchanté, dans l'Essai sur la vie de Sénèque et les règnes de Claude et de Néron (1778 et 1782), s'interroge à travers la vie et l'œuvre du stoïcien, précepteur de Néron, sur le rôle du philosophe proche du pouvoir. Peut-il empêcher les crimes du tyran ? Se compromet-il à son contact ? N'est-il pas voué à collaborer, malgré lui ? Le voyage en Russie de Diderot l'a rempli d'amertume. Il se sent floué, bien plus tragiquement que Voltaire poursuivi par la police prussienne quand il fuit Potsdam. Ce même Voltaire déchante quand il prend conscience que l'Angleterre, icône de la liberté, s'oppose à l'exigence de liberté de ses colonies d'Amérique.
L'Europe cosmopolite connaît ses tensions et ses modes. L'opinion se révèle, au gré des événements, anglophile ou anglophobe. Les « afrancesados » espagnols, à la suite de l'occupation napoléonienne, sont obligés de rallier les rangs de leurs adversaires idéologiques. La Révolution n'accomplit pas dans les pays envahis les promesses des Lumières. Elle renforce le nationalisme et fait reculer cette Europe culturelle qu'avait construite le xviiie siècle. Son désir d'imposer à tous le modèle révolutionnaire réveille une tension entre cosmoplitisme et patriotisme que l'expansion philosophique avait occultée. Le cosmopolitisme est exalté par Fougeret de Montbron dans Le Cosmopolite, ou le Citoyen du monde (1750), mais vilipendé par l'abbé Coyer dans sa Dissertation sur le vieux mot de Patrie (1755). On ne cesse d'opposer les Français et les Anglais (ainsi de Louis Béat de Muralt à qui répondront Pierre Brumoy et l'abbé Desfontaines), de comparer Londres et Paris (L. S. Mercier, dans le Parallèle de Paris et de Londres). Les voyageurs sont souvent plus critiques que laudateurs.
Cette Europe construite moins par l'élite européenne que par le travail postérieur de ses historiens, est bien différente de la nôtre. C'est pourquoi on aurait tort de la comparer avec notre propre idée de l'Europe, qu'il s'agisse de la place qu'y tiennent le français et la France, de la question d'une culture ou d'une civilisation communes, ou des spécificités de chacun des peuples qui la composent avec l'idée européenne des Lumières. La célèbre phrase de Rousseau dans Les Considérations sur le gouvernement de Pologne et sa réformation projetée : « Il n' y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais même quoi qu'on en dise ; il n'y a que des Européens » n'était pas plus recevable au xviiie siècle qu'aujourd'hui. Mais il ajoutait :« Tous ont les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes mœurs [...]. Tous, dans les mêmes circonstances, feront les mêmes choses ; tous se diront désintéressés et seront fripons ; tous parleront du bien public et ne penseront qu'à eux-mêmes ; tous vanteront la médiocrité et voudront être des Crésus... ». Ce qui constitue sans doute une définition un peu plus exacte des Européens actuels.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean Marie GOULEMOT : professeur émérite de l'université de Tours, Institut universitaire de France
Classification
Média
Autres références
-
LUMIÈRES, notion de
- Écrit par Universalis
- 1 309 mots
Définir globalement les Lumières comme une rupture radicale intervenue dans la pensée au xviiie siècle serait les priver de leur généalogie et des antécédences qui les ont rendues possibles. C'est bien la continuité entre lumière de la foi, conduisant au salut éternel, et lumière de la raison, donnant...
-
QU'EST-CE QUE LES LUMIÈRES ? Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 136 mots
Publié en 1784 dans la BerlinischeMonatsschrift, soit trois ans après la Critique de la raison pure (1781) et quatre ans avant la Critique de la raison pratique (1788), Qu’est-ce que les Lumières ? peut être considéré comme le bouquet du feu d’artifice de cette période qualifiée d’ « ...
-
ABOLITIONNISME, histoire de l'esclavage
- Écrit par Jean BRUHAT
- 2 944 mots
- 3 médias
...Sans doute les abolitionnistes anglais ont-ils influencé la France, mais l'abolitionnisme français tire avant tout sa justification de la philosophie des Lumières. Quelles que soient leurs divergences sur la légitimité et l'utilité des colonies, les philosophes avaient été unanimes à condamner l'esclavage... -
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
...mouvement interne d'autodestruction. Même éveillée, la raison engendre des monstres. Aussi les théoriciens critiques prennent-ils le contre-pied de la thèse classique des Lumières qui faisait de la raison – le penser éclairé – un adversaire déclaré du mythe. Selon Adorno et Horkheimer, il existe une... -
ALEMBERT JEAN LE ROND D' (1717-1783)
- Écrit par Michel PATY
- 2 876 mots
- 2 médias
L'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du xviiie siècle, d'Alembert fut aussi un philosophe marquant des Lumières. Dans les sciences aussi bien qu'en philosophie, il incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes, ouvrant la voie...
-
ALFIERI VITTORIO (1749-1803)
- Écrit par Jacques JOLY
- 2 587 mots
- 1 média
...nouveau courant de sensibilité qui tend à en dépasser les limites. Plus qu'aucun écrivain italien de son temps, Alfieri a vécu la crise de l'idéologie des « Lumières » : son œuvre est un effort désespéré pour canaliser dans un cours rationnel des forces nouvelles. Ainsi s'explique l'aspect barbare de son théâtre,... - Afficher les 128 références
Voir aussi
- OBSERVATION
- EUROPE, histoire
- LITTÉRATURE SOCIOLOGIE DE LA
- HISTOIRE LITTÉRAIRE
- ORDRE DU MONDE
- NATURE ÉTAT DE
- ENFANT SAUVAGE
- SAVOIR
- NATURE & CULTURE
- COSMOPOLITISME
- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958
- FRANCE, histoire, de 1715 à 1789
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871
- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939
- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- SOCIALISTES MOUVEMENTS
- L'INGÉNU, Voltaire - Esprit des Lumières